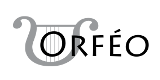CONTRIBUTION À LA MISE EN ÉVIDENCE DES EFFECTEURS IMPLIQUÉS DANS L’IMMUNITÉ INNÉE D’Armadillidium vulgare, CRUSTACÉ ISOPODE TERRESTRE INFECTÉ PAR UNE BACTÉRIE DU GENRE Wolbachia.
Scientext
Projet ORFEO © 2015 CNRS
Corpus Scientext
Le projet Scientext a permis de constituer un corpus de textes scientifiques consultable en ligne d’environ 4,8 millions de mots en français. Le corpus a été annoté au niveau de l’en-tête (méta-données sur l’annotation et l’origine du corpus), au niveau de la structure (parties de l’article) et au plan morphologique et syntaxique à l’aide du logiciel Syntex développé par Didier Bourigault, et en respectant les recommandations XML et TEI en vigueur. Il est consultable en ligne. Ce projet a fait collaborer des équipes pluridisciplinaires de chercheurs en linguistique, linguistique informatique et didactique .
Métadonnées : general
| Corpus | Scientext 2010 |
| Nom du fichier | CONTRIBUTION À LA MISE EN ÉVIDENCE DES EFFECTEURS IMPLIQUÉS DANS L’IMMUNITÉ INNÉE D’Armadillidium vulgare, CRUSTACÉ ISOPODE TERRESTRE INFECTÉ PAR UNE BACTÉRIE DU GENRE Wolbachia. |
| Responsable(s) | Agnès TUTIN et Francis GROSSMANN |
| Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
| Annotation | automatique |
| Type | écrit scientifique |
| Sous-type de texte | thèse |
| Modalité | écrit |
| Adresse d'échantillon | /annis-sample/scientext/these_272_bio_herbiniere_gaboreau.html |
Texte
| _: | N° attribué par la bibliothèque \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| T H È S E pour l' obtention du grade de DOCTEUR DE L' UNIVERSITÉ DE POITIERS FACULTÉ DES SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES ( Diplôme National & 226;& 128;& 147; Arrêté du 25 avril 2002 ) Ecole Doctorale : Ingénierie Chimique , Biologique et Géologique Secteur de Recherche : Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie Présentée par Juline HERBINIÈRE CONTRIBUTION À LA MISE EN ÉVIDENCE DES EFFECTEURS IMPLIQUÉS DANS L' IMMUNITÉ INNÉE D' Armadillidium vulgare , CRUSTACÉ ISOPODE TERRESTRE INFECTÉ PAR UNE BACTÉRIE DU GENRE Wolbachia . Soutenue le 28 juin 2005 devant la Commission d' Examen JURY C . HÉTRU Directeur de Recherche , CNRS UPR 9022 , Strasbourg Rapporteur M. SALZET Professeur , Université de Lille Rapporteur T. BERGES Professeur , Université de Poitiers Examinateur C . BRAQUART-VARNIER Maître de Conférences , Université de Poitiers Codirecteur de thèse Y. HÉCHARD Maître de Conférences , Université de Poitiers Examinateur G. MARTIN Directeur de Recherche , CNRS UMR 6556 , Poitiers Directeur de thèse Sommaire SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE ....... 1 RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES ....... 4 I. LA RÉPONSE IMMUNITAIRE CHEZ LES CRUSTACÉS ....... 4 I.1 . Les hémocytes : hématopoïèse et fonction des hémocytes ....... 5 I.2 . Les phénomènes de reconnaissance ....... 6 I.3 . La réponse cellulaire ....... 8 3.1 . La phagocytose ....... 8 3.2 . La formation des nodules et l' encapsulation ....... 9 I.4 . La réponse humorale ...... 10 4.1 . La coagulation ...... 10 4.2 . Activité phénoloxydase et mélanisation ...... 14 4.3 . Le rôle de l' hémocyanine ...... 15 4.4 . Les mécanismes de communication et de régulation de la réponse immunitaire .. 16 4.5 . Les facteurs antimicrobiens ..... 18 II . LES PEPTIDES ANTIMICROBIENS CHEZ LES ARTHROPODES ..... 20 II.1 . Classification des peptides antimicrobiens ..... 21 II.2 . Protéines présentant une activité antimicrobienne annexe ..... 27 2.1 . L' hémocyanine ..... 27 2.2 . La proppA ..... 28 II.3 . Mode d' action des peptides antibactériens ..... 28 3.1 . Le modèle par formation de pores : « Barel stave » ..... 29 3.2 . Le modèle détergent : « Carpet » ..... 29 3.3 . Autres mécanismes ..... 30 II.4 . Régulation de la synthèse des peptides antimicrobiens ..... 30 4.1 . Chez les insectes ..... 30 4.2 . Chez les chélicérates ..... 32 4.3 . Chez les crustacés ..... 34 MATERIELS ET METHODES ..... 37 I. MODÈLE BIOLOGIQUE ET ÉLEVAGE ..... 38 II . PRÉLÈVEMENT DE L' HÉMOLYMPHE ..... 40 III INJECTIONS EXPÉRIMENTALES DES ANIMAUX ..... 40 IV . TESTS D' ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE ..... 41 IV.1 Tests d' activité antibactérienne ..... 41 IV.2 . Tests d' activité antifongique ..... 43 IV.3 . Concentration minimale d' inhibition ( MIC ) ..... 46 V. APPROCHE PROTÉOMIQUE ..... 46 V.1 . Extraction des protéines ..... 46 1.1 Des hémocytes ..... 46 1.2 . Du plasma ..... 47 1.3 . Des organes hématopoïétiques ..... 47 1.4 . Des cæcums digestifs ..... 47 V.2 . Purification et analyses des protéines ..... 48 2 . 1 .Sep -Pak ..... 48 2.2 . RP-HPLC ..... 49 2.3 . MALDI-TOF ..... 49 2.4 . Séquençage par dégradation d' Edman ..... 50 2.5 . Electro-spray ( ES-MS ) ..... 51 2.6 . Gels 1-D ..... 51 2.7 . Gels 2-D ...... 52 2.8 . Analyses des spots de 2-D ...... 59 VI . APPROCHE GÉNOMIQUE ..... 60 VI.1 . Extraction des ARNs totaux ..... 60 VI.2 . RT-PCR ..... 61 VI.3 . Northern Blotting ..... 62 VI.4 . Clonage de différents ADNc ..... 63 IIV . 5 . Construction d' une banque d' ADNc d' hémocytes d' Armadillidium vulgare ...... 65 VII . APPROCHE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE ..... 66 VII .1 . Microscopie photonique ..... 66 VII .2 . Microscopie électronique à transmission ( MET ) ..... 66 VII3 . Microscopie électronique à balayage ( MEB ) ..... 68 CHAPITRE I : APPROCHE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE ..... 70 I. OBSERVATION DES HEMOCYTES EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ..... 73 II . OBSERVATION DES HEMOCYTES EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ..... 73 III . « FRAGILITE » DES HEMOCYTES INFECTES PAR Wolbachia ..... 77 IV . ASSIGNEMENT DE LA FONCTION DE PHAGOCYTOSE ..... 79 V. ASSIGNEMENT DE LA FONCTION D' ENCAPSULATION ..... 81 VI . OBSERVATION DES ORGANES HEMATOPOÏETIQUES ..... 85 VII . EVOLUTION DU TAUX D' HEMOCYTES CIRCULANTS ..... 93 VIII . CONCLUSION PERSPECTIVES ..... 98 CHAPITRE II : ISOLEMENT ET CARACTERISATION DE L' ARMADILLIDINE ..... 101 I. DETECTION D' UNE ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DANS L' HEMOLYMPHE d' Armadillidium vulgare .... 102 II . ISOLEMENT D' UN PEPTIDE ANTIBACTERIEN A PARTIR DES HEMOCYTES d' Armadillidium vulgare .... 104 II.1 . Purification de l' armadillidine .... 104 II.2 . Détermination de la structure primaire de l' armadillidine .... 104 II.3 . Clonage de l' ADNc de l' armadillidine .... 112 II. 4 . Spécificité de l' expression de l' armadillidine .... 116 4.1 . Spécificité tissulaire de l' armadillidine .... 116 4.2 . Spécificité zoologique de l' armadillidine .... 117 II.5 Libération de l' armadillidine .... 123 III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES .... 126 CHAPITRE III . LIBÉRATION D' UN PEPTIDE ANTIFONGIQUE PAR CLIVAGE DE L' HÉMOCYANINE .... 127 I. CLONAGE DE L' ADNC DE L' HÉMOCYANINE .... 129 II . CLIVAGE DE L' EXTREMITÉ C TERMINALE .... 132 I I.1 . Acidification du plasma par du TFA 0 , 1 % .... 133 II.2 . Acidification du plasma par du HCl 0 , 1M .... 133 III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES .... 140 CHAPITRE IV : PROTÉINES IMPLIQUÉES DANS LE SYSTÈME IMMUNITAIRE : APPROCHES PROTÉOMIQUES .... 147 I. ÉLECTROPHORÈSE 1-D .... 149 I.1 . Hémocytes .... 149 I.2 . Plasma .... 150 I.3 . Autres tissus : Organes hématopoïétiques et caecums digestifs .... 150 II . ÉLECTROPHORÈSE 2-D .... 152 II.1 Hémocytes ... 155 1.1 . Identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare . .... 155 Les protéines enzymatiques : .... 157 Les protéines du cytosquelette : .... 157 Protéines de réponse au stress : .... 162 Réponse immunitaire : .... 163 1.2 . Identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia . .... 169 1.3 . Identification des protéines plasmatiques d' Armadillidium vulgare .... 175 III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES .... 178 CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES .... 180 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .... 182 ANNEXES .... 207 Introduction Générale INTRODUCTION GENERALE Au commencement des travaux présentés dans ce mémoire , aucune étude n' avait été réalisée sur le système immunitaire des isopodes terrestres . Cette étude se justifiait notamment par le fait que dans la nature coexistent des populations d' Armadillidium vulgare dont la plupart des individus hébergent une bactérie endocellulaire Gram ( - ) du genre Wolbachia et des populations dont les individus ne sont pas infectés . Cette présence bactérienne intrigante , expliquée en partie par des transferts horizontaux , nous a amené à nous questionner sur les performances du système immunitaire de l' hôte . Chez le crustacé isopode terrestre Armadillidium vulgare ( plus communément appelé cloporte ) , Wolbachia a la capacité d' inverser les mâles génétiques en femelles fonctionnelles ( néofemelles ) qui transmettent le symbiote à leur descendance ( Martin et al. , 1973 ) . Ainsi , le sex-ratio de la descendance est fortement biaisé vers les femelles , assurant à la bactérie une large propagation au sein des populations . Seuls quelques ovocytes ( 10 à 20 % ) échappent à l' infection et assurent , par ce biais , la présence de mâles et la pérennité de la population . Des transferts interspécifiques de la bactérie ( par injection ) dans des espèces phylétiquement voisines d' Armadillidium vulgare ( du même genre ou d' un genre de la famille des Armadillididae ) entraînent une modification physiologique des mâles infectés et leur féminisation externe ( Juchault et al. , 1974 ) . Au cours de ces infestations , l' implantation de la bactérie dans tous les tissus ( y compris dans les hémocytes ) est observée . La présence de la bactérie dans les hémocytes , cellules spécifiques de l' immunité chez les crustacés , amène à deux questions : ( i ) Comment la bactérie pénètre t -elle à l' intérieur de ces cellules et comment se maintient -elle ? ( ii ) Les hémocytes servent -ils de vecteurs pour la dissémination de la bactérie dans tous les tissus ? La féminisation complète des individus génétiquement mâles porteurs de Wolbachia implique qu' il n' existe pas de gènes liés au sexe . L' existence de quelques individus intersexués stériles , avec des glandes androgènes hypertrophiées , dans les populations est du plus grand intérêt pour comprendre le mécanisme d' action de Wolbachia en tant que parasite du sexe : l' inhibition de l' expression du gène codant l' hormone androgène suffit pour induire une physiologie femelle . Dans cette association , l' hôte ne semble donc pas bénéficier de cette relation , on peut alors se demander pourquoi il n' élimine pas la bactérie ? Est ce que Wolbachia échappe totalement au système immunitaire d' Armadillidium vulgare ? Est -t-elle furtive ou inhibe -t-elle la réponse immunitaire ? Le système immunitaire est -il parfaitement adapté pour reconnaître tous les types de déterminants antigéniques ? Certains types de LPS ne seraient -ils pas reconnus ? Il existe cependant des mécanismes naturels d' élimination de la bactérie car lors de transferts expérimentaux de Wolbachia d' Armadillidium vulgare chez certaines autres espèces d' isopodes terrestres [ Armadillo officinalis ( Armadillidae ) , par exemple ] , la bactérie est incapable de se maintenir et de proliférer . Afin de caractériser le système immunitaire d' Armadillidium vulgare , plusieurs approches ont été mises en place pour étudier ce système au niveau cellulaire et au niveau moléculaire . Des observations en microscopie électronique , nous ont permis de caractériser les différents types d' hémocytes présents dans l' hémolymphe mais également de décrire les organes hématopoïétiques . Puis , l' étude des protéines hémocytaires et plasmatiques , par une approche en RP-HPLC nous a conduit à l' isolement et la caractérisation de deux peptides antibactériens , l' un issu des hémocytes et l' autre du plasma . Enfin , par une approche en électrophorèse bidimensionnelle , différentes protéines impliquées dans l' immunité innée ont pu être identifiées . Quelles que soient les approches utilisées , ces travaux ont toujours été réalisés chez Armadillidium vulgare porteur ou non de Wolbachia . La comparaison des résultats obtenus chez les deux types d' animaux a été effectuée pour mettre en évidence des différences au niveau de la réponse immunitaire , différences qui pourraient être imputables à la présence de la bactérie féminisante . Ce manuscrit est organisé de la manière suivante : Introduction générale Rappel des connaissance sur la réponse immunitaire des crustacés décapodes et sur les peptides antibactériens d' arthropodes Description des matériels et méthodes & 239;& 128;& 160;Exposition des résultats et discussions en quatre chapitres intitulés : Chapitre I : Cellules impliquées dans la réponse immunitaire : Approche histologique et cytologique Chapitre II : Isolement et caractérisation de l' armadillidine , peptide antibactérien issu des hémocytes . Chapitre III : Libération d' un peptide antifongique par clivage de l' hémocyanine Chapitre IV : Recherche d' effecteurs impliqués dans le système immunitaire : Approche protéomique Conclusion générale Références bibliographiques & 239;& 128;& 160;Annexes I. Wolbachia chez les arthropodes et les nématodes II . Nombre d' hémocytes circulants chez Armadillidium vulgare porteurs ou non de Wolbachia III . Comparaison des séquences protéiques d' hémocyanines et de prophénoloxydases chez différents crustacés . Rappels bibliographiques I. LA RÉPONSE IMMUNITAIRE CHEZ LES CRUSTACÉS Pour lutter contre les agents pathogènes , tels que les bactéries , les champignons ou encore les virus , les êtres vivants ont mis en place deux grands types de réponse immunitaire : une réponse immunitaire acquise et une réponse immunitaire innée ( Hoebe et al. , 2004 ) . L' immunité innée est un mécanisme de défense phylogénétiquement plus ancien , qui se trouve chez tous les organismes pluricellulaires ( Hoffmann et al. , 1999 ; Salzet , 2001 ) , y compris chez les vertébrés . Elle constitue un système de défense activable très rapidement ce qui explique qu' elle soit encore qualifiée de réponse immédiate . Elle dépend de la présence de récepteurs , principalement présents dans les cellules immunitaires et capables de reconnaître les déterminants antigéniques des micro-organismes . L' immunité acquise , ou réponse immunitaire adaptative et à mémoire , ne se manifeste que chez les vertébrés et met en jeu des mécanismes beaucoup plus complexes telle que la mémoire immunologique ( création d' un large répertoire de médiateurs de reconnaissance antigénique ) . Bien que les invertébrés ne présentent pas d' immunité acquise , de nombreuses études sur leur immunité innée ont montré qu' elle est basée sur un système de défense complexe , qui met en jeu des réactions cellulaires et humorales coordonnées . Chez les arthropodes , la cuticule constitue une première barrière physique contre les invasions de micro-organismes et les parasites potentiellement pathogènes présents dans le milieu aquatique ou terrestre . Cependant , suite à une blessure ou lors de la mue , cette barrière n' est plus étanche et les micro-organismes envahissants entrent directement dans la circulation générale puisque le système circulatoire des arthropodes est ouvert . Ainsi , les arthropodes ont développé une réponse immunitaire innée adaptée , capable de surmonter les infections , et qui implique les constituants de l' hémolymphe . Les hémocytes sont les cellules circulantes engagées dans la réponse immunitaire des crustacés et de l' ensemble des arthropodes . L' activation de ces cellules par des molécules de reconnaissances du non soi conduit à deux types de réponses intimement liées : - d' une part , des réactions purement cellulaires , telles que la phagocytose , la formation de nodules et l' encapsulation des micro-organismes pathogènes ou des corps étrangers . - d' autre part , une libération dans le plasma de molécules intervenant dans différentes réactions immunitaires telles que la mélanisation et la coagulation localisée . I.1 . Les hémocytes : hématopoïèse et fonction des hémocytes Les hémocytes des crustacés , comme ceux des autres invertébrés , sont produits dans des tissus spécialisés : les organes hématopoïétiques . La localisation et la structure de ces organes sont très variables même au sein de groupes taxonomiques proches . Ainsi , chez les homards , les crabes ou les écrevisses , ces organes prennent la forme d' une grappe de lobules couvrant l' estomac broyeur ou le coeur ( Ghiretti-Magaldi et al. , 1977 ; Johnson , 1980 ) . Chez la crevette pénaeide , ils sont formés par une extension de l' artère ophtalmique ( Martin et al. , 1987 ) . Quelle que soit la forme présentée , les organes hématopoïétiques produisent tous trois types d' hémocytes dont le lignage n' est pas clairement établi . Les organes hématopoïétiques sont donc le siège de la prolifération et de la maturation des futurs hémocytes . Une fois maturés , les hémocytes peuvent être libérés dans la circulation générale . Cette libération a lieu principalement lors des mues et lors d' infections bactériennes , deux processus qui engendrent une diminution importante du taux d' hémocytes circulants ( Smith et Ratcliffe , 1980 ; Persson et al. , 1987 ; Smith et Johnston , 1992 ) . Chez les crustacés , trois types d' hémocytes morphologiquement différents ont été identifiés dans la circulation générale ( Bauchau , 1980 ) . Ces populations d' hémocytes ont été décrites chez les décapodes ( Söderhäll et Smith , 1983 ; Vazquez et al. , 1997 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) mais aussi chez l' isopode terrestre Porcellio dilatatus ( Coutant , 1977 ) . Ainsi , la cytologie permet de distinguer les hémocytes hyalins , dépourvus de granules , les hémocytes semi-granulaires pourvus de petits granules en nombre variable , et les hémocytes granulaires pourvus de gros granules en grand nombre . Concernant la fonction de ces hémocytes , chez les crevettes , la phagocytose est effectuée par les hémocytes granulaires et semi-granulaires , tandis que les cellules hyalines jouent un rôle dans la coagulation ( Hose et al. , 1990 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) . En effet , les cellules hyalines comportent chez ces espèces moins de protéines que les 2 types granulaires et notamment moins de protéines lysosomales ( Hose et al. , 1990 ; Lanz et al. , 1993 ) . Des études similaires faites chez le crabe et les écrevisses ont montré que les hémocytes hyalins présentent également moins de protéines que les deux autres types cellulaires ( Johansson , 1999 ) . Mais contrairement aux crevettes , ce sont les hémocytes hyalins qui sont principalement impliqués dans la phagocytose , même si les hémocytes semi-granulaires peuvent également jouer ce rôle ( Thörnqvist et al. , 1994 ) . De façon plus consécutive , le rôle exact des cellules hyalines n' est pas établi avec précisions pour toutes les espèces . Les hémocytes granulaires et semi- granulaires , synthétisent puis stockent dans leurs granules les protéines du système immunitaire , comme les agglutinines , les péroxinectines , des enzymes cytolytiques , les enzymes du système prophénoloxydase , les peptides antibactériens ... Ces protéines sont alors libérées de façon coordonnée dans l' hémolymphe ou sur le site de l' infection ou de la blessure ( Smith et Söderhäll , 1983 ; Söderhäll et al. , 1985 ; Söderhäll et al. , 1986 ; Kobayashi et al. , 1990 ; Johansson et al. , 2000 ; Munoz et al. , 2002 ) . I.2 . Les phénomènes de reconnaissance Quels que soient les organismes , l' activation de la réponse immunitaire nécessite une reconnaissance des pathogènes infectants . Les crustacés sont dépourvus d' immunoglobulines , mais ils sont cependant capables de répondre à des pathogènes en reconnaissant les composants de leurs membranes ou de leurs parois cellulaires , tels que les lipopolysaccharides ( LPS ) des bactéries Gram ( - ) , les peptidoglycanes des bactéries Gram ( + ) ou les & 206;& 134; 1 , 3- glucanes des champignons . Les molécules liant spécifiquement ces motifs ont été isolées chez de nombreux arthropodes . Ces molécules , dont certaines ont été nommées molécules de reconnaissance de motif ( PRP : Pattern Recognition Protein ) , ont été décrites sous forme soluble dans la circulation ou associées aux membranes hémocytaires . Elles possèdent d' une part des propriétés permettant l' activation du système prophénoloxydase ( ProPO ) qui conduit à la mélanisation ( Sritunyalucksana et Söderhäll , 2000 ) et , d' autre part , elles jouent le rôle d' opsonine permettant l' augmentation du taux de phagocytose ( Duvic et Söderhäll , 1992 , 1993 ; Thörnqvist et al. , 1994 ) . Ces molécules ont été isolées dans le plasma de nombreux crustacés et clonées soit à partir de l' hépatopancréas comme chez Penaeus stylorostris stylorostris ( Roux et al. , 2002 ) et Penaeus vannamei ( Romo-Figueroa et al. , 2004 ) , soit à partir des hémocytes comme chez Pacifastacus leniusculus ( Lee et al. , 2000 ) et Penaeus monodon ( Sritunyalucksana et al. , 2002 ) . Les & 206;& 134; GBP sont solubles et peuvent se fixer sur des motifs de la paroi des champignons , les complexes ainsi formés se lient à un récepteur des membranes hémocytaires pour activer la réponse immunitaire ( Duvic et Söderhäll , 1992 , 1993 ) . De plus , une protéine masquerade-like , identifiée comme une PRP se liant spécifiquement aux LPS et aux & 206;& 134; GBP , a été caractérisée chez Pacifastacus leniusculus ( Lee et Söderhäll , 2001 ) . Cette protéine est une opsonine qui possède un motif d' adhésion cellulaire . Les lectines / agglutinines sont des glycoprotéines ne possédant généralement pas d' activité catalytique et qui ont la propriété de se lier aux sucres ( Marquez et Barracco , 2000 ) . Elles peuvent donc se lier aux cellules et entraîner un phénomène d' agglutination . Chez les crustacés , de nombreuses lectines sont capables de se lier à l' acide sialique . Elles ont notamment été mises en évidence dans le plasma du homard Homarus americanus ( Abel et al. , 1984 ) , du crabe Cancer antennarius ( Ravindranath et al. , 1985 ) , des crevettes Penaeus monodon ( Ratanapo et Chulavatnatol , 1990 ) et Penaeus japonicus ( Rodriguez et al. , 1995 ) . Chez la crevette d' eau douce Macrobrachium rosenbergii , une lectine a été localisée au niveau des membranes hémocytaires , contrairement aux autres lectines présentées ( Vazquez et al. , 1997b ) . Certaines de ces lectines circulantes se lient spécifiquement aux LPS , c' est le cas chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus ( Kopacek et al. , 1993a , b ) et chez la crevette Penaeus californiensis ( Vargas-Albores et al. , 1993 ) . L' agglutination résulterait de la liaison des cellules reconnues par des sites de liaisons multiples présents dans les lectines ( Gillespie et al. , 1997 ; pour revue ) . I.3 . La réponse cellulaire 3.1 . La phagocytose La phagocytose est un processus qui contribue à l' élimination de particules étrangères de petite taille comme les bactéries . Elle comporte plusieurs étapes successives incluant la reconnaissance , l' attachement , la formation de pseudopodes , l' ingestion , l' assemblage des phagosomes et la fusion avec les lysosomes . Cette dernière étape conduit à la lyse des organismes phagocytés sous l' action des multiples enzymes contenus dans les lysosomes ( Bayne , 1990 pour revue ) . Les processus de phagocytose font également intervenir des mécanismes dépendant de l' oxygène qui génèrent des ions superoxydes et de l' oxyde nitrique . L' étude du métabolisme oxydatif chez Carcinus maenas ( Bell et Smith , 1993 ) , Penaeus monodon ( Song et Hsieh , 1994 ) , Penaeus japonicus ( Bachère et al. , 1995 ) et Macrobrachium rosenbergii ( Sierra et al. , 2005 ) a montré que les hémocytes de toutes ces espèces produisaient des anions superoxydes in vitro . Chez Carcinus maenas , seuls les hémocytes hyalins produisent des résidus oxydants . Chez les vertébrés , les cellules phagocytaires produisent , lors du choc respiratoire , différents agents oxydants par l' intermédiaire de leur NADPH-oxydase membranaire . Les ions ainsi formés présentent un fort pouvoir microbicide et permettent la lyse des microorganismes envahissants ( Chanock et al. , 1994 ) . Chez Macrobrachium rosenbergii , lors des phénomènes de phagocytose , qui requièrent des mécanismes de reconnaissance des sucres ( Vazquez et al. , 1997b ) , ce choc respiratoire est fortement activé par les lectines selon un mécanisme dépendant des NADPH . Les radicaux libres ainsi générés agiraient comme des agents cytotoxiques ou microbicides ( Sierra et al. , 2005 ) . Chez les crustacés , les types d' hémocytes impliqués dans ce processus dépendent des espèces considérées . Chez le crabe Carcinus maenas et l' écrevisse Pacifastacus leniusculus , les hémocytes hyalins sont les principales cellules phagocytaires . Néanmoins des observations chez l' écrevisse ont montré que les hémocytes semi-granulaires pouvaient présenter , d' une manière très limitée , la capacité à phagocyter ( Söderhäll et al. , 1986 ) . Par contre , chez les crevettes Sicyonia ingentis et Peneaus paulensis paulensis , la phagocytose serait principalement effectuée par les hémocytes semi-granulaires , et dans une moindre mesure par les hémocytes granulaires ( Hose et Martin , 1989 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) . En effet , ces deux types cellulaires présentent des enzymes lysosomiales , alors que les hémocytes hyalins en sont dépourvus ( Gargioni et Barracco , 1998 ) . 3.2 . La formation des nodules et l' encapsulation Lorsque les bactéries sont trop nombreuses ou que le corps étranger est trop gros pour être phagocyté , l' organisme met en place une réaction adaptée qui se traduit par la formation de nodules ou par l' encapsulation . Les nodules sont des agrégats pluricellulaires d' hémocytes capables de renfermer , malgré leur petite taille , un nombre important de bactéries . De tels nodules peuvent adhérer aux tissus et les plus grands peuvent alors être encapsulés . Chez les crustacés , la première description de la formation de nodules a été donnée chez les crabes ( Smith et Ratcliffe , 1980 ; White et Ratcliffe , 1982 ) pour lesquels les nodules sont principalement localisés dans les branchies et les sinus de l' hépatopancréas . Chez le crabe Carcinus maenas , ce sont les hémocytes granulaires qui s' agrègent pour former le nodule , leur dégranulation a pu également être observée ( Smith et Ratcliffe , 1980 ) . Chez le homard Homarus americanus et chez la crevette Sicyonia ingentis , les trois types d' hémocytes participent à la formation des nodules . Toutefois , les hémocytes semi-granulaires semblent jouer un rôle prépondérant , ils sont situés au centre des nodules , présentent une diminution de leur contenu en granules et semblent jouer un rôle dans la phagocytose des bactéries emprisonnées . Lorsqu' ils atteignent une taille suffisante , ces nodules sont alors retenus dans les vaisseaux des branchies par le système de filtration ( néphrocytes ) ( Martin et al. , 1998 ) . La présence de corps étranger de taille plus importante qu' une bactérie conduit à la formation d' une capsule d' hémocytes formée de couches concentriques autour des intrus . Les enzymes contenues dans les granules sont alors libérées à la surface des particules exogènes encapsulées et des zones de mélanisation sont observables au niveau des capsules . Chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus ( Kobayashi et al. , 1990 ) et chez la crevette Sicyonia ingentis ( Hose et Martin , 1989 ) , les cellules engagées dans la formation des nodules et dans l' encapsulation sont principalement les hémocytes semi-granulaires qui peuvent stimuler les cascades de mélanisation . Chez l' écrevisse , les péroxinectines ( protéines d' adhésion cellulaire ) , libérées par les deux types d' hémocytes granulaires , peuvent induire le processus d' encapsulation in vitro ( Kobayashi et al. , 1990 ) . Le phénomène d' encapsulation a également été décrit chez l' isopode terrestre Porcellio dilatatus ( Coutant , 1977 ) . I.4 . La réponse humorale 4.1 . La coagulation Chez les vertébrés comme chez les invertébrés , le système de coagulation est une réaction importante qui permet d' éviter les pertes de sang lors des blessures . Figure 1 : Schéma de la réaction de coagulation médiée par la transglutaminase chez l' écrevisse et du rôle potentiel de l' & 206;& 133; 2- macroglobuline . Les protéines de coagulation sont présentes dans le plasma sous forme dimérique ( 2 X 210 kDa ) liées par un pont disulfure ( S- S ) . Elles s' associent entre elles sous l' action d' une transglutaminase pour former des agrégats de coagulation ( d' après Söderhäll et Söderhäll. , 2001 ) . Différentes protéines de coagulation ont été partiellement caractérisées chez les crustacés décapodes tels que Penaeus monodon ( Yeh et al. , 1998 ; Yeh et al. , 1999 ) , Homarus americanus ( Fuller et Doolittle , 1971a ) , Panulirus interruptus ( Fuller et Doolittle , 1971b ; Doolittle et Riley , 1990 ) , Pacifastacus leniusculus ( Kopacek et al. , 1993a , b ) et chez Ibacus ciliatus ( Komastu et Ando , 1998 ) . Chez l' écrevisse , les protéines de coagulation sont des glycoprotéines de masse moléculaire élevée ( > 200 kDa ) qui sont présentes , dans le plasma , sous forme monomérique ou dimérique ( Hall et Söderhäll , 1994 ; Yeh et al. , 1999 ) . Ces protéines sont produites dans l' hépatopancréas des animaux et sont libérées dans la circulation générale où leur concentration peut être élevée ( Hall et al. , 1999 ) . Elles présentent des homologies avec les vitellogénines , protéines qui ne semblent pas impliquées dans les phénomènes de coagulation ( Sappington et Raikhel , 1997 ) mais qui contribuent à la maturation des ovocytes chez les femelles et les néofemelles . Les protéines de coagulation sont elles présentes à la fois chez les mâles et les femelles . Chez l' écrevisse où le mécanisme de coagulation est le mieux décrit ( Figure 1 ) , la coagulation dans le plasma se traduit par la polymérisation des homodimères de protéines de coagulation . Cette réaction est catalysée par une transglutaminase dépendante du Ca 2 + . Cette enzyme , principalement produite dans les hémocytes ( Wang et al. , 2001 ) , est libérée dans le plasma suite à une blessure ou une infection microbienne pour former de longues chaînes ou des agrégats de protéines de coagulation ( Kopacek et al. , 1993a ) . Cette enzyme crée alors des liaisons covalentes entre les chaînes latérales d' une lysine et d' une glutamine portées par la protéine de coagulation ( Kopacek et al. , 1993a ; Hall et al. , 1999 ) . Les & 206;& 133; 2- macroglobulines d' écrevisses présentent des résidus lysine et glutamine libres , qui sont probablement utilisés par les transglutaminases pour lier les & 206;& 133; 2- macroglobulines ( inhibiteur de protéases ) aux protéines de coagulation . La présence des & 206;& 133; 2- macroglobulines dans les agrégats de coagulation permettrait alors d' inhiber l' action des protéases produites par les micro-organismes pathogènes ( Hall et Söderhäll , 1994 ) . Figure 2 : Schéma du système prophénoloxydase ( ProPO ) chez l' écrevisse . Les signatures moléculaires ( en vert ) des microorganismes infectants sont reconnues et se lient aux PRP ( en orange ) . Les complexes sont reconnus par des récepteurs membranaires situés sur la membrane des hémocytes , la cascade de signalisation est alors activée . Les enzymes du système ProPO ( en rouge ) contenues dans les granules sont libérées dans l' hémolymphe et sont activées pour conduire à la formation de mélanine . Lors de l' activation , d' autres protéines sont activées , notamment les facteurs d' adhésion cellulaire ( péroxynectine , masquerade , en jaune ) mais aussi les inhibiteurs des sérines protéases ( pacifastine et & 206;& 133; 2- macroglobuline en bleu ) qui régulent la cascade de mélanisation ( d' après Söderhäll et Söderhäll , 2001 ) . 4.2 . Activité phénoloxydase et mélanisation : Le système Prophénoloxydase ( ProPO ) Chez les crustacés , et plus largement chez les arthropodes , après des blessures ou des infections , une pigmentation sombre apparaît progressivement au niveau des lésions . Ce phénomène est appelé mélanisation . Chez les arthropodes , la voie de synthèse de la mélanine est impliquée aussi bien dans les processus de sclérose et de cicatrisation des blessures que dans les réactions de défense ( au niveau des nodules et des capsules en formation ) contre les microorganismes envahissant l' hémolymphe ( Söderhäll , 1982 ; Ratcliffe et al. , 1985 ; Sugumaran , 1996 ) . La formation de mélanine est directement associée à l' activation du système prophénoloxydase ( ProPO ) qui met en jeu une oxydoréductase , nommée phénoloxidase ( PO ) ( Figure 2 ) . Cette enzyme , liant le cuivre , catalyse à la fois l' o-hydroxylation des monophénols et l' oxydation des phénols en quinones ( Sugumaran , 1996 ) . La PO est la dernière enzyme du système ProPO et est présente chez les arthropodes et de nombreux invertébrés ( Ashida , 1990 ; Söderhäll et al. , 1996 ) . L' activation de cette cascade ProPO est induite par de très faibles quantités de déterminants antigéniques microbiens ( Söderhäll , 1982 ; Sugumaran et Kanost , 1993 ) . Ainsi , chez l' écrevisse , chez laquelle le système ProPO est le mieux caractérisé , la reconnaissance des & 206;& 134; 1 , 3- glucanes par les & 206;& 134;GBP conduit à la libération dans le plasma de toutes les enzymes du système ProPO stockées sous une forme inactive dans les granules des hémocytes granulaires ( Johansson et Söderhäll , 1985 ) et dans une moindre mesure dans les hémocytes semi- granulaires ( Cerenius et Söderhäll , 2004 ) . La cascade de sérine protéases est activée et permet ensuite l' activation d' une autre sérine protéase , la prophénoloxidase activating activating protein ( ppA ) ( Wang et al. , 2001 ) qui va alors activer la dernière enzyme : la PO . Récemment , une sérine protéase du type masquerade-like a été isolée chez Pacifastacus leniusculus . Cette protéine possède un domaine de liaison aux bactéries ( Lee et Söderhäll , 2001 ) , aux levures mais également aux hémocytes ( Huang et al. , 2000 ) . La catalyse des phénols en présence d' oxygène par la PO produit de nombreux intermédiaires toxiques ( quinones fortement réactives ) . C' est pourquoi , ce système ProPO doit être contrôlé et régulé pour ne pas léser les cellules de l' animal . Le premier niveau de contrôle a lieu dans le système ProPO lui-même qui nécessite un clivage enzymatique pour libérer des enzymes actives . Afin d' éviter une activation prématurée ou excessive du système ProPO , la présence d' inhibiteurs de protéases constitue un deuxième niveau de contrôle . Chez l' écrevisse , certaines de ces protéines ont été isolées et leurs mécanismes de régulation du système ProPO commencent à être mieux compris . Par exemple , la pacifastine , inhibitrice de la ppA , est une protéine hétérodimérique ( 155 kDa ) qui possède trois lobes de type transferrine ( un lobe peut comporter plusieurs domaines ) et une chaîne légère ( 44 kDa ) qui est la sous-unité inhibitrice composée de 9 domaines inhibiteurs riches en cystéines ( Liang et al. , 1997 ) . Ces domaines sont homologues de trois inhibiteurs de protéases ( de faibles masses moléculaires ) isolés chez Locusta migratoria ( Kellenberger et al. , 1995 ) . Différents domaines pourraient être des inhibiteurs spécifiques de différentes protéases . Il existe d' autres inhibiteurs de protéases dans le plasma des crustacés qui présentent des capacités à réduire l' activité ( 1 ) de la ppA tels que les & 206;& 133;- macroglobulines ( Spycher et al. , 1987 ; Hergennahn et al. , 1988 ; Stöcker et al. , 1991 ; Gollas-Galvan et al. , 2003 ; Rattanachai et al. , 2004 ) ou les serpines ( Liang et Söderhäll , 1995 ) , ( 2 ) des sérine protéases de manière non ciblée ( Johansson et al. , 1994 ; Liang et Söderhäll , 1995 ) . 4.3 . Le rôle de l' hémocyanine Chez les arthropodes et a fortiori chez les crustacés , l' hémocyanine est une grosse protéine multimérique qui possède deux sites de liaison au cuivre et qui a pour rôle principal de transporter l' oxygène dans l' hémolymphe . L' hémocyanine est une protéine produite dans l' hépatopancréas et libérée dans le plasma pour assurer rôle de transporteur d' oxygène qui ne semble cependant pas être son unique fonction . En effet des découvertes récentes suggèrent que l' hémocyanine serait impliquée dans la défense contre les parasites et dans la cicatrisation . Chez les arthropodes , les hémocyanines sont très proches des PO ( d' un point de vue structural et fonctionnel ) puisqu' il a été montré qu' elles pouvaient produire une activité PO sur des substrats o-diphénoliques suite à différents traitement tels qu' une exposition aux détergents ou aux sels ( Zlateva et al. , 1996 ; Decker et al. , 2001 ; Pless et al. , 2003 ) . Récemment , l' activité PO de l' hémocyanine d' une crevette a été produite in vitro par l' ajout de & 206;& 134; 1 , 3- glucanes et de lysats hémocytaires ( Adachi et al. , 2003 ) . Ces premiers résultats semblent indiquer que l' hémocyanine pourrait participer à la mélanisation des microbes . 4.4 . Les mécanismes de communication et de régulation de la réponse immunitaire Les réactions cellulaires et par voie de fait la réponse humorale sont modulées par des molécules capables d' adhérer à la surface des cellules immunitaires . Les travaux réalisés sur l' écrevisse Pacifastacus leniusculus par l' équipe de Söderhäll ont permis de relier les différents mécanismes observés . Ainsi , des molécules de communication cellulaire impliquées dans l' activation et la coordination des différents éléments de la réponse immunitaire ont pu être identifiées . Comme nous l' avons vu précédemment , lors d' infections microbiennes , les déterminants antigéniques polysaccharidiques sont reconnus par des protéines de reconnaissance , qui sont considérées comme des protéines de communication cellulaire ( Söderhäll et Häll , 1984 ) . Chez Pacifastacus leniusculus , deux de ces protéines ont été caractérisées , une & 206;& 134; GBP ( Duvic et Söderhäll , 1990 ; Cerenius . et al. , 1994 ) et une péroxynectine ( Johansson et Söderhäll , 1988 ; Johansson et al. , 1995 ) . La protéine de reconnaissance la mieux caractérisée est la & 206;& 134; GBP qui en présence de & 206;& 134;- glucanes vient s' adhérer à la membrane des hémocytes , pour stimuler les cellules hémocytaires ( Barracco et al. , 1991 ; Thörnqvist et al. , 1994 ) . Chez l' écrevisse , la & 206;& 134; GBP contient un motif RGD , également caractéristique des molécules d' adhésion cellulaire des vertébrés permettant leur liaison aux intégrines ( Sonnenberg , 1993 ) . La liaison du complexe ( & 206;& 134; GBP / microbe ) au récepteur au niveau de ce motif n' a toutefois pas été démontrée . La péroxynectine présente à la fois des propriétés d' adhésion cellulaire ( Johansson et Söderhäll , 1988 ) et une activité péroxydasique ( Johansson et al. , 1995 ) . La péroxynectine possède un motif conservé KDG qui est connu pour lier les ligands du type « intégrine-like » . Dans les hémocytes de Pacifastacus leniusculus , une intégrine & 206;& 134; a été caractérisée ( Holmblad et Söderhäll , 1997 ) . Lors de tests préliminaires en ELISA , Johansson et collaborateurs ( 1999 ) ont montré que cette intégrine est capable de se lier à la péroxynectine . Le complexe enzymatique NAPDH oxydase lié à la membrane plasmique des hémocytes produit à partir de l' oxygène moléculaire , des ions superoxydes O2- qui sont utilisés par la SOD extracellulaire pour produire du peroxyde d' hydrogène ( H2O2 . ) . Ce peroxyde est réutilisé par la péroxinectine pour produire des composés , comme l' acide hypochloreux , qui sont toxiques pour les microorganismes envahisseurs ( Figure 3 ) . Certains microbes ayant à leur surface une SOD ou une catalase ( Thörnqvist et Söderhäll , 1997 ) peuvent réduire de façon efficace le système précédemment décrit . Figure 3 : Modèle d' interaction entre les péroxynectines , les superoxydes dismutases ( EC- SOD ) et les intégrines sur le site d' infection microbien chez l' écrevisse . Les cellules hémocytaires sont attachées aux microorganismes par l' intermédiaire de leur recepteur intégrine et de la péroxynectine . Le complexe enzymatique NADPH-oxydase produit des ions superoxyde O2- qui sont utilisés par la SOD extracellulaire pour produire du peroxyde d' hydrogène H2O2 ; ce composé est utilisé par la péroxynectine pour produire de l' acide hypochloreux HOCl , qui est toxique pour les micro-organismes envahissants ( d' après Söderhäll et Söderhäll , 2001 ) . 4.5 . Les facteurs antimicrobiens Chez les crustacés , la contribution des peptides antibactériens dans les mécanismes de défense a été , pendant longtemps , uniquement suspectée . En effet , des activités antibactériennes avaient été observées dans le plasma ( Stewart et Zwicker , 1972 ) et dans l' hépatopancréas ( Mori et Stewart , 1978 ) de Homarus americanus . Par contre , l' absence d' activité dans le plasma du crabe Carcinus maenas , même après une infection bactérienne avait amené certains auteurs ( White et al. , 1985 ) à suggérer que chez les crustacés , l' élimination des organismes pathogènes du plasma était plus probablement réalisée par phagocytose que par l' action de facteurs antimicrobiens présents dans le plasma . Cependant , Chisholm et Smith ( 1992 ) ont montré que les activités antimicrobiennes trouvées dans les lysats des hémocytes de Carcinus maenas n' étaient pas dues aux agglutinines ( facteurs de coagulation ) , ni associées au système de la prophénoloxydase ( ProPO ) , ce qui renforça l' idée de l' existence de facteurs antibactériens . Des observations similaires ont été faites chez de nombreuses autres espèces de crustacés , et dans ces dernières années , différents peptides antibactériens ( dont l' un de 11 , 5 kDa ) ont été extraits des hémocytes des crabes Carcinus maenas ( Schnapp et al. , 1996 ) et Callinectes sapidus ( Khoo et al. , 1999 ) . Toutefois , la caractérisation de ces peptides a été réalisée de façon partielle . Par contre , une famille de peptides à activité antifongique et antibactérienne a été isolée dans les hémocytes de la crevette Penaeus vannamei , et nommée pénaeidine ( Destoumieux et al. , 1997 ) . Ainsi en 2001 , au début de nos travaux , seules les pénaedines avaient été caractérisées . Aujourd'hui , la recherche de peptide antibactériens chez les crustacés a conduit à l' isolement de différents peptides . Les pénaeidines ont été retrouvées dans toutes les espèces de crevettes testées [ Litopenaeus setiferus ( Gross et al. , 2001 ) , Penaeus japonicus ( Rojtinnakorn et al. , 2002 ) , Peneaus monodon ( Supungul et al. , 2002 ) , Litopenaeus stylirostris ( Munoz et al. , 2004 ) , Fenneropenaeus chinensis ( Kang et al. , 2004 ) et Litopenaeus setiferus ( Cuthbertson et al. , 2004 ) ] , et différentes classes de cette famille de peptides antibactériens ont été caractérisées . Des homologues du peptide de 11 , 5 kDa isolé précédemment chez Carcinus maenas ont également été caractérisés chez deux espèces de crevettes , Penaeus vannamei et Litopenaeus setiferus ( Barlett et al. , 2002 ) . Récemment , un peptide antimicrobien nommé ALF ( anti-lipopolysaccharide factor ) a été caractérisé chez Penaeus modon ( Somboonwiwat et al. , 2005 ) . Ce peptide , homologue de l' ALF caractérisé chez la limule ( Morita et al. , 1985 ) présente la particularité de se lier au LPS . Chez la limule , la liaison de l' ALF au LPS inhibe la cascade de dégranulation des hémocytes . Chez la crevette , l' ALF présente un spectre d' activité très large [ bactéries Gram ( - ) , bactéries Gram ( + ) et champignons ] . Toutes ces études ont été principalement menées sur des espèces qui présentent un intérêt économique dans le domaine de l' aquaculture : en effet , l' isolement de peptides antibactériens efficaces contre des pathogènes des crevettes pénaeides faciliterait la lutte contre les épidémies dans les élevages . Tous les peptides antimicrobiens décrits précédemment ont été isolés dans les hémocytes de différentes espèces . Toutefois , ces cellules ne sont pas l' unique source de peptides antimicrobiens chez les crustacés . En effet , chez les crevettes Penaeus vannamei et Penaeus stylorostris stylorostris et chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus , des peptides antibactériens ont été isolés à partir du clivage de l' hémocyanine circulante ( Destoumieux-Garzon et al. , 2001 ; Lee et al. , 2003 ) . Chez Pacifastacus lenisculus , il semble que la libération de ces peptides soit générée par l' action d' une cystéine protéase contenue dans les hémocytes et libérée dans le plasma suite à une induction de la réponse immunitaire ( Lee . et al. , 2003 ) . Enfin , l' hémocyanine possède également des propriétés antivirales ( Zhang et al. , 2004 ) . Chez les invertébrés , les lysozymes ont été décrits comme des composants du système immunitaire , fonctionnant comme des protéines antimicrobiennes ( Yu et al. , 2002 ; pour revue ) . Chez les crustacés , l' activité de ces lysozymes a été montrée chez Artemia franciscina ( Hultmark , 1996 ) et Penaeus vannamei ( Sotelo-Mundo et al. , 2003 ) . II . LES PEPTIDES ANTIMICROBIENS CHEZ LES ARTHROPODES L' étude des peptides antibactériens a réellement débuté dans les années 1980 , quand l' équipe de Boman injecta de faibles doses de germes pathogènes à des pupes de Hyalophora cecropia ( Insecte , lépidoptère ) et observa , en retour , une synthèse rapide de plusieurs peptides ( Steiner et al. , 1981 ) . Suite à ces travaux , de nombreux peptides furent isolés et caractérisés , notamment chez d' autre lépidoptères et chez la drosophile ( Insecte , diptère ) . Par la suite , la recherche de peptides antibactériens s' est généralisée non seulement à l' ensemble des arthropodes , mais également chez d' autres invertébrés ( Hetru et al. , 1994 ) , les vertébrés ( Boman , 1995 ) et les plantes ( Broakaert et al. , 1995 ) . Actuellement , plus de 880 peptides antimicrobiens ont été isolés dans divers tissus et types cellulaires de nombreux invertébrés , vertébrés , plantes et même chez des bactéries ( Zasloff , 2002 ; Ganz , 2003 ; Lehrer , 2004 ) . II.1 . Classification des peptides antimicrobiens La caractérisation de ces peptides chez ces nombreuses espèces d' invertébrés a permis de mettre en évidence des caractéristiques communes à l' ensemble de ces molécules . Ce sont des peptides ou polypeptides à forte activité antibactérienne et à large spectre d' activité . En général , les peptides antibactériens sont de petites molécules cationiques , souvent amphiphiles , qui peuvent interagir avec les phospholipides des membranes bactériennes . Ces interactions leur permettent de perturber les équilibres membranaires qui peuvent conduire à la lyse des bactéries en formant des pores dans les membranes bactériennes . D' autres peptides antibactériens peuvent entraîner une inhibition de la biosynthèse des membranes des micro-organismes ( Shai , 1999 ; pour revue ) . Ces peptides peuvent ainsi tuer ou inhiber la croissance de la plupart des microorganismes testés , bactéries ou champignons . Sur la base de leurs caractéristiques structurales , les peptides antibactériens ont été classés en deux grands groupes . - Les peptides cycliques présentant des cystéines impliquées dans la formation de ponts disulfures . - Les peptides linéaires , eux-mêmes divisés en trois groupes : les peptides basiques formés d' hélices & 206;& 133; , les peptides riches en Proline et les peptides riches en Glycine . Les peptides cycliques De nombreux peptides antimicrobiens contiennent des paires de résidus cystéines qui sont oxydés pour former des ponts disulfures , généralement de 1 à 4 . Toutefois , un peptide antifongique contenant 12 résidus cystéines engagés dans 6 ponts disulfures a été isolé chez Mytilus edulis ( mollusque ) ( Charlet et al. , 1996 ) . Ces peptides forment , en solution , des structures en feuillets & 206;& 134; ( défensines de vertébrés ) ou en « & 206;& 134;-hairpin like » structure ( thanatine , androctonine , gomesine , tachyplésine ) ou encore en hélice & 206;& 133; / & 206;& 134;-sheet ( défensines d' invertébrés ) ( Bulet et al. , 1999 ; Bulet et al. , 2004 ; pour revues ) . Les feuillets & 206;& 134; « hairpin -like » avec 1 pont disulfure Chez les arthropodes , les thanatines , isolées dans le corps gras de l' insecte hémiptère Podisus maculiventris ( Fehlbaum , 1996 ) est le seul représentant de cette classe de peptides antimicrobiens . Ce peptide ne présente pas d' homologie avec les autres peptides d' insectes , par contre il possède jusqu'à 40 % d' homologie avec certains peptides antibactériens isolés chez des grenouilles . Ce peptide a l' un des plus grands spectres d' activité contre des pathogènes , couvrant les bactéries Gram ( - ) et Gram ( + ) , les champignons et les levures . Les feuillets & 206;& 134; « hairpin -like » avec 2 ponts disulfures Les premiers peptides , isolés chez les arthropodes et présentant deux ponts disulfures sont les tachyplésines et les polyphémusines , ils ont été isolés chez les limules ( chélicérates ) Tachypleus tridentatus et Limulus polyphemus polyphemus respectivement ( Kawabata et al. , 2003 ; pour revue ) . Ces deux peptides présentent un spectre d' activité large contre les bactéries Gram ( - ) , Gram ( + ) , les levures et dans une moindre mesure contre les champignons filamenteux . Deux autres peptides antimicrobiens contenant deux ponts disulfures ont été isolés chez deux autres espèces de chélicérates : l' androctonine chez le scorpion Androctonus australis ( Ehret- Sabatier et al. , 1996 ) et la gomésine chez l' araignée Acanthoscuria gomesina ( Silva et al. , 2000 ) . Le spectre d' activité de ces deux peptides est très large , et s' étend de l' ensemble des bactéries aux levures . Les androctonines ne présentent pas d' activité hémolytique sur les érythrocytes . Par contre , les gomésines en présentent une très faible alors que les tachyplesines possèdent cette activité de façon très intense ( Bulet et al. , 2004 ; pour revue ) . Les feuillets & 206;& 134; « hairpin-like avec trois / quatre ponts disulfures Les peptides possédant trois ou quatre ponts disulfures constituent la famille des défensines . Dans cette famille , probablement la plus représentée , plus de 70 défensines ont été isolées chez les arthropodes de différents groupes de taxons , comme les insectes , les tiques , la limule , les araignées et les scorpions ( Dimarcq et al. , 1998 ; Bulet et al. , 1999 ; Iwanaga , 2002 ) , et par extension certains crustacés décapodes ( Destoumieux et al. , 1997 ) . La classification en sous familles des défensines d' invertébrés est basée sur leurs propriétés biologiques , antibactériennes et/ou antifongiques . Les défensines d' invertébrés sont principalement actives contre les bactéries à Gram ( + ) , leur activité est nettement plus limitée contre les bactéries Gram ( - ) et les champignons . L' activité antifongique des défensines n' a été caractérisée que pour quatre peptides ( tous isolés dans la classe des insectes ) , la drosomycine chez Drosophila melanogaster , l' héliomicine chez Heliothis virescens , la termicine de Pseudacanthothermes spiniger et la gallerimycine chez Galleria mellonella mellonella . Chez les invertébrés , deux types d' appariement des cystéines impliquées dans les ponts disulfures avaient été décrits , l' un d' entre eux est uniquement observé dans la séquence de la drosomycine . Récemment , un troisième type d' appariement des cystéines a été mis en évidence chez le bivalve Mytilus galloprovincialis ( Bulet et al. , 2004 ; pour revue ) . Les peptides antimicrobiens , isolés chez les différentes espèces de crevettes pénaeides , présentent six cystéines impliquées dans trois ponts disulfures , ce qui les classe dans la famille des défensines , cependant ces peptides possèdent également une région riche en proline à leur extrémité N-terminale ( Destoumieux et al. , 1997 ) . La structure tridimensionnelle de plusieurs défensines a été déterminée , elle consiste en un domaine en hélice & 206;& 133; et deux feuillets & 206;& 134; antiparallèles ( & 206;& 133;& 206;& 134;& 206;& 134; ) , stabilisés par deux ponts disulfures sur les feuillets & 206;& 134;. Les peptides linéaires L' absence de ponts disulfures est la caractéristique des trois familles qui composent ce large groupe de peptides dits linéaires . Les peptides à hélices amphipathiques Cette famille est très diversifiée et inclus les peptides trouvés dans un grand nombre d' organismes éloignés d' un point de vue évolutif . Chez les insectes , ces peptides sont produits dans le corps gras , les hémocytes et certains épithéliums . Ils présentent un spectre d' activité très large qui n' est pas restreint aux pathogènes ( bactéries Gram ( - ) , bactéries Gram ( + ) , champignons et protozoaires ) . En effet , certains de ces peptides sont hémolytiques tandis que d' autres sont de bons insecticides ( Bulet et al. , 2004 ; pour revue ) . Le premier membre de cette famille , qui est aussi le premier peptide découvert ( Steiner et al. , 1981 ) est une cécropine , isolée chez Hyalophora cecropia . Aujourd'hui , plus de 60 cécropines et peptides apparentés aux cécropines ont été caractérisés chez les diptères et les lépidoptères . Ces peptides sont composés de 29 à 42 acides aminés et possèdent deux caractéristiques majeures ( 1 ) la présence d' un résidu tryptophane en position 1 ou 2 ( 2 ) un résidu amidé en C-terminal . L' absence de tryptophane , observé chez certaines cécropines ( Bombyx cécropine D ) et celles des moustiques semble entraîner une action préférentielle des peptides contre les bactéries à Gram ( + ) et contre les levures ( Bulet et al. , 2004 ; pour revue ) . D' autres peptides à hélice & 206;& 133; ont été isolés dans les glandes à venins d' arthropodes . Ainsi , les mélittines et les crabolines sont respectivement les composés majoritaires du venin d' abeille et du frelon européen ( Krishnakumari et Nagaraj , 1997 ) . Dans les glandes à venin de la fourmi Pachycondylas gaeldii , une famille de 15 molécules , les ponéricines , a été caractérisée ( Orivel et al. , 2001 ) . Ces peptides présentent 60 % d' homologie avec les cécropines mais ne sont pas amidés en C-terminal . Enfin , des peptides à hélices & 206;& 133; ont été isolés chez différentes espèces d' araignées , ils présentent des activités antimicrobiennes , hémolytiques et insecticides très élevées ( Mor et al. , 1991 ; Corzo et al. , 2002 ; Kuhn-Nentwig et al. , 2002 ) . Certains peptides adoptant une hélice & 206;& 133; mais ne présentant pas d' homologies avec les cécropines ont été isolés chez un diptère et un isoptère . La particularité de ces peptides est qu' ils sont synthétisés constitutivement dans l' intestin antérieur pour Stomoxys calcitrans calcitrans ( Boulanger et al. , 2002 ) et dans les hémocytes chez Pseudacanthotermes spiniger ( Lamberty et al. , 2001 ) . Les peptides riches en résidus prolines Ils sont caractérisés par un grand nombre de résidus proline et ont été principalement isolés chez les insectes . Ils comptent de 15 à 39 résidus et sont essentiellement actifs contre les bactéries à Gram ( - ) . Cette famille est divisée en deux sous-groupes , les peptides non substitués et les peptides o-glycosylés . Les peptides antimicrobiens sans substitution sont représentés par la famille des apidaecines , isolée initialement chez l' abeille Apis mellifera ( Casteels et al. , 1989 ) . Actuellement , différents peptides homologues des apidaecines ont été isolés chez des lépidoptères mais également chez les hémiptères , chez qui ces peptides ont été nommés métalnikowines ( Bulet et al. , 1999 ; pour revue ) . Une autre famille de peptides , les abaecines , a été mise en évidence chez l' abeille . Ces peptides d' hyménoptères présentent des similarités structurales avec deux autres classes de peptides antimicrobiens , les métalnikowines et les lébocines isolées chez la drosophile Drosophila melanogaster ( Levashina et al. , 1995 ) et le ver à soie Bombyx mori ( Hara et Yamakawa , 1995 ) , respectivement . Il existe notamment une séquence consensus ( Pro-Phe-Asn-Pro ) dans la pertie C-terminale , entre les abaecidines et les metalnikowines . Les peptides o -glycosylés sont représentés par la drosocine , isolée chez Drosophila melanogaster . C' est un peptide de 19 acides aminés , contenant 6 prolines et 4 arginines impliquées dans un triplet ( Pro-Arg-Pro ) répété trois fois . Ce peptide porte sur la thréonine 11 une o-glycosylation ( disaccharide ) . Cette caractéristique a depuis été montrée chez d' autres insectes : ( 1 ) hémiptères [ pyrrhocoricine chez Pirrhocoris apterus ( Cociancich et al. , 1994 ) ] , ( 2 ) lépidoptères [ lebocines chez Bombyx mori ( Hara et Yamakawa , 1995 ) ] , ( 3 ) hyménoptères [ formaecines chez Myrmecia gulosa ( Mackintosh et al. , 1998 ) ] . La nature des sucres impliqués dans la glycosylation est variable et ils peuvent être mono ou disaccharidiques . Les peptides riches en proline , qui jusque là n' avaient été isolés uniquement que chez les insectes , ont été trouvés chez deux espèces de crustacés . Le premier , isolé chez le crabe Carcinus maenas , présente le motif Pro-Arg-Pro-Pro caractéristique des peptides riches en proline d' insectes , cependant ce peptide partage plus d' homologies avec la bacténécine 7 bovine ( Schnapp et al. , 1996 ) . Chez les crevettes pénaeides , la famille des pénaeidines ( décrite précédemment ) est constituée de quatre classes de peptides qui sont riches en proline dans leur région N-terminale ( présence de cystéines en C-terminal ) ( Bachère et al. , 2004 ) . Les peptides riches en résidus glycines Les peptides riches en glycine ont d' abord été isolés chez différentes espèces d' insectes ( diptères , lépidoptères , hyménoptères , coléoptères et hémiptères ) . Leur classification au sein de cette même famille est due à leur nombre élevé en résidus glycine . Ces peptides , dont les tailles sont très variables , ne présentent pas d' homologies de séquence entre eux . Ce regroupement rend donc cette famille de peptides très hétérogène . Toutefois , ces peptides sont essentiellement actifs contre les bactéries Gram ( - ) et les champignons . Les sarcotoxines ( Ando et Natori , 1988 ) et les diptéricines ( Dimarcq et al. , 1988 ) possèdent à leur extrémité N-terminale un court domaine riche en prolines et à leur extrémité C-terminale un long domaine riche en glycines . Ce dernier domaine est également retrouvé chez les attacines ( Hultmark , 1993 ) . Certaines de ces molécules sont modifiées post-traductionnellement ( 1 ) par une amidation à leur extrémité C- terminale ( 2 ) par une glycosylation ( Hetru et al. , 1998 ; pour revue ) . Si des sites de glycosylation ont été observés dans les régions riches en prolines des sarcotoxines et des diptéricines , seules ces dernières se sont révélées o-glycosylées ( au niveau de deux domaines structuraux ) . Ces peptides présentent un effet bactériostatique sur les bactéries Gram ( - ) . D' autres peptides riches en glycines se caractérisent par leur activité bactériolytique , comme les hyménoptaecines d' Apis mellifera ( Casteels-Josson et al. , 1993 ) . Enfin , récemment des peptides riches en glycine ont été isolés chez l' araignée Acanthoscurria gomesiana gomesiana ( Lorenzini et al. , 2003 ) et la crevette Penaeus monodon ( Somboonwiwat et al. , 2005 ) . Les séquences des acanthoscurrines présentent le taux connu le plus important de résidus glycine ( 73 % ) . De plus , ces peptides sont constitués de trois répétitions du motif GGGGL et sont amidés à leur extrémité C- terminale . Ces peptides sont actifs contre les bactérie Gram ( - ) et les champignons . II.2 . Protéines présentant une activité antimicrobienne annexe Récemment , des activités antibactériennes ont été mises en évidence pour des protéines qui initialement présentaient d' autres fonctions . La production de peptides antimicrobiens , générés par clivage enzymatique ( hydrolyse ) à partir de grosses protéines , a été rapportée chez les invertébrés ( Tasiemski et al. , 2000 ; Destoumieux- Garzon et al. , 2001 ; Lee et al. , 2003 ) et les vertébrés ( Bellamy et al. , 1992 ) . 2.1 . L' hémocyanine L' hémocyanine est la protéine majoritaire du plasma des crustacés et a pour fonction initiale de transporter l' oxygène dans l' organisme . Chez les crevettes Penaeus vannamei et Penaeus stylorostris et l' écrevisse Pacifastacus leniusculus l' hémocyanine est clivée dans sa partie C-terminale pour générer un peptide antimicrobien ( Destoumieux-Garzon et al. , 2001 ; Lee et al. , 2003 ) . Ainsi , chez les crevettes , trois peptides antifongiques ont été isolés et caractérisés . Ces peptides présentent des masses moléculaires de 2 , 7 kDa chez Penaeus vannamei tandis que les deux peptides générés chez Penaeus stylorostris présentent des masses de 7 , 9 et 8 , 3 kDa . Ces peptides , contrairement à la majorité des peptides antimicrobiens connus , sont anioniques avec un pI calculé de 5 , 6 à 6 , 5 pour des pH physiologiques . La production des ces peptides est stimulée par une infection microbienne ( Destoumieux-Garzon et al. , 2001 ) . Leur apparition dans le plasma correspond à la libération massive des pénaedines résultant de la lyse des hémocytes ( Destoumieux et al. , 2000b ) . Cependant , les mécanismes responsables du clivage de l' hémocyanine n' ont pas encore été décrits . Chez Pacifastacus leniusculus , le peptide de 1945 Da , issu du clivage de l' hémocyanine , est un peptide cationique qui ne possède pas de cystéine . L' activité antimicrobienne de ce peptide est dirigée contre les bactéries à Gram ( - ) et à Gram ( + ) . Le clivage de l' hémocyanine est induit lors d' infections par du LPS ou des & 206;& 134; 1 , 3 - glucanes . Le clivage de ce peptide est probablement réalisé par une réaction enzymatique , attribuée chez l' écrevisse , à une cystéine protéase . L' utilisation de protéines très abondantes et disponibles dans le plasma comme source de peptides antibactériens doit avoir lieu chez des animaux dont la réponse à l' infection est très rapide . Ce mécanisme consomme probablement peu d' énergie et pourrait provenir d' un mécanisme plus ancien . Produits dans les premières phases de la réponse immunitaire , ces peptides pourraient opérer comme des modulateurs de l' immunité ( Bachère et al. , 2004 ) . 2.2 . La proppA Chez Pacifastacus leniusculus , la proppA , sérine protéase du système ProPO , présente dans son clip-domaine une activité antibactérienne dirigée contre les bactéries Gram ( + ) in vitro ( Wang et al. , 2001 ) . Ce clip domaine présente une région homologue aux défensines et serait libéré sous l' action de la ppA . II.3 . Mode d' action des peptides antibactériens Les mécanismes d' action des peptides antimicrobiens cationiques constituent un sujet de recherche privilégié actuellement . Les connaissances , acquises ces dernières années , sont parfois controversées mais toutes s' accordent sur le fait que tous les peptides antimicrobiens déstabilisent sélectivement les membranes mais également que l' arrangement structural amphipathique doit jouer un rôle important dans ce mécanisme . Les peptides antimicrobiens ou de reconnaissance du soi , qui sont généralement fortement basiques , semblent reconnaître les phospholipides acides exposés à la surface des membranes bactériennes ( Tytler et al. , 1995 ) . Les propriétés physico-chimiques et biophysiques des peptides antimicrobiens , comme la structure secondaire , la charge globale et l' hydrophobicité influencent leurs interactions avec les membranes microbiennes ( Reddy et al. , 2004 ; pour revue ) . 3.1 . Le modèle par formation de pores : « Barel stave » Ce modèle décrit la formation de pores transmembranaires par des faisceaux d' hélices & 206;& 133; amphipathiques dont les surfaces hydrophobes interagissent avec la partie lipidique de la membrane alors que les surfaces hydrophiles se tournent vers l' intérieur pour former un pore aqueux . Le recrutement progressif de monomères additionnels augmente la taille du pore . Les canaux transmembranaires ainsi formés vont détruire les équilibres osmotiques et conduire à la lyse de la cellule ( Wu et al. , 1999 ) . Chez les arthropodes , le mode d' action de certains peptides antimicrobiens a été établi , notamment pour les cécropines ( Hong et al. , 2003 ) , les diptéricines ( Winans et al. , 1999 ) , les défensines ( Christensen et al. , 1990 ) les tachyplésines et les polyphémusines ( Katsu et al. , 1993 ) . Ils présentent tous une activité membranolytique . 3.2 . Le modèle détergent : « Carpet » Dans ce modèle , les peptides à forte concentration sont en contact avec les phospholipides de la membrane externe et entraînent une perméabilité membranaire . Les peptides se lient tout d' abord à la surface des membranes cibles , puis la recouvre à la manière d' un tapis . Les peptides désintègrent alors la membrane en déstabilisant la bicouche phospholipidique . 3.3 . Autres mécanismes Certains peptides ne semblent pas agir sur les membranes mais sur des cibles cytoplasmiques . Par des analyses de translocation , il a été montré que les peptides riches en arginine étaient capables à la fois d' être transportés à travers la membrane plasmique , mais également à travers l' enveloppe nucléaire ( Powers et Hancock , 2003 ; pour revue ) . Une fois dans la cellule , les peptides peuvent alors interagir avec l' ADN , l' ARN et/ou les protéines cellulaires . Les pyrrhocoricines , peptides riches en prolines d' insectes , sont capables de se lier aux heat shock protéines ( DnaK ) , inhibant alors leur rôle de chaperonnes moléculaires ( Kragol et al. , 2001 ) . Ce mécanisme est cependant plus long que celui concernant une action sur les membranes . Les attacines , inhiberaient la synthèse des protéines de la membrane externe sans cependant entrer dans la cellule ( Hultmark et al. , 1983 ) . II.4 . Régulation de la synthèse des peptides antimicrobiens 4.1 . Chez les insectes Chez les insectes , le corps gras ( équivalent fonctionnel du foie des vertébrés ) est le site principal de synthèse des peptides antimicrobiens ( Hoffman et Reichhart , 1997 ; Engström , 1998 ) , certains hémocytes étant cependant capables d' une telle synthèse . Chez les insectes sains , les gènes codant les peptides antibactériens sont en général silencieux . En réponse à une infection microbienne , une induction rapide de la transcription de ces gènes , conduisant à la synthèse et la libération simultanée de peptides antimicrobiens dans l' hémolymphe est observée ( Hoffman et Hetru , 1992 ) . Chez la drosophile , les mécanismes d' activation des gènes codants les peptides sont aujourd'hui connus . Lors d' une infection par des bactéries à Gram ( + ) ou des champignons , les déterminants antigéniques de ces pathogènes sont reconnus par la cellule . Cette reconnaissance s' effectue pour les bactéries Gram ( + ) par l' intermédiaire d' une protéine de reconnaissance des glucanes , tandis que les molécules impliquées dans la reconnaissance des champignons ne sont , à ce jour , pas déterminées . Quoiqu' il en soit cette reconnaissance va permettre l' activation de la voie Toll des cellules du corps gras mais également des hémocytes . Brièvement , les récepteurs transmembranaires Toll sont activés et déclenchent une cascade d' activation dans la cellule qui conduit à l' entrée dans le noyau du facteur de transcription DIF ( Figure . 4 ) . Les gènes codants les peptides antimicrobiens présentent dans leur région régulatrice des motifs semblables aux motifs NF-& 206;& 142;B des mammifères ( Meister et al. , 1997 ) . Les protéines DIF vont alors induire , par exemple , la transcription du gène de la drosomycine . Lors d' une infection fongique naturelle plus de 350 gènes sont induits dont celui de la drosomycine ( Hetru et al. , 2003 ; Vodovar et al. , 2004 ) . Lors d' une infection par des bactéries Gram ( - ) , le mécanisme d' activation de la transcription des gènes des peptides antibactériens est différent et implique une autre voie : la voie Imd ( immune deficiency ) . Bien que le récepteur des protéines de reconnaissance impliqué dans cette voie de signalisation ne soit pas clairement identifié , cette voie de signalisation aboutit , de la même manière que la voie Toll , à l' activation de la transcription des gènes codant les peptides antibactériens . Le facteur de transcription impliqué ( relish ) est différent mais possède le même motif de liaison aux domaines NF& 206;& 142;B. Son entrée dans le noyau conduit à l' activation de la diptéricine mais également de nombreux autres gènes , dont les fonctions sont inconnues ( Hetru et al. , 2003 ; pour revue ) . Les peptides ainsi produits et immédiatement maturés sont sécrétés dans la circulation générale , où ils vont pouvoir agir sur les pathogènes infectants . Figure 4 : Schéma des voies de signalisation Toll et IMD dans la réponse immunitaire innée chez la drosophile . A . La voie Toll : les bactéries Gram ( + ) et les champignons sont reconnus par des PRP , processus qui est suivi par le clivage protéolytique de Spaetzel . Spaetzel active le récepteur Toll , qui conduit à la dégradation de Cactus et la translocation nucléaire de la protéine DIF . Ce facteur de transcription active de nombreux gènes dont celui de la drosomycine . B . La voie IMD : les bactéries Gram ( - ) activent cette voie de signalisation , toutefois le récepteur membranaire est inconnu . Cette voie de signalisation fait intervenir des caspases et aboutit à la translocation nucléaire du facteur de transcription Relish , qui va activer de nombreux gènes dont celui de la diptéricine ( d' après Vodovar et al. , 2004 ) 4.2 . Chez les chélicérates Chez les chélicérates , les hémocytes granulaires stockent les molécules de défense telles que les sérines protéases , une protéine de coagulation , les inhibiteurs de protéases , les peptides antibactériens et les lectines ( Iwanaga et Kawabata , 1998 ; Iwanaga , 2002 ; Kawabata et Tsuda , 2002 ) . Lors d' une infection microbienne , les déterminants antigéniques des pathogènes sont reconnus , ce qui induit la libération par exocytose des protéines de défense ( Figure . 5 ) ( Iwanaga et Kawabata , 1998 ) . Les micro-organismes sont agglutinés par les lectines , immobilisés dans un gel insoluble produit par les facteurs de coagulation , et enfin tués par les substances antimicrobiennes . Récemment , un récepteur homologue des récepteurs Toll de drosophile ( dToll ) a été isolé chez la limule Tachypleus tridentatus tridentatus ( tToll ) ( Inamori et al. , 2004 ) . Ce recepteur n' est pas exprimé spécifiquement dans les tissus , et ne fonctionnerait pas comme un récepteur des PRP . La protéine finale de coagulation ( coaguline ) présente des structures qui ressemble au ligand des dToll ( spaetzle ) . Inamori et collaborateurs ( 2004 ) proposent que la coaguline induise la dimérisation ou l' oligomérisation de tToll , conduisant à l' activation des voies de signalisation intracellulaires . Cette liaison au tToll permettrait alors l' expression des gènes des protéines de défense ( afin de restaurer le contenu des granules hémocytaires ) mais également l' expression des protéines impliquées dans la réparation des tissus et de l' exosquelette sur le site d' infection ( Figure . 5 ) . Figure 5 : Le système de défense des limules : Découverte d' un récepteur Toll-like . Les hémocytes détectent les LPS ou les & 206;& 134;- 1 , 3- glucanes qui vont induire la dégranulation des hémocytes . Les facteurs de coagulation libérés sont activés par le LPS ou les & 206;& 134;- 1 , 3- glucanes . La coaguline ainsi produite pourrait induire la dimérisation des récepteurs tToll . La cascade de signalisation intracellulaire serait alors activée ( modifié d' après Iwanaga et Kawabata , 1998 ) . 4.3 . Chez les crustacés Chez les crustacés décapodes , si la réponse immunitaire est relativement bien connue , principalement grâce aux études réalisées ( 1 ) sur l' écrevisse Pacifastacus leniusculus par l' équipe de Söderhäll ( 2 ) sur les crevettes pénaeides par l' équipe de Bachère . La compilation de ces recherches indiquent que la majorité des protéines du système immunitaire , y compris les peptides antimicrobiens sont produits constitutivement et stockés dans les hémocytes , ce modèle ressemble donc à celui proposé chez les chélicérates . Toutefois , le mode de libération du contenu des granules semble différent . Les premières études d' expression des gènes , chez Penaeus vannamei , ont montré que suite à une infection microbienne , les nouveaux hémocytes libérés par les organes hématopoïétiques présentent un fort taux d' ARNm codant pour les pénaeidines ( Figure . 6 ) . De plus , ces hémocytes s' infiltrent dans tous les tissus , témoignant d' une réaction systémique ( Bachère et al. , 2004 ) . Toutefois , actuellement , le mode de régulation de la synthèse des protéines de défense et a fortiori des peptides antimicrobiens demeure inconnu . Le rôle du système nerveux dans la production de peptides antimicrobiens ( Lefebvre et al. , 2000 ; Vergotte et al. , 2004 ) ainsi que son rôle dans le contrôle de leur libération n' ont pas encore été étudié chez les crustacés . Signalons cependant , que différentes études rapportent la présence de peptides opioïdes dans les système nerveux des crustacés isopodes et décapodes ( Martin et Dubois , 1981 ; Luschen et al. , 1991 ) mais le rôle de ces peptides n' est pas évoqué dans le cadre de l' immunité . Figure 6 : Modèle d' action des pénaeidines dans la réponse immunitaire chez les crevettes pénaeides . A . En conditions normales , les pénaeidines sont produites par les hémocytes , qui sont localisés à la fois dans la circulation générale et dans les tissus . La réponse à une infection microbienne peut être divisée en deux phases . B . Phase I . Réaction locale : elle est caractérisée par la migration des hémocytes vers le site d' infection et par la libération de grandes quantités de peptides antimicrobiens . Les pénaeidines et les peptides dérivés de l' hémocyanine sont présents dans la circulation . C . Phase II . Réaction systémique : elle est caractérisée par une accumulation d' hémocytes produisant les peptides antimicrobiens avec une expression supérieure à la normale , issus de la libération par les organes hématopoïétiques activés . Les pénaeidines sont liées aux surfaces cuticulaires ( d' après Bachère et al. , 2004 ) . Tableau 1 : Systématique des différentes espèces d' isopodes terrestres ( cloportes ) utilisées dans cette étude . Matériels et Méthodes I. MODÈLE BIOLOGIQUE ET ELEVAGE Les travaux réalisés ont principalement porté sur une espèce d' isopode terrestre , Armadillidium vulgare ( A.vulgare ) ( Latreille ) . Ce crustacé Malacostracé de la famille des Armadillidiidae ( Brandt ) est très commun dans les zones agricoles en France . Deux lignées entretenues depuis de nombreuses années au laboratoire ont été utilisées : - La lignée amphogène ( sex-ratio équilibré ) est originaire des collines de l' arrière pays niçois . - La lignée thélygène ( sex-ratio biaisé & 198;& 190; 50 % ) , riche en intersexués et en femelles thelygènes porteuses de Wolbachia ( wVul ) , provient de Niort ( 79 ) . Ces deux populations sont maintenues à 20 °C en photopériode naturelle dans des bacs de plastique ( 10 X 30 cm ) contenant du terreau humide , et reçoivent une nourriture ad libitum , constituée de carottes et de feuilles de tilleul . D' autres espèces d' isopodes terrestres , également disponibles au sein des élevages du laboratoire , ont été utilisées lors de cette étude ( Tableau 1 ) : ( i ) Des espèces du genre Armadillidium appartenant à la même famille ( Armadillidiidae ) : Armadillidium assimile , Armadillidium depressum , Armadillidium maculatum et Armadillidium nasatum . ( ii ) Des espèces de genres différents appartenant à des familles différentes : - Oniscus asellus ( Linné ) se rencontre en forêts sous les écorces de bois mort , cette espèce appartient à la famille des Oniscidae . - Porcellionides pruinosus pruinosus ( Brandt ) est une petite espèce très rapide qui affectionne les composts , elle appartient à la famille des Porcelloinidae . Ces deux espèces peuvent héberger d' autres souches de Wolbachia ( respectivement wAse et wPru ) , et certains mâles fonctionnels peuvent être porteurs de la bactérie . - Armadillo officinalis ( europeus ) ( Dumeril ) , récolté dans les garrigues de la région de Narbonne , appartient à la famille des Armadillidae considérée comme la plus évoluée ( d& 200;& 135;un point de vue volvationnel ) du groupe des isopodes terrestres . Les populations naturelles étudiées n& 200;& 135;hébergent pas de Wolbachia et , de façon inattendue , cette espèce est capable d' éliminer Wolbachia ( souche wVul ) après inoculation expérimentale . Ces 7 populations sont également maintenues au laboratoire dans les mêmes conditions qu' Armadillidium vulgare . II . PRELEVEMENT DE L' HEMOLYMPHE A l' aide d' une fine aiguille , un trou est percé dans la membrane articulaire entre le dernier segment du péréion et le premier segment du pléon , au niveau du vaisseau dorsal médian ( Figure 7 ) . L' hémolymphe s& 200;& 135;écoulant par ce trou est prélevée rapidement à l' aide d' une pipette et est diluée de moitié dans une solution anticoagulante [ MAS : EDTA 9 mM ; glucose 115 mM ; NaCl 336 mM ; citrate de sodium 27 mM , pH 7 ; ( Rodriguez et al. , 1995 ) ] maintenue sur glace et contenant un inhibiteur de serine-protéinases ( aprotinine 40 & 206;& 144;M , Sigma ) et un inhibiteur de mélanisation ( phénylthiocarbamate 200 & 206;& 144;M , Sigma ) . Le plasma est séparé des hémocytes par centrifugation ( 800 X g , 15 min , 4 °C ) . Le surnageant correspondant au plasma et le culot d' hémocytes sont ensuite stockés séparément à - 70 °C . III . INJECTIONS EXPERIMENTALES DES ANIMAUX Dans les expériences d' infection , différents composés mais également différentes souches bactériennes ont été injectés aux animaux : - & 200;& 136;Ringer isopodes& 200;& 136; ( CaCl 2 1 , 4 mM ; HNaCO 3 2 , 4 mM ; KCl 2 mM ; NaCl 0 , 4 M ) - LPS ( Escherichia coli , Sigma ) injecté en solution dans du & 200;& 136;Ringer isopodes& 200;& 136; à raison de 0 , 1 mg / ml . - Laminarine ( Laminaria digitata digitata , Sigma ) injectée en solution dans du & 200;& 136;Ringer isopodes& 200;& 136; à raison de 1 mg / ml . - Bacillus megaterium [ Gram ( + ) ] ( 1 , 2.109 bactéries / ml ) , tués ou non par chauffage à 95 °C pendant 10 min . - Escherichia coli [ Gram ( - ) ] ( 1 , 2.109 bactéries / ml ) , tués ou non par chauffage à 95 °C pendant 10 min . - Wolbachia ( bactérie endocellulaire non cultivable ) : l' inoculum est préparé à partir des ovaires et des chaînes nerveuses prélevées sur 5 femelles d' A.vulgare porteuses de Wolbachia . Les organesdisséqués sont broyés , à 4 °C , à l' aide d' un piston Pellet stérile dans 500 & 206;& 144;l de & 200;& 136;Ringer isopodes& 200;& 136;. Le broyat obtenu est filtré à l& 200;& 135;aide d' une seringue munie d& 200;& 135;une cartouche filtrante ( Poly Labo ) dont la membrane présente des pores de 1 , 2 & 206;& 144;m perméables aux bactéries . Toutes les injections sont réalisées en position latérale dans le 6ème segment du péréion de l' animal et consistent en l' injection d' un microlitre de solution à tester , à l' aide d' une seringue Hamilton munie d& 200;& 135;une micro-aiguille . Après différents temps d' action ( de plusieurs minutes à plusieurs jours ) , l' hémolymphe des animaux est prélevée comme décrit dans le § II . p 40 . IV . TESTS D' ACTIVITE ANTIMICROBIENNE IV.1 Tests d' activité antibactérienne Au cours des tests d' activité antibactérienne , 6 souches de bactéries Gram ( + ) [ Bacillus megaterium * , Enterococcus faecalis * , Listeria ivanovii * , Micrococcus luteus * , Staphilococcus aureus , Vibrio alginolyticus * ] et 8 souches de bactéries Gram ( - ) [ ( Acinetobacter baumanii , Citrobacter freundii * , Enterobacter cloacae * , Enterobacter aerogines , Escherichia coli * , Escherichia coli ( souche pathogène ) , Pseudomonas aeruginosa , Salmonella thyphimurium * ) ] ont été utilisées . Tableau 2 : Souches bactériennes utilisées et milieux de culture correspondants : LB Les tests d' activité antibactérienne ont été réalisés de deux manières différentes : ( a ) en milieu solide sur gélose pour les bactéries marquées d' une étoile ( * ) ; ( b ) en milieu liquide pour les bactéries marquées d' un dièse ( ) . ( a ) Tests en milieu solide Une colonie de chaque souche bactérienne est mise en culture soit dans du milieu Luria-Bertani ( LB ) , soit dans du milieu Brain Heart Infusion ( BHI ) ( Tableau 2 ) , puis placée à 37 °C pendant 16h. Un aliquot ( 120 & 206;& 144;l ) de chaque culture bactérienne ainsi préparée est mélangé à 12 ml d& 200;& 135;un milieu gélosé approprié ( LB / agar 10 % ou BHI / agar 10 % ) stabilisé à 50 °C et coulé dans des boîtes de Pétri . Les échantillons à tester ( peptides et protéines plasmatiques ou hémocytaires ) sont resuspendus dans 10 & 206;& 144;l d' eau bidistillée stérile et déposés sur la gélose . Après incubation pendant une nuit à 37 °C , l' activité antibactérienne est révélée par l' absence de croissance des bactéries dans la zone du dépôt . ( b ) Tests en milieu liquide Ces tests sont réalisés en microplaques 96 puits ; 10 & 206;& 144;l d' une solution de protéines ( reprises dans de l' eau bidistillée ) sont dilués successivement de moitié dans les puits d' une même ligne . Cent microlitres de bactéries , cultivées dans du milieu Poor Broth Nutrient ( PBN ) puis diluées à 0 , 001 unité DO600 , sont ajoutés dans chaque puits . Les microplaques sont placées à l' étuve à 37 °C sous agitation constante pendant 18h. La croissance des bactéries est mesurée par spectrophotométrie , dans un lecteur de plaques à une longueur d' onde de 600 nm . IV.2 . Tests d' activité antifongique 2.1 Champignons Les champignons utilisés pour cette recherche sont Botrytis cinerea , Aspergillus niger , Phaeomoniella chlamydospora et Eutypa lata ( Tableau 3 ) . Tableau 3 : Souches de champignons utilisées et milieux de culture correspondants Pour Aspergillus niger et Botrytis cinerea , l' activité antifongique de nos échantillons a été testée sur la germination des spores de ces champignons filamenteux . Dix microlitres d& 200;& 135;une solution de 106 spores , stockée à 4 °C , sont dilués au 1 / 1000 éme dans un milieu & 194;& 189; Potato Dextrose Broth ( & 194;& 189; PDB ) . Vingt microlitres de protéines à tester sont déposés dans l' un des puits d' une microplaque et sont dilués successivement de la même manière que pour les tests antibactériens , puis 80 & 206;& 144;l de milieu contenant les spores diluées sont ajoutés dans chaque puits . Les microplaques sont placées pendant 18 à 48h à 30 °C en chambre humide . La croissance des hyphes est vérifiée par observation au microscope et la densité optique de la plaque est lue à une longueur d' onde de 595 nm . Pour E. lata et P. chlamydospora , des plaques 12 puits sont utilisées afin de tester l' activité antifongique de nos échantillons sur la croissance des champignons . Dans chaque puits , 1 , 5 ml de milieu de culture sont déposés ; lorsque celui -ci commence à se solidifier , le plus petit volume possible de protéines , à la concentration souhaitée , est ajouté . Le milieu solide est inoculé avec un disque de gélose de 4 mm , sur lequel s' est développé le champignon à tester . Les expérimentations sont conduites en conditions contrôlées à l' obscurité à 20 °C. La croissance des champignons est suivie par une mesure quotidienne du diamètre de l' inoculum . 2.2 . Levures Les tests d' activité sur les levures ( Candida glabrata , Pichia pastoris , Saccharomyces cerevisiae FL100 , Saccharomyces cerevisiae Erg 6 & 199;& 187; et Saccharomyces cerevisiae WT Eurostarf ) ont été réalisés sur milieu solide . Une suspension cellulaire de levures en croissance est étalée sur milieu complet ( ML , Tableau 3 ) et mise à pousser jusqu'à l' obtention d' un tapis . Les échantillons sont déposés sur des disques de papier Whatman stériles ( 8 mm ) posés au préalable sur le tapis de levures . Autour du disque , l' activité antifongique se manifeste par un halo d' inhibition de croissance dont le diamètre est proportionnel à l' effet . IV.3 . Concentration minimale d' inhibition ( MIC ) La MIC correspond à un intervalle de concentrations du peptide antibactérien ( a-b ) , où ( a ) représente la plus forte concentration pour laquelle les bactéries peuvent encore pousser et où ( b ) correspond à la plus basse concentration qui provoque 100 % d' inhibition de la croissance bactérienne . La connaissance de ces valeurs permet de déterminer l' activité du peptide antibactérien . Ce test a été réalisé en culture liquide dans des microplaques à 96 puits dans un volume final de 200 & 206;& 144;l . Une gamme étalon de dilution ( à base 10 ) du peptide est réalisée avec du milieu PBN . Cent microlitres de chaque solution sont incubés avec 100 & 206;& 144;l d' une suspension de culture de Bacillus megaterium ( DO A 600 = 0 , 001 ) dans du milieu PBN . La croissance des bactéries est estimée par mesure de la densité optique à 600 nm après 18h d' incubation à 30 °C sous agitation constante . V. APPROCHE PROTÉOMIQUE Pour l' analyse des protéines plasmatiques , que ce soit en gels 1-D , 2-D ou RP- HPLC , l' aprotinine n' a pas été utilisée lors du prélèvement de l& 200;& 135;hémolymphe et ce , afin de ne pas la retrouver comme une protéine contaminante . V.1 . Extraction des protéines 1.1 Des hémocytes Après lavage par 500 & 206;& 144;l de la solution anticoagulante , le culot d' hémocytes , obtenu comme décrit dans le § II p 40 , est repris soit dans 150 & 206;& 144;l d' une solution d' acide acétique 0 , 2 N pour les pré-purifications Sep-Pak , soit dans 150 & 206;& 144;l d' une solution de PBS ( Buffered Saline : NaCl 0 , 137 M ; Na 2 HPO 4 , 12 H 2O 7 , 8 mM ; KCl 2 , 7 mM ; KH2PO4 1 , 47 mM ; pH 7 , 4 ) pour les analyses en 2-D . La suspension est maintenue sur glace jusqu'à l' extraction protéique . Les cellules hémocytaires sont broyées par sonication 3 X 30s ( 40 mA , Branson Ultrasons , Annemasse , France ) . L' homogénat est centrifugé 2 fois à 12 000 X g , pendant 10 min à 4 °C , ce qui permet d& 200;& 135;éliminer les débris cellulaires . Les protéines contenues dans le surnageant acétique sont utilisées immédiatement pour un fractionnement à l' aide d' un Sep-Pak ( cf. § V . 2.1 . p 48 ) , celles solubles dans le PBS sont précipitées une nuit dans 6 volumes d' acétone à - 20 °C. Après centrifugation ( 10 000 X g , 20 min , 4 °C ) , les culots de protéines précipitées sont rincés à l' acétone froid puis séchés à l' air libre . 1.2 . Du plasma Afin d' éliminer l' hémocyanine qui est la protéine majoritaire du plasma ( 95 % des protéines totales ) , deux méthodes par acidification ont été utilisées ; la première utilise de l' acide trifluoroacétique ( TFA ) 0 , 1 % , la seconde de l' acide chlorhydrique ( HCl ) à 0 , 1 M final . L' acidification du plasma permet de précipiter les grosses molécules , telle que l' hémocyanine , sans précipiter les plus petites . Cette précipitation est réalisée sur glace sous agitation magnétique pendant 8h. L' hémocyanine précipitée est alors éliminée par 2 centrifugations à 8 000 X g pendant 20 min à 4 °C. Le surnageant contenant les petites protéines est conservé sur glace ou stocké à - 80 °C . 1.3 . Des organes hématopoïétiques Les organes hématopoïétiques ( 3 paires par animal ) sont , après dissection , immédiatement plongés dans l' azote liquide . Environ 120 organes hématopoïétiques sont placés dans un milieu inhibiteur de protéases [ alcool 75 % ; HCl fumant 0 , 2 M ; ( Oyama et al. , 1978 ) ] puis soniqués 3 X 20s . Les débris cellulaires sont éliminés par centrifugation ( 10 000 X g , 10 min , 4 °C ) et les protéines contenues dans le surnageant sont précipitées par 6 volumes d' acétone pendant une nuit à - 20 °C. Après centrifugation ( 15 000 X g , 20 min , 4 °C ) , le culot est conservé à - 20 °C jusqu& 200;& 135;à utilisation . 1.4 . Des cæcums digestifs Les cæcums digestifs de 2 animaux sont placés dans un milieu inhibiteur de protéases [ ( alcool 75 % ; HCl fumant 0 , 2 M ; ( Oyamaet al. , 1978 ) ] . Après centrifugation ( 15 000 X g , 5 min , 4 °C ) , le culot est repris dans le même milieu et les cæcums digestifs sont broyés à l' aide d' un piston ( Pellet ) . Les débris cellulaires sont éliminés par centrifugation ( 10 000 X g , 10 min , 4 °C ) . Les protéines contenues dans le surnageant sont précipitées dans 6 volumes d' acétone à - 20 °C pendant plusieurs heures ou une nuit . Les protéines ainsi précipitées sont récupérées comme décrit ci- dessus ( § V . 1.3 p 47 ) . V.2 . Purification et analyses des protéines 2 . 1 .Sep -Pak Le fractionnement des protéines est réalisé en phase solide sur une cartouche 35 cc La phase ( C18 ) est préalablement lavée avec 10 ml de méthanol et équilibrée par 10 ml d' eau bidistillée additionnée de TFA 0 , 05 % ( Cociancich , 1991 ) . Les protéines hémocytaires ou plasmatiques ( quelque soit le type d' acidification utilisé ) sont diluées dans une solution d' eau TFA 0 , 1 % ( v / v ) . Après vérification du pH , qui doit être compris entre 2 , 0 et 2 , 5 , l& 200;& 135;échantillon est déposé sur la cartouche Sep-Pak . Celle -ci est ensuite lavée avec 5 ml d' eau TFA 0 , 1 % afin d' éliminer les sels contenus notamment dans la solution anticoagulante . Les protéines hémocytaires ou plasmatiques sont ensuite éluées par une solution d' acétonitrile ( ACN ) de concentration variable selon l' utilisation désirée : ( i ) pour les tests d' activité antimicrobienne , l' ensemble des protéines est élué par une solution de 80 % d' ACN / TFA 0 , 1 % . La fraction collectée est séchée au concentrateur sous vide réfrigéré ( Speed Vac , Savant& 194;& 174; ) ( ii ) pour l' isolement des peptides antimicrobiens , deux élutions successives à 40 % puis à 60 % d' ACN / TFA 0 , 1 % sont effectuées . Les deux fractions sont collectées séparément et séchées au concentrateur sous vide réfrigéré ( Speed Vac , Savant& 194;& 174; ) . 2.2 . RP-HPLC Les protéines extraites des différents échantillons sont resuspendues dans 150 & 206;& 144;l d' acide acétique 0 , 02 N , puis l' échantillon est centrifugé ( 10 000 X g , 2 min , 4 °C ) et le surnageant est injecté dans la boucle d' injection ( 200 & 206;& 144;l ) de la chaîne de chromatographie ( Waters& 239;& 130;& 165; 600 Controller ) . L' analyse par RP-HPLC permet de séparer les peptides / protéines contenus dans les échantillons selon leur polarité . Pour cela , l' échantillon est adsorbé sur une phase solide constituée d' un support inerte composé de particules de silice de 10 & 206;& 144;m de diamètre ( Lichrospher ODS2 ) sur lesquelles sont greffées des chaînes apolaires à 18 atomes de carbone ( C18 ) . Cette phase solide est contenue dans une colonne d' une longueur de 300 mm et d' un diamètre de 3 , 9 mm ( Microbondapack& 226;& 132;& 162; , Waters Associates ) . Cette colonne est équilibrée par une solution d' ACN 4 % / TFA 0 , 1 % . Les protéines sont éluées par un gradient linéaire de 4 à 60 % d' ACN / TFA 0 , 1 % , avec un débit de 0 , 9 ml par min ( 0 , 72 % d' ACN par min ) pendant 80 min . Les produits désorbés sont détectés par absorption à 214 nm ( Waters& 239;& 130;& 165; 486 Tunable absorbance detector ) et le profil de chromatographie ( absorbance > à 0 , 3 unités DO , en fonction du temps ) est enregistré sur papier . A chaque augmentation de l' absorbance , l' éluat est collecté manuellement . Chaque fraction est ensuite séchée au concentrateur sous vide et stockée à - 80 °C . 2.3 . MALDI-TOF Du fait de la faible concentration en peptides ou en protéines des fractions collectées après purification par RP-HPLC , la technique de MALDI-TOF est très adaptée puisqu' elle est applicable à partir de la femtomole et donne des informations sur la ou les masses des produits contenus dans la fraction collectée , sur sa pureté , ainsi que sur la présence éventuelle de glycosylations sur le produit analysé . Ces analyses ont été réalisées au laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio- Organique ( Directeur A. Van Dorsselaer , UMR CNRS-ULP Strasbourg ) , en collaboration avec le Dr J-M Strub , sur un appareil MALDI-TOF de type Bruker ( Bremen ) BIFLEX& 226;& 132;& 162;. Les échantillons sont resuspendus dans 10 & 206;& 144;l d' eau / ACN ( 50 / 50 , v / v ) -TFA 0 , 1 % , et 0 , 7 & 206;& 144;l sont déposés sur une cible métallique et co-cristallisés avec 0 , 7 & 206;& 144;l de matrice solide d' acide & 206;& 133;-cyano- 4- hydroxycinnamique ( Sigma ) saturée par de l' eau / ACN ( 50 / 50 , v / v ) -TFA 0 , 1 % . Cette matrice permet une séparation des molécules par absorption de l' énergie provenant des pulses de photons émis par un laser . Ainsi , elle favorise l' ionisation par vaporisation en induisant des transferts de protons . Les ions formés sont ensuite envoyés dans le sélecteur et accélérés par un potentiel ( V ) de 28 kV , dans un tube à champ libre de vol ( TOF ) en mode linéaire . Le temps de vol ( t ) , nécessaire pour atteindre le détecteur placé à une distance ( d ) , est mesuré . Ce temps est relié au rapport masse ( t& 194;& 178; = ( md& 194;& 178; ) / ( 2 zeV ) = m / z ( d& 194;& 178; / 2 eV ) Ainsi , la durée du temps de vol d' une molécule sera fonction du nombre de charges qu' elle porte . L' enregistrement d' un spectre requiert la superposition de 50 tirs du laser sur la matrice . Le calibrage des spectres est effectué par extrapolation à partir du temps de vol de 2 protéines de masses parfaitement connues : l' insuline de boeuf ( 5 750 Da ) et la myoglobine ( 16 500 Da ) . 2.4 . Séquençage par dégradation d' Edman Les échantillons ( peptides ou protéines ) sont soumis à une dégradation d' Edman qui permet d' établir la séquence primaire en acides aminés . Cette réaction de dégradation est effectuée de façon automatisée sur un séquenceur ( Applied Biosystems 471 A Protein Sequencer ) . 2.5 . Electro-spray ( ES-MS ) Afin de déterminer la masse exacte des peptides , les échantillons ont été analysés par spectrométrie de masse ( ES-MS ) . Cette ES-MS a été réalisée à l' aide d' un spectrométre de masse : double quatrupole ( Quattro II , Micromass , Manchester Ltd. , UK ) en mode positif ( Jaquinod et al. , 1993 ) . Les protéines / peptides sont dissous ( à une concentration de 5 pmol / & 206;& 144;l ) dans de l' ACN 50 % contenant 1 % d' acide acétique . 2.6 . Gels 1-D 2.6.1 Gels d' acrylamide Les protéines , issues des hémocytes , du plasma , des organes hématopoïétiques et des cæcums digestifs ont été analysées sur des gels en plaque dont la concentration en acrylamide ( 10 % , 12 , 5 % ou 15 % ) était ajustée en fonction de la réticulation souhaitée . La technique de SDS-PAGE en conditions dissociantes est dérivée de celle décrite par Laemmli ( 1970 ) . Les culots protéiques , obtenus après extraction et précipitation , sont repris dans un tampon de solubilisation ( Tris base 62 , 5 mM , pH 6 , 8 ; SDS 2 % ; glycérol 10 % ; bleu de bromophénol 0 , 01 % ) . Les protéines sont dosées selon la méthode de Bradford ( 1976 ) puis déposées sur gel ( 20 & 206;& 144;g par puits ) où leurs masses moléculaires apparentes sont comparées à celles des marqueurs ( 14 - 95 kDa , Biorad& 194;& 174; ) . Ce gel est constitué d' un gel de séparation [ acrylamide / bisacrylamide 10 à 15 % ; SDS 0 , 1 % ; Tris 375 mM , pH 6 , 8 ; persulfate d' ammonium 0 , 35 & 226;& 128;& 176; ( p / v ) ; TEMED 0 , 03 % ( v / v ) ] et d' un gel de concentration [ acrylamide / bisacrylamide 4 , 5 % ; SDS 0 , 1 % ; Tris 125 mM , pH 6 , 8 ; persulfate d' ammonium 0 , 15 % ( p / v ) ; TEMED 0 , 75 & 226;& 128;& 176; ( p / v ) ] . La migration électrophorétique est réalisée à 100 V pendant 2h30 ( sortie du front de migration ) à température ambiante dans du tampon de migration ( glycine 192 mM ; TRIZMA& 194;& 174; base 25 mM ; SDS 0 , 1 % ; pH 8 , 5 ) . Les gels sont alors fixés et colorés pendant une nuit dans une solution contenant du méthanol ( 50 % ) , de l' acide acétique glacial ( 7 , 5 % ) et du bleu de Coomassie [ 0 , 1 % ( p / v ) ] . Enfin , les gels sont déposés dans une solution de décoloration ( méthanol 40 % ; acide acétique 5 % ) sous agitation constante jusqu& 200;& 135;à l& 200;& 135;obtention de la coloration désirée . 2.6.2 . Gels d' acrylamide d' acrylamide Tris-tricine Pour augmenter la résolution entre les produits de faibles masses moléculaires , l& 200;& 135;analyse des protéines hémocytaires et plasmatiques a été effectuée à l' aide de gel d' acrylamide Tris-tricine . Les échantillons sont préparés de la même manière que précédemment . Le gel comporte également un gel de concentration [ acrylamide 4 % ; Tris 0 , 75 M , pH 8 , 4 ; SDS 0 , 1 % ; persulfate d' ammonium 0 , 09 % ; TEMED 0 , 1 % ( v / v ) ] et d' un gel de séparation [ acrylamide 16 , 5 % ; Tris 1 M , pH 6 , 8 ; glycérol 13 % ( v / v ) ; SDS 0 , 1 % ; persulfate d' ammonium 0 , 75 & 226;& 128;& 176; ; TEMED 83 & 226;& 128;& 176; ( v / v ) ] . La migration a lieu dans du tampon de migration ( Tris 1M ; tricine 1M ; SDS 1 % ) pendant 4 à 6h à 80 V. Les gels sont ensuite colorés puis décolorés de la même façon que précédemment ( § V. 2.6.1 p 51 ) . 2.7 . Gels 2-D La mise au point des conditions optimales de migration des protéines en 2-D a été réalisée au laboratoire . Pour cela , nous nous sommes inspirés des travaux rapportés dans la thèse de C. Félix ( 2004 ) , ce qui nous a notamment permis d' adapter le protocole de réhydratation et les conditions de focalisation isoélectrique ( IEF ) . La réalisation de l' analyse protéomique des échantillons protéiques a été effectuée au cours de stages au sein du Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio-Organique de Strasbourg ( Directeur A. Van Dorsselaer , UMR CNRS-ULP ) , avec l' assistance technique de Mme D. Thiersé . L' analyse des spots d' intérêt ( § V.2.8 p 59 ) a été effectuée au sein de ce même laboratoire par le Dr J-M Strub . 2.7.1 . Préparation des échantillons Les protéines sont extraites des hémocytes par sonication dans du PBS ( § 5.1.1 p 46 ) . Les protéines , précipitées par 6 volumes d' acétone froid pendant une nuit à - 20 °C , sont recueillies par une centrifugation ( 15 000 X g , 10 min , 4 °C ) . Le culot est rincé avec 900 & 206;& 144;l d' acétone froid , puis une nouvelle centrifugation ( 15 000 X g , 10 min , 4 °C ) est réalisée . Après avoir délicatement éliminé le surnageant , le culot protéique est séché soit à l' air libre quelques minutes pour une utilisation rapide , soit au concentrateur sous vide réfrigéré ( Speed Vac , Savant& 194;& 174; ) pendant quelques minutes pour un stockage à & 226;& 128;& 147; 20 °C. Le plasma est soumis à une précipitation partielle par de l& 200;& 135;HCl 0 , 1 M à 4 °C , qui permet l' élimination d' un grande partie de l' hémocyanine , puis est fractionné sur cartouche Sep-Pak C18 . Les composants plasmatiques sont élués par une solution à 80 % d' ACN / TFA 0 , 05 % , puis sont concentrés jusqu'à dessiccation à l' évaporateur sous vide . Les culots anhydres plasmatiques et hémocytaires sont dissous dans un tampon de lyse ( urée 7 M ; thiourée 2 M ; CHAPS 4 % ; IGEPAL CA- 630 0 , 75 % ; DTT 10 mM ) . Le volume de tampon de lyse utilisé dépend de la taille du culot et peut varier de 20 à 300 & 206;& 144;l . L' échantillon en cours de solubilisation est placé sur de la glace et homogénéisé régulièrement à l' aide d' une pipette jusqu'à solubilisation complète du culot ( de quelques min à 1h ) . L& 200;& 135;échantillon est alors soumis à une sonication de 10 min puis est centrifugé à 12 000 X g pendant 2 min . Le surnageant recueilli est maintenu sur la glace jusqu& 200;& 135;au dosage des protéines . 2.7.2 . Dosage des protéines Les protéines sont dosées à l' aide du kit RC DC Protein Assay ( Bio-Rad& 194;& 174; ) dont la méthode est basée sur celle de Bradford ( 1976 ) . Ce kit a été choisi pour sa compatibilité avec les détergents et les agents réducteurs contenus dans le tampon de lyse . Une gamme étalon , à partir d& 200;& 135;une protéine standard ( BSA ) solubilisée dans le tampon de lyse , est préparée à des concentrations allant de 0 à 0 , 8 mg / ml ( incrément de 0 , 2 mg / ml ) . Cinq microlitres des différentes solutions de BSA préparées sont diluées individuellement dans 20 & 206;& 144;l d& 200;& 135;eau bidistillée stérile , puis les réactifs du kit sont ajoutés selon les instructions du fabriquant . Après 5 min d' incubation , l' absorbance est mesurée à 595 nm à l' aide d' un spectrophotomètre . Nos échantillons biologiques sont dosés selon les mêmes modalités à partir d& 200;& 135;un aliquot de 5 & 206;& 144;l . 2.7.3 . Isofocalisation Réhydratation La réhydratation consiste à faire pénétrer les protéines de l' échantillon dans un gel d' acrylamide accolé à une fine languette de plastique : une strip ( Readystrip IPG Strip , Bio-Rad& 194;& 174; ) . Des strips , linéaires et non linéaires , couvrant la gamme de pH la plus étendue ( pH 3 à 10 ) , ont été utilisées . Un volume d' échantillon correspondant à une quantité de 100 à 200 & 206;& 144;g de protéines est prélevé et le volume est ajusté avec du tampon de lyse additionné de 1 % de Bio-Lyte couvrant la gamme de pH 3 - 10 ( Bio-Lyte 3 / 10 Ampholyte , Bio-Rad& 194;& 174; ) . Le volume final dépend de la taille de la strip utilisée , ici le volume peut varier de 300 à 600 & 206;& 144;l . Le plateau à focalisation est placé dans un appareil PROTEAN IEF Cell ( Bio- Rad& 194;& 174; ) optimisé pour réaliser la focalisation isoélectrique . Le volume d' échantillon approprié est placé dans une rigole du plateau à focalisation , et la strip est délicatement posée dans le réceptacle , le gel en contact avec la solution protéique , coté + à l' anode . L' ensemble est recouvert d' huile minérale afin d' éviter tout phénomène d' évaporation . La réhydratation est « active » , c& 200;& 135;est-à-dire qu' elle s' effectue à 50 V pendant 12 à 18 h. Première étape : Conditionnement ( faible voltage pour éliminer les excès de sels ) IPG Strip Quatrième étape : Focalisation finale ( définir un voltage constant et une quantité de Volts x heures ) Tableau 4 : Conditions optimisées de focalisation des protéines hémocytaires et plasmatiques pour une strip de 17 cm . Des papiers wicks ( Bio-Rad& 194;& 174; ) préalablement humidifiés avec de l' eau bidistillée stérile sont placés sur chacune des électrodes . Ces papiers jouent le rôle de pièges à sels et autres composés non amphotèriques présents dans l' échantillon . Ce mode de réhydratation améliore l' entrée dans le gel des protéines de masses moléculaires importantes . Focalisation isoélectrique ( IEF ) Avant de lancer le programme d' isofocalisation , les papiers Wicks sont remplacés . Les conditions d' isofocalisation sont détaillées dans le Tableau 4 . Equilibration Avant de déposer la strip sur le gel de deuxième dimension , celui -ci doit être équilibré avec du tampon contenant du SDS . Une première incubation de 20 min dans la solution I d' équilibration ( Tris-HCl 375 mM , pH 8 , 8 ; urée 6 M ; glycérol 20 % ; SDS 2 % ; DTT 130 mM ) permet de saturer le gel en SDS et en agent réducteur ( DTT ) . L' agent réducteur utilisé étant le DTT , il est nécessaire de procéder à une seconde incubation avec de l' iodoacétamide dans la solution II d' équilibration ( Tris-HCl 375 mM , pH 8 , 8 ; urée 6 M ; glycérol 20 % ; SDS 2 % ; iodoacétamide 135 mM ) pendant 20 min , afin de prévenir la ré-oxydation des résidus cystéine des protéines au cours de l' électrophorèse et d' alkyler le DTT résiduel , minimisant ainsi les traînées verticales sur le gel . Cette solution d' équilibration II contient également quelques gouttes de bleu de bromophénol qui permet de suivre le front de migration . Après cette étape , les strips peuvent être conservées à - 80 °C dans des portoirs prévus à cet effet pendant plusieurs semaines . 2.7.4 . Deuxième dimension : électrophorèse en gel de polyacrylamide Préparation des gels d' acrylamide ( SDS-PAGE ) Après avoir focalisé les protéines selon leur pI , la séparation selon leur masse moléculaire s' effectue sur gel de polyacrylamide 12 % ( gel de séparation ) . Les protéines sont concentrées au cours de la traversée du gel de concentration , puis la migration selon la masse moléculaire s' effectue sur le gel de séparation . Les gels de séparation [ acrylamide / PDA ( Piperazine Di-Acrylamide ) 12 % ; Tris-HCl 375 mM , pH 8 , 8 ; SDS 0 , 1 % ; TEMED 0 , 05 % ; persulfate d' ammonium 0 , 05 % ] et de concentration ( acrylamide / PDA 3 , 7 % ; Tris-HCl 128 mM , pH 6 , 8 ; SDS 0 , 1 % ; TEMED 0 , 05 % ; persulfate d' ammonium 0 , 25 & 226;& 128;& 176; ) sont réalisés à partir d' acrylamide / PDA ( acrylamide 30 % / PDA 8 , 23 mM ) . La solution constituant le gel de séparation est tout d' abord coulée entre deux plaques de verre , une couche de butanol saturé en eau ( ou d' isopropanol ) est ensuite déposée au dessus de la solution d' acrylamide afin d' éviter les irrégularités dans le haut du gel et d' obtenir un front de migration horizontal . Après polymérisation , le butanol est éliminé et l' espace entre les plaques de verre est rincé plusieurs fois avec de l' eau bidistillée stérile . Le gel de concentration est alors coulé et , comme précédemment , du butanol saturé en eau est ajouté en surface . Après élimination du butanol , l' étape suivante consiste à placer la strip en contact étroit avec la surface du gel de concentration . ( Low Melting Point , SeaPlaque& 194;& 174; GTG& 194;& 174; agarose , Biocompare Inc . ) est coulée entre les deux plaques , au dessus du gel de concentration , empêchant la présence d' air entre la strip et le gel de concentration . Puis très rapidement , la strip est glissée à travers l' agarose de façon à ce que le contact de la strip se fasse sur toute l' épaisseur du gel de concentration . Migration La migration s' effectue dans du tampon Laemmli ( Tris 25 mM ; glycine 192 mM ; SDS 0 , 1 % ; pH 8 , 3 ) . Au début de l' électrophorèse de seconde dimension en SDS , l' application d' un faible voltage , 25 V pendant 1 h , permet l' élution ( par le SDS et l' urée ) des protéines contenues dans la strip . La migration s' effectue ensuite à 100 V , pendant 18 h environ , à une température optimale de 20 °C. L' arrêt de la migration s' effectue lorsque le front de migration sort du gel . Coloration des gels Deux types de colorations ont été réalisés : la coloration au nitrate d' argent et la coloration au bleu de Coomassie ou Colloïdal . D' une manière générale , la coloration au nitrate d' argent est plus sensible et plus résolutive , mais ne permet pas une analyse directe en spectrométrie de masse . Cette analyse est rendue possible par la coloration des gels au bleu de Colloïdal . Coloration au nitrate d' argent Cette méthode de coloration a été utilisée au laboratoire lors d' essais pilotes portant sur la préparation des échantillons et sur les conditions de migration , afin d' obtenir une meilleure résolution . Le protocole décrit ci-dessous correspond au « Protocole Bobigny » , adapté par T. Rabilloud . Dès la fin de la migration , les deux plaques de verre sont décollées libérant ainsi le gel d' acrylamide . Le gel est lavé 5 min dans de l' eau ultrapure désionisée ( MilliQ ) , puis incubé sous agitation 2 X 30 min dans la solution de fixation ( éthanol 30 % , acide acétique 5 % , eau MilliQ q . s . p 1l ) à température ambiante . Quatre lavages de 10 min en eau MilliQ sont ensuite réalisés puis le gel est incubé pendant 1 min dans une solution de thiosulfate de sodium à 0 , 02 % . Deux nouveaux lavages en eau MilliQ pendant 1 min ont lieu , puis le gel est placé dans la solution de coloration ( nitrate d' argent 11 , 8 mM ; formaldéhyde 0 , 01 % ) pendant 30 à 45 min . L' étape de révélation débute par le lavage du gel en eau MilliQ 2 X 30s , puis le gel est incubé dans la solution de révélation ( carbonate de sodium 226 , 4 mM ; thiosulfate de sodium 79 & 206;& 144;M ; formaldéhyde 0 , 01 % ) jusqu'à obtention de l' intensité désirée . La réaction est stoppée par incubation dans une solution d' arrêt ( Tris 330 mM ; acide acétique 1 % ; glycine 66 , 6 mM ) pendant 30 min à 1 h. Toutes ces solutions doivent être préparées le jour même et l' ajout de formaldéhyde doit se faire extemporanément . Le gel peut ensuite être conservé quelques semaines dans une solution de préservation [ glycérol 10 % ; PEG ( Polyéthylène Glycol 20 000 ) 2 % ] . Coloration au bleu de Colloïdal G 250 Cette méthode de coloration a été utilisée ( lors de mon stage à Strasbourg ) pour permettre une analyse directe des protéines . Les gels sont placés dans une solution de fixation ( éthanol 50 % ; acide phosphorique 3 % ) pendant 1 à 2 h. Ils sont ensuite rincés 3 fois dans de l' eau MilliQ pendant 20 à 30 min , puis sont placés dans la solution de coloration ( sulfate d' ammonium 10 % ; acide phosphorique 10 % ; bleu Colloïdal G 250 1 , 2 % ; méthanol 20 % ) pour une durée de 1 à 3 jours . La décoloration du fond s' effectue ensuite dans l' eau MilliQ jusqu'à obtention de l' intensité désirée . Les gels peuvent être conservés dans l' eau plusieurs semaines à température ambiante . 2.8 . Analyses des spots de 2-D Cette étude a été réalisée au laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio- Organique de Strasbourg , par le Dr . Jean-Marc Strub . Lorsque les gels sont suffisamment décolorés , ils sont scannés et comparés . Les spots contenant les protéines d' intérêt sont choisis et prélevés de manière automatisée par un robot . Les spots sont ensuite digérés à la trypsine , puis les analyses LC-MS et LC-MS / MS sont effectuées sur un Q / TOF II ( Micromass Ltd. , Manchester , UK ) , équipé d' une source Z-spray et d' une jonction liquide . L' instrument est équipé d' une source electrospray , d' un quadrupôle opérant comme un filtre de masse à bande passante variable , d' un hexapôle jouant le rôle de la cellule de collision et d' un analyseur en temps de vol ( TOF ) placé orthogonalement . L' analyseur de masse en temps de vol est utilisé pour acquérir les données MS et MS / MS . Les données de LC-MS / MS sont acquises en utilisant une énergie de collision propre à chaque ion précurseur doublement ou triplement chargé , détecté par l' analyseur à temps de vol puis isolé par le quadrupôle et fragmenté par l' hexapôle . Les données de MS / MS sont traitées automatiquement par le logiciel ProteinLynx ( Micromass Ldt. , Manchester , UK ) . Les données ainsi générées sont ensuite utilisées pour réaliser des recherches dans la banque NCBInr à l' aide de 2 moteurs de recherche Global Server ( Micromass , Ldt. , Manchester , UK ) et Mascot ( Matrix Science Ldt. , London , UK ) . Les microséquences issues d' un spot sont soumises pour identification sur le site : hhtp : / / dove . embl-heidelberg . de / Blast 2 / msblast . html . VI . APPROCHE GENOMIQUE VI.1 . Extraction des ARNs totaux Les ARNs totaux de divers tissus ( hémocytes , caecums digestifs , organes hématopoïétiques , coeurs , chaînes nerveuses , cerveaux , ovaires , tissu adipeux et tubes digestifs ) sont extraits ( i ) soit avec le kit « RNeasy minikit » ( Qiagen ) ( ii ) soit en utilisant la méthode d' extraction au LiCl / Urée ( Bothwell et al. , 1990 ) . ( i ) Brièvement , les tissus sont plongés dans un tampon de lyse ( composition non communiquée par le fournisseur ) additionné d' 1 & 206;& 144;l d' inhibiteur de RNAses ( Invitrogen , 40 U / & 206;& 144;l ) et déchiquetés par passages successifs dans une aiguille ( 0 , 8 X 40 mm , Terumo ) . Les broyats ainsi obtenus sont centrifugés 1 min à 13 000 X g afin d' éliminer les débris cellulaires et les amas adipeux . Les surnageants sont alors déposés sur une colonne d' affinité en gel de silice . Après différents lavages , les ARNs totaux sont élués par un volume de 25 à 100 & 206;& 144;l d' eau bidistillée . ( ii ) Les tissus congelés sont homogénéisés au sonicateur dans une solution de LiCl 3M / Urée 6M froid , puis placés une nuit à 4 °C. L' ADN est fragmenté par passages successifs dans une aiguille ( 0 , 8 X 40 mm , Terumo ) . L' échantillon est centrifugé à 4 °C pendant 30 min à 10 000 X g , puis le culot est lavé avec la solution de LiCl / Urée . Après reprise du culot dans un volume de tampon TE / SDS ( Tris 10 mM , pH 7 , 4 ; EDTA 1 mM , pH 8 , 0 ; SDS 0 , 5 % ) , un volume de phénol est ajouté . Les ARNs sont extraits par un traitement au phénol ( v / v ) suivi d' un traitement au chloroforme ( v / v ) . Les ARNs sont alors précipités dans de l' éthanol 100 % froid ( 2 , 5 v ) et de l' acétate de sodium 3 M pH 6 , 0 ( 1 / 10 v ) . Après centrifugation et séchage à l' air libre , les ARNs sont repris dans de l' eau bidistillée stérile et conservés à & 226;& 128;& 147; 80 °C. La concentration des ARNs totaux est déterminée par mesure de l' absorbance à 260 nm et leur intégrité est vérifiée par électrophorèse sur gel d' agarose 1 % dans du tampon MOPS 1X ( 3 [ N-morpholino ] propane sulfonicacid , pH 7 , 0 / MOPS 5X : MOPS 0 , 1 M ; acétate de sodium 40 mM ; EDTA 1 mM ) auquel sont ajoutés du formaldéhyde ( 17 % ) et 0 , 57 & 206;& 144;g / ml de bromure d' éthidium ( BET ) . Avant dépôt sur gel , les échantillons sont séchés sous vide , puis repris dans 10 & 206;& 144;l de tampon de charge ( formamide 48 % ; formalhéhyde 6 , 4 % ; bleu de bromophénol 0 , 25 % ; glycérol 6 , 6 % dans du tampon MOPS 1X ) . Après migration , les bandes du gel sont visualisées par illumination aux U.V ( Sambrook et al. , 1989 ) . VI.2 . RT-PCR Les ARNs totaux ( 1 & 206;& 144;g ) et 1 & 206;& 144;l d' amorces non spécifiques ( mélange d' hexanucléotides de séquence aléatoire , 30 unités de DO / & 206;& 144;l ) sont mélangés dans 6 & 206;& 144;l d' eau bidistillée , puis dénaturés à 65 °C pendant 5 min et placés immédiatement dans la glace . A cette solution , sont ajoutés 4 & 206;& 144;l de tampon RT 5X ( KCl 375 mM ; MgCl 2 15 mM ; Tris-HCl 250 mM , pH 8 , 3 ) , 2 & 206;& 144;l de DTT ( 100 mM ) , 5 & 206;& 144;l de dNTP ( 2 mM chacun ) et 1 & 206;& 144;l de Moloney-Murine Leukemia Reverse Transcriptase ( M-MLV M-MLV RT , 200 U / & 206;& 144;l , Gibco-BRL ) . Après 1 h d' incubation à 42 °C , la solution d' ADNc est stockée à - 20 °C . L' amplification est réalisée dans un volume de 25 & 206;& 144;l , contenant 0 , 5 & 206;& 144;l de solution d' ADNc , 25 pmol de chaque amorce ( sens et antisens ) , 2 , 5 & 206;& 144;l de tampon Taq 10X ( KCl 50 mM ; MgCl 2 1 , 5 mM ; Tris-HCl 10 mM , pH 9 , 0 ; 0 , 1 % de Triton X-100 ) , 0 , 5 & 206;& 144;l de dNTP ( 0 , 2 mM chacun ) et 0 , 125 & 206;& 144;l de Taq DNA polymérase ( 0 , 625U , Promega ) . L' amplification est effectuée par 35 cycles correspondant à une dénaturation de l' ADN à 95 °C pendant 1 min , une hybridation des amorces à différentes températures ( de 47 à 62 °C ) pendant 1 min , et une élongation à 72 °C pendant 2 min . Cette amplification est suivie d' une extension finale de 5 min à 72 °C. Les produits de PCR sont séparés sur gel d' agarose à 1 , 5 % et visionnés aux UV . VI.3 . Northern Blotting Les ARNs totaux des différents tissus ( 5 & 206;& 144;g ) sont séparés par électrophorèse en conditions dénaturantes sur un gel d' agarose 1 % ( § VI.1 p 60 ) Après migration , le gel est lavé par 2 bains successifs d' eau bidistillée afin d' éliminer le formaldéhyde qui est préjudiciable à la qualité du transfert . Le gel est équilibré pendant 15 min dans un tampon SSC 20X ( NaCl 3 M ; citrate de sodium 3 M ; pH 7 , 0 ) puis transféré sur une membrane de nylon ( Q-Biogene& 194;& 174; ) dans le même tampon . Deux sondes ont été utilisées pour cette étude . Une sonde correspondant au produit de PCR de 349 pb obtenu par amplification de l' ADNc de l' armadillidine en utilisant les amorces Arm 5 et Arm 6 , et une sonde correspondant à l' ADNc partiel codant l' actine d' Armadillidium vulgare . Chaque sonde à tester est marquée par la méthode d' amorçage aléatoire . Pour cela , les fragments d' ADNc ( 100 ng dans 22 & 206;& 144;l d' eau bidistillée stérile ) sont dénaturés ( 100 °C , 5 min ) , puis refroidis sur glace . La solution est mélangée à 5 & 206;& 144;l d' une solution d' hexadésoxyribonucléotides ( Pharmacia ) , 20 & 206;& 144;l de tampon de réaction ( N- [ 2- hydroxyéthyl ] pipérazine- [ 2 - éthanesulfonate ] ( HEPES ) 0 , 5 M , pH 6 , 6 ; MgCl 2 12 mM ; & 206;& 134;-mercaptoéthanol 25 mM ; Tris-HCl 12 mM , pH 8 , 0 ) , contenant les désoxyribonucléotides dATP , dTTP , dGTP ( 0 , 1 mM chacun ) , 2 & 206;& 144;l de la solution de nucléotides radioactifs [ & 206;& 133;- 32 P ] -dCTP ( 3 Ci / & 206;& 144;mol ; 10 & 206;& 144;Ci / & 206;& 144;l ; Amersham ) et 0 , 8 & 206;& 144;l d' une solution d' ADN polymérase ( fragment de Klenow , 6 U / & 206;& 144;l , Gibco-BRL ) ( Feinberg et al. , 1983 ) . Le mélange réactionnel est incubé pendant 2h à 37 °C , puis la réaction est stoppée par addition de 20 & 206;& 144;l d' une solution d' EDTA 0 , 5 M , pH 8 , 0 . Une fraction de 0 , 5 & 206;& 144;l , prélevée avant l' arrêt de la réaction , est précipitée dans 5 ml d' acide trichloracétique ( 10 % ) pour mesurer la radioactivité incorporée après filtration sur membrane Whatman GF / C . La membrane de nylon , sur laquelle les ARNs ont été transférés , est réhydratée dans une solution d' EDTA 2 mM pH 8 , 0 , SDS 0 , 1 % , puis préhybridée pendant 2 h à 42 °C dans le tampon d' hybridation [ formamide 40 % ; Dextran sulphate 10 % ; SSC 4X ; Denhardt's solution 1X ( Ficoll type 400 , 10 mg / ml ; BSA 10 mg / ml ; Polyvinylpyrrolidone 10 mg / ml ) ; Tris-HCl 20 mM , pH 7 , 4 , 0 , 3 mg / ml de sperme de saumon fraîchement dénaturé ] . L' hybridation dans le tampon d' hybridation contenant la sonde radioactive est réalisée pendant la nuit à 42 °C. La membrane est ensuite lavée 2 fois pendant 30 min avec une solution de SSC 2X , SDS 0 , 1 % à température ambiante , puis 2 fois 30 min à 52 °C avec une solution de SSC 0 , 1X , SDS 0 , 1 % . La membrane ainsi hybridée est révélée et analysée par un phosphorImager ( Storm& 226;& 132;& 162; system , Molecular Dynamics ) . VI.4 . Clonage de différents ADNc Afin d' obtenir la séquence complète codée par le cadre de lecture ouvert du gène de l' armadillidine et du gène de l' hémocyanine , 1 & 206;& 144;g d' ARNs totaux d' hémocytes et de caecums digestifs ( lieux de synthèse respectifs de ces 2 molécules ) ont été amplifiés en utilisant la technique SMART ( SMART& 226;& 132;& 162;PCR cDNA synthesis kit , Clontech ) selon les instructions du fabriquant . Les produits de PCR obtenus ( correspondant aux ADNc pleine taille ) ont ensuite été clonés dans le vecteur pGEM- T-easy ( Promega ) . La sélection des clones positifs a été effectuée par PCR sur les colonies obtenues en utilisant des amorces spécifiques de l' armadillidine ou de l' hémocyanine . Le programme de PCR comportait 35 cycles de 2 min à 94 °C , 1 min à 55 °C , 4 min à 72 °C et une étape finale à 72 °C pendant 5 min . Au moins 3 clones positifs , pour l' armadillidine et l' hémocyanine , ont été séquencés dans les 2 directions par un séquenceur d' ADN automatisé ( ABI Prism model 377 , Perkin- Elmer ) . Figure 8 : Schéma de la construction d' une banque d' ADNc à l' aide du kit Creator TM Smart TM cDNA Library Construction ( Clontech ) . Les séquences nucléotidiques et d' acides aminés déduites ont été comparées dans les bases de données disponibles sur le Biotechnology information du National Institut of Health ( NIH ) par le service BLAST . VI.5 . Construction d' une banque d' ADNc d' hémocytes d' Armadillidium vulgare Un microgramme d' ARNs totaux , issus des hémocytes , a été utilisé pour construire une banque d' ADNc . Cette banque a été réalisée à l' aide du kit Creator SMART cDNA Library Construction Kit ( Clontech ) , selon les recommandations du fabriquant . Brièvement , une amorce oligo ( dT ) modifiée ( CDS III / 3 ' ) amorce la synthèse du premier brin d' ADNc qui , lorsqu' elle se termine , permet la ligature d' un adaptateur ( oligo SMART IV ) à l' extrémité 5 ' de l' ADNc ( Figure 8 ) . L' utilisation d' amorces de séquences complémentaires aux séquences des adaptateurs CDS III et SMART IV permet d' amplifier l' ADNc par une PCR longue distance ( LD-PCR ) et ce , afin de générer des ADNc pleine taille . Avec ce kit , la fabrication des ADNc pleine taille selon la technologie SMART permet l' incorporation de sites de restriction asymétriques Sfi ( A et B ) contenus dans les adaptateurs CDS III et SMART IV respectivement localisés aux extrémités 3 ' et 5 ' ( Figure 9 ) . Figure 9 . Comparaison des séquences de reconnaissance Sfi I ( A et B ) Après digestion Sfi I et fractionnement par taille , l' ADNc est ligaturé dans le vecteur pDNR-LIB prédigéré par Sfi I . Des bactéries ultracompétentes sont transformées par choc thermique ( 30s , 42 °C ) avec le plasmide recombinant et étalées sur un milieu LB ( Tableau 2 , p 42 ) gélosé supplémenté de 30 & 206;& 144;g / ml de chloramphénicol . La taille des inserts contenus dans 20 clones prélevés au hasard a été estimée par PCR , en utilisant des amorces spécifiques du vecetur pDNR-LIB , et en moyenne chaque recombinant contient un insert d' ADNc de 1 kb . VII . APPROCHE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE VII .1 . Microscopie photonique Les hémocytes d' Armadillidium vulgare ont été observés en microscopie photonique afin de les dénombrer . Pour ce faire , l' hémolymphe ( 15 & 206;& 144;l ) de 20 animaux est prélevée séparément dans une solution anticoagulante ( MAS , v / v ) , puis un aliquot de chaque prélèvement ( 5 & 206;& 144;l ) est dilué et coloré dans 15 & 206;& 144;l de bleu Trypan ( 0 , 4 % dans du MAS ) . La préparation colorée ( 20 & 206;& 144;l ) est étalée sur une cellule de Mallassez , observée à l' aide d' un microscope inversé , ce qui permet de compter les hémocytes . VII .2 . Microscopie électronique à transmission ( MET ) Fixation des hémocytes L' hémolymphe de 10 à 30 animaux est prélevée , sur glace , dans une solution anticoagulante ( MAS , v / v ) . Les hémocytes sont séparés du plasma par centrifugation ( 800 X g , 4 °C , 15 min ) , puis lavés par une solution de MAS et centrifugés à nouveau dans les mêmes conditions . Pour cette étude de cytologie fine , la technique de double fixation adaptée aux isopodes terrestres ( Martin , 1981 ) a été mise en oeuvre avec quelques modifications . Le culot d' hémocytes lavé est plongé dans le premier fixateur refroidi ( glutaraldéhyde 9 % ; cacodylate de sodium 0 , 3 M , pH 7 , 3 - 7 , 4 ; NaCl 3 % ; v / v / v ) pendant 45 min à 4 °C. Après centrifugation ( 800 X g , 4 °C , 15 min ) , les cellules sont placées dans une solution de lavage ( cacodylate de sodium 0 , 3 M ; NaCl 3 % ; sucrose 0 , 8 M ; v / v / v ) pendant 15 min à 4 °C. Dans cette solution de lavage , le rôle du sucrose est de maintenir l' osmolarité à 750 mOsm . Après centrifugation ( 600 X g , 10 min , 4 °C ) , le culot d' hémocytes est inclus dans une solution de gélose à 2 % à la limite de la solidification ( environ 37 °C ) . Après la prise en masse de la gélose , des petits cubes d' un mm 3 sont découpés , sous loupe binoculaire , à l' endroit où la concentration en cellules parait importante . Ces cubes sont plongés dans la solution de lavage iso-osmotique pendant 2h à 4 °C. Ensuite , après élimination du liquide de lavage , les blocs de gélose sont incubés dans le post-fixateur au tetroxyde d' osmium ( cacodylate de sodium 0 , 3 M ; NaCl 5 , 5 % ; OsO 4 4 % ; v / v / v ) pendant 45 min . La déshydratation est réalisée dans des solutions d' acétone de concentration croissante ( de 35 % à 100 % ) . L' imprégnation est effectuée en 2 étapes : - la première dans un mélange ( v / v ) acétone 100 % -résine ( Spurr , Polyscience Inc . ) pendant 12 h à température ambiante . - la seconde dans la résine pure dans les mêmes conditions . L' inclusion est effectuée dans des « moules à plat » qui permettent une orientation des pièces ; la résine est mise à polymériser pendant 24h dans une étuve à 70 °C. Les coupes semifines et ultrafines sont réalisées sur un ultramicrotome ( Reichert OMU3 ) muni soit d' un couteau de verre , soit d' un couteau de diamant . Les coupes semifines d' 1 & 206;& 144;m d' épaisseur sont colorées au bleu de Toluidine à 1 % ( pH 8 , 8 ) . Les coupes ultrafines , récoltées sur des grilles en cuivre ( 300 mesh ) sont contrastées selon la méthode de Reynolds ( 1963 ) en 2 temps : - acétate d' uranyle 1 % dans de l' alcool 50 % , 1 min - citrate de plomb , 10 min ( à l' obscurité ) Les observations ont été effectuées sur le microscope électronique à transmission JEOL 100C du Service Interdisciplinaire de Microscopie et d' Imagerie Scientifique ( SIMIS , université de Poitiers ) . Fixation des organes hématopoïétiques Les organes hématopoïétiques des animaux sains subissent une double fixation classique . Par contre , les organes hématopoïétiques des animaux infectés par Wolbachia , subissent une post-fixation réduite en temps ( 5 min ) avec une concentration en OsO 4 amenée à 1 % final afin de préserver leur intégrité . Fixation en vue de l' étude des phénomènes d' encapsulation et de phagocytose Afin de mettre en évidence les phénomènes d' encapsulation , des petits cylindres de résine ont été coulés puis , après polymérisation , découpés en morceaux de 5 mm environ , et ont ensuite été introduits sous la cuticule des animaux . Après quelques jours d' implantation ( 8 et 16 jours ) , les animaux ont été disséqués et les morceaux de résine récupérés . Ces cylindres de résine ont été fixés de la même manière que les organes hématopoïétiques sains . Pour rendre compte du pouvoir de phagocytose de certains hémocytes , des particules d' encre de Chine ont été inoculées à des d' animaux . L' encre de Chine ( Pelikan , Günther Wagner ) contient du phénol qui est toxique pour nos animaux , il convient donc de l' éliminer . Pour ce faire , 200 & 206;& 144;l d' encre de Chine sont centrifugés ( 15 000 X g , 10 min ) et le surnageant contenant le phénol est éliminé . Le culot de particules est resuspendu dans 200 & 206;& 144;l d' eau bidistillée puis centrifugé ( 15 000 X g , 10 min ) . Le culot de particules est ainsi lavé 2 fois , puis est repris dans 50 & 206;& 144;l de Ringer . Cette suspension est injectée dans la cavité générale à raison de 1 & 206;& 144;l par animal et ce , sans trouble ( s ) apparent ( s ) . L' hémolymphe a été prélevée 2 et 3 jours après l' injection et les hémocytes ont subit une double fixation classique , comme précédemment décrit pour ces cellules ( § VII . 2 . p 66 ) . VII .3 . Microscopie électronique à balayage ( MEB ) L' échantillon biologique doit être préparé afin de supporter au mieux le vide dans le microscope et l' impact du faisceau . S' agissant de cellules libres , il faut les fixer sur un support : nous avons utilisé des lamelles de verre . Des lamelles , lavées à l' acétone , sont plongées dans une solution de polylysine 0 , 1 % ( pH 8 , 5 ) pendant 5 min puis elles sont rincées à l' eau bidistillée et séchées à l' air libre . 3.1 . Application de la double fixation Nous avons utilisé les mêmes fixateurs et liquides de lavage que dans la technique de fixation appliquée pour le microscopie à transmission ( § VII . 2 . p 66 ) . En bref , sur les lamelles recouvertes de polylysine , disposées au fond d' une boîte de Pétri , nous déposons 200 & 206;& 144;l du premier fixateur ( glutaraldéhyde 9 % ; cacodylate de sodium 0 , 3 M pH 7 , 3 - 7 , 4 ; NaCl 3 % ; v / v / v ) puis 20 & 206;& 144;l d' hémolymphe instantanément prélevés ; la fixation a lieu à 4 °C pendant environ 1h30 . Les lamelles sont essorées sur le tranche et plongées délicatement dans une coupelle contenant le liquide de lavage pendant 1h. Après aspiration du liquide de lavage , le deuxième fixateur ( tetroxyde d' osmium ) est introduit dans la coupelle pendant 10 à 15 min , à température ambiante . Après aspiration du post fixateur , une déshydratation progressive par l' alcool est opérée ( 35 % à 100 % ) . 3.2 . Passage au point critique et métallisation Afin de limiter les déformations des cellules lors de la dessiccation un appareil ( type Balzers ) permet de substituer le CO2 liquide au solvant intermédiaire ( alcool 100 % ) . Le CO2 est utilisé pour les caractéristiques de son point critique : température 32 °C sous une pression de 73 atmosphères . La métallisation consiste à recouvrir l' échantillon parfaitement desséché d' une mince couche d' un métal conducteur ( Au ) ce qui permet d' accroître l' émission d' électrons secondaires . Cette opération est réalisée avec un pulvérisateur cathodique Balzers . La couche d' or est très homogène et atteint 20 nm d' épaisseur ( pour un temps de pulvérisation de 200s ) . Les observations ont été effectuées sur le microscope électronique à balayage ( JEOL 840A , scanning microscope ) du SIMIS ( Poitiers ) . Chapitre I Cellules impliquées dans la réponse immunitaire : Approche histologique et cytologique CELLULES IMPLIQUÉES DANS LA RÉPONSE IMMUNITAIRE : A PPROCHE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE Les animaux pluricellulaires se protègent des infections microbiennes par deux types de réponse immunitaire , la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire acquise . Ces deux types de réponse , encore appelées réponse immédiate et réponse adaptative respectivement , se manifestent uniquement chez les vertébrés . Chez les invertébrés , seule l' immunité innée existe . C' est un système de défense rapide et efficace qui fait intervenir deux types de réponses , une réponse humorale et une réponse cellulaire . Chez les arthropodes , les hémocytes ( cellules circulantes dans l' hémolymphe ) jouent un rôle primordial dans les deux aspects de la réponse immunitaire innée . Chez les insectes , il est maintenant généralement admis que trois types cellulaires composent la population d' hémocytes circulants dans la cavité générale , les plasmatocytes , les granulocytes et les oenocytes . Les plasmatocytes et les granulocytes sont des cellules qui possèdent des facteurs d' adhésion et qui sont impliquées dans la phagocytose et dans la formation de capsules et de nodules . Les oenocytes ne possèdent pas ces facteurs d' adhésion mais contiennent les précurseurs de la phénoloxydase , enzyme principale de la cascade de mélanisation ( Lavine et Strand , 2002 ; pour revue ) . Chez la drosophile , exceptés les plasmatocytes , les cellules hémocytaires ne portent pas les mêmes noms , les cellules à cristaux correspondent aux oenocytes et les lamellocytes aux cellules granulaires ( Meister , 2004 ) . Chez les crustacés , beaucoup moins d' informations sont disponibles sur la morphologie et la structure des hémocytes , mais également sur la représentation des différentes populations d' hémocytes . Les crustacés décapodes possèdent trois types d' hémocytes morphologiquement différents ( Bauchau , 1980 ) . Ces populations ont notamment été décrites chez les crevettes ( Vazquez et al. , 1997a ; Gargioni et Barracco , 1998 ) , chez l' écrevisse et chez le crabe ( Söderhäll et Smith , 1983 ) . On trouve ainsi ( 1 ) les hémocytes hyalins dépourvus de granules ; ( 2 ) les hémocytes semi-granulaires pourvus de petits granules en nombre variable ; ( 3 ) les hémocytes granulaires pourvus de gros granules en grand nombre . Concernant la fonction de ces hémocytes , l' ambiguïté porte sur les cellules douées de phagocytose . Des études réalisées chez les crevettes ont montré que les hémocytes granulaires et semi-granulaires sont les cellules phagocytaires ( Hose et al. , 1990 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) et que les cellules hyalines jouent un rôle dans la coagulation . En effet , les cellules hyalines comportent chez ces espèces moins de protéines que les deux types granulaires et notamment moins de protéines lysosomales ( Hose et al. , 1990 ; Lanz et al. , 1993 ) . Des études similaires faites chez les crabes et les écrevisses ont montré que les hémocytes hyalins présentent également moins de protéines que les deux autres types cellulaires ( Johansson , 1999 ) , mais qu' ils sont principalement impliqués dans la phagocytose , même si les hémocytes semi-granulaires peuvent également , dans une moindre mesure , jouer ce rôle . Les hémocytes granulaires et semi-granulaires , quant à eux , stockent dans leurs granules les protéines du système immunitaire , tels que les agglutinines , les péroxinectines , des enzymes cytolytiques , toutes les enzymes du système prophénoloxydase , les peptides antibactériens . Ces protéines sont libérées de façon coordonnée sur le site de l' infection ou de la blessure ( Smith et Söderhäll , 1983 ; Söderhäll et al. , 1985 ; Söderhäll et al. , 1986 ; Kobayashi et al. , 1990 ; Johansson et al. , 2000 ) . Chez les isopodes terrestres , les seules données disponibles concernant les différentes populations d' hémocytes sont consignées dans la thèse de M-F Coutant , ( 1977 ) . Ce travail sur l' étude cytologique et fonctionnelle des hémocytes et des organes hématopoïétiques est centré sur l' isopode terrestre Porcellio dilatatus . Chez cette espèce , assez proche phylogénétiquement de notre modèle Armadillidium vulgare , cinq types d' hémocytes ont été décrits . Ces cinq types peuvent être néanmoins regroupés au sein des trois types d' hémocytes décrits précédemment chez les décapodes . La première population est constituée de cellules dépourvues de granule et appelées cellules hyalines . Les deuxième et troisième populations correspondent respectivement aux hémocytes semi-granulaires et granulaires et sont spécialisées dans la production , le stockage et la sécrétion de protéines . En effet , l' appareil de golgi et le réticulum endoplasmique granulaire y sont très développés et les substances élaborées s' accumulent dans les granules . Figure 10 : Hémocytes observés au microscope électronique à balayage . A . Ensemble de la population hémocytaire , cellules de tailles et de formes différentes ( X 700 ) . B . Hémocytes lisses , cellules arrondies de petite taille ( X 2 300 ) . C . Hémocyte hérissé , cellule ovoïde de grande taille présentant de nombreuses aspérités favorisant l' adhésion ( X 3 300 ) . Avant d' entreprendre une étude moléculaire et d' identifier les protéines impliquées dans la réponse immunitaire innée , il convenait de caractériser par des caractères cytologiques les différents types d' hémocytes chez Armadillidium vulgare . I. OBSERVATION DES HÉMOCYTES EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE ÀBALAYAGE . Nous avons donc , dans un premier temps , observé les différentes populations d' hémocytes chez Armadilidium vulgare infectés ou non par Wolbachia en microscopie électronique à balayage ( MEB ) . Pour l' observation des hémocytes en MEB , l' hémolymphe a été placée directement sur des lamelles préalablement induites de polylysine , puis ont alors subi les traitements appropriés pour une bonne visualisation ( §VII . 3 . p 68 ) . La population d' hémocytes ( Figure 10 , A. ) semble très hétérogène , les cellules présentent des tailles différentes mais également des formes très variées , allant de cellules très aplaties à des cellules très rondes . Les figures 10 , B . et C. montrent deux types de cellules : - Des hémocytes de petite taille ( 8 & 206;& 144;m environ ) - Des hémocytes ovoïdes , d' aspect hérissé , plus gros que les précédents ( 12 & 206;& 144;m ) et qui présentent de nombreuses aspérités II . OBSERVATION DES HÉMOCYTES EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION Afin d' affiner la caractérisation morphologique de différents types d' hémocytes , nous avons eu recours à l' observation en microscopie électronique à transmission ( MET ) qui nous apportait des caractères cytologiques . Pour ce faire , un pool d' hémocytes ( 10 animaux ) a été fixé , inclus en gélose pour faciliter les manipulations , puis traité selon le protocole classique de préparation des échantillons pour l' observation en MET ( § VII . 2 . p 66 ) . L' observation de coupes ultrafines contrastées nous a permis de mettre en évidence la présence de trois types d' hémocytes chez Armadillidium vulgare ( Figure 11 ) . Les différents types d' hémocytes observés correspondent à ceux décrits chez Porcellio dilatatus ( Coutant , 1977 ) et ceux décrits chez les crustacés décapodes ( Bauchau , 1980 ) . Les hémocytes hyalins sont constitués d' un noyau volumineux avec des contours réguliers , ils ne présentent pas de granules . Les hémocytes semi-granulaires , qui constituent la population la plus importante , sont caractérisés par la présence plus ou moins abondante de petits granules , denses aux électrons , arrondis , d' un diamètre variant de 0 , 3 à 0 , 8 & 206;& 144;m . Le rapport noyau / cytoplasme dans ces cellules est beaucoup moins important que celui des hémocytes hyalins . Les hémocytes granulaires , quant à eux , présentent de nombreux gros granules , également denses aux électrons , piriformes , d' un diamètre de 0 , 6 à 1 , 6 & 206;& 144;m , mais également un noyau peu volumineux et ayant des contours irréguliers . Comme chez Porcellio dilatatus , il semble que la population la plus représentée soit celle des hémocytes semi-granulaires , population qui augmente avec l' âge de l' animal ( Coutant , 1977 ) , tandis que la moins fréquente est constituée des hémocytes hyalins . Le nombre d' hémocytes granulaires est intermédiaire entre les deux autres populations . Cette caractéristique se retrouve également chez Macrobrachium rosenbergii ou Macrobrachium acanthurus ( décapodes palaemonides ) , cependant ceci n' est pas une généralité chez les crustacés car chez Penaeus paulensis paulensis , par exemple , ce sont les hémocytes hyalins qui sont le plus représentés dans l' hémolymphe ( Gargioni et Barracco , 1998 ) . Mis à part leur variation numérique , les trois types d' hémocytes d' Armadillidium vulgare sont semblables cytologiquement à ceux décrits dans l' ensemble des crustacés . Nous pouvons donc supposer que leurs implications dans la réponse immunitaire seront proches de celles décrites chez les écapodes et principalement chez l' écrevisse ( Pacifastacus leniusculus ) pour laquelle la réponse immunitaire est la mieux décrite . A . Hémocyte hyalin : noyau volumineux , absence de granules . B . Hémocyte semi-granulaire : présence de petits granules peu nombreux , noyau peu volumineux . C . Hémocyte granulaire : noyau peu volumineux , présence de gros granules piriformes en grand nombre . Figure 11 : Les différents types cellulaires observés dans l' hémolymphe d' Armadillidium vulgare . A . Hémocyte hyalin . B . Hémocyte semi-granulaire . C . Hémocyte granulaire . Figure 12 : Hémocyte granulaire d' Armadillidium vulgare infecté par Wolbachia , observé au microscope électronique à transmission ( X 8 000 ) . La cellule contient de nombreux granules plus ou moins denses . Le noyau présente une forme très contournée . Si des agents pathogènes franchissent la première barrière physique , constituée par le tégument , les hémocytes vont détecter les microorganismes et déclencher la réponse immunitaire . Chez l' écrevisse , il a été montré que ce sont les cellules semi-granulaires qui sont les plus sensibles aux microorganismes et qui réagissent en premier . Elles vont activer , par l' intermédiaire de protéines telles que les péroxinectines , les cellules granulaires qui ainsi stimulées vont libérer dans le plasma les composants du système prophénoloxydase , mais aussi des peptides antibactériens et d' autres molécules impliquées dans la réponse immunitaire ( Söderhäll et al. , 2003 ) . Les hémocytes semi-granulaires et les hémocytes granulaires sont impliqués dans les phénomènes d' encapsulement des particules étrangères de grande taille , cependant les cellules semi-granulaires semblent être plus actives . Bien que de façon limitée , les cellules semi-granulaires possèdent également la capacité de phagocyter les microorganismes , ce sont les cellules hyalines qui sont les principales cellules phagocytaires ( Thörnqvist et Söderhäll , 1997 ) . III . « FRAGILITÉ » DES HÉMOCYTES INFECTÉS PAR Wolbachia Des observations de cytologie structurale ont été réalisées de façon complémentaire chez Armadillidium vulgare infecté par Wolbachia . Les mêmes types hémocytaires ont été retrouvés , la seule différence cytologique visible étant la présence d' éléments bactériens dans les cellules hémocytaires . La Figure 11 présente un hémocyte granulaire contenant une bactérie . Cette bactérie est ici située à l' intérieur d' une vacuole à proximité du noyau . La bactérie semble ainsi être enfermée dans un endosome qui n' aurait pas fusionné avec les lysosomes , puisque normalement cette fusion devrait conduire à la destruction de la bactérie . La présence de la bactérie dans une vacuole laisse penser qu' elle entre dans les cellules par des phénomènes d' endocytose ou de phagocytose . Cependant , la bactérie est retrouvée préférentiellement dans les cellules granulaires , ce qui est en première analyse , contradictoire avec la capacité de ces cellules à phagocyter les corps étrangers , si on se réfère aux études réalisées sur l' écrevisse . En effet , chez l' écrevisse , les cellules hyalines et parfois les cellules semi-granulaires sont considérées comme les cellules phagocytaires les plus efficaces ( Söderhäll et al. , 2003 ) . Même s' il ne semble pas exister de différences notables dans l' ultrastructure même de la cellule , les hémocytes d' Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia apparaissent , dès la réalisation des coupes semi-fines , sans contraste entre les parties nucléaires et cytoplasmiques . L' observation des coupes ultrafines confirme cette dégradation qui se manifeste par de nombreuses vacuoles , des figures myéliniques et une mauvaise préservation des membranes plasmiques et nucléaires . Ainsi , il semble que ces cellules soient particulièrement sensibles à l' action du tétroxyde d' osmium ; pour obtenir nos clichés , nous avons dû adapter la concentration et le temps d' action de ce composé lors de la post-fixation . Cette fragilité pourrait s' expliquer par la présence de la bactérie qui serait capable d' interagir avec les éléments du cytosquelette . Ce type d' interactions a été décrit chez les Ehrlichia , les Rickettsia ( Gouin et al. , 2005 ) mais également chez d' autres bactéries non endocellulaires comme les Listeria ( Loisel et al. , 1997 ) ou les Salmonella ( Brumell et Grinstein , 2003 ; pour revue ) . De même , il est couramment admis que lors de relations hôte / parasite , le cytosquelette des individus hôtes est déstabilisé soit par le parasite lui-même [ cas des Leishmania ( Lodge et Descoteaux , 2005 ) ] , soit par des virus mutualistes que portent certains parasitoïdes [ cas des endoparasites d' invertébrés ; ( Turnbull et al. , 2004 ) ] . Les altérations de la structure du cytosquelette peuvent concerner les fibres d' actine ou les microtubules mais également les protéines liant ces complexes fibrillaires ( Rikihisa et al. , 1994 ; Gouin et al. , 2005 ; Selbach et Backert , 2005 ) . Une étude sur l' inhibition de l' endocytose des Ehrlichia risticii risticii par les macrophages a montré que les clathrines , les microfilaments et les microtubules jouaient un rôle dans l' entrée des bactéries dans la cellule mais aussi sur leur prolifération ( Rikihisa et al. , 1994 ) . La confirmation de cette désorganisation suspectée du cytosquelette pourra être analysée en microscopie confocale par exemple , en marquant les fibres d' actine et les microtubules et en comparant les hémocytes infectés ou non par la bactérie . Pour marquer Wolbachia , l' utilisation d' anticorps anti-wsp couplés à un fluorochrome différent de ceux utilisés pour le cytosquelette permettrait de localiser les bactéries par rapport au cytosquelette . Wsp est une protéine membranaire du feuillet externe de la paroi de Wolbachia qui a été caractérisée initialement par Braig ( Braig et al. , 1998 ) chez une souche parasite de la drosophile , puis qui a été mise en évidence chez la plupart des souches de Wolbachia présentes chez de nombreux arthropodes ( Bouchon et al. , 1998 ; Jeyaprakash et Hoy , 2000 ) . En plus de cette atteinte probable sur le cytosquelette , il est à noter que lors de comptages des hémocytes , nous avons toujours enregistré une baisse significative du nombre des hémocytes chez les animaux infectés par la bactérie ( Annexe II ) . Cependant , Coutant ( 1977 ) a montré que le nombre d' hémocytes varie selon le cycle de mue et qu' il devient plus important juste avant la mue . Cette augmentation brutale ( X2 ) du nombre d' hémocytes pourrait être destinée à prévenir l' augmentation du volume hémolymphatique consécutive à l' absorption d' eau qui accompagne l' exuviation . De plus , cet auteur a démontré que le nombre d' hémocytes augmentait avec la masse des animaux . Ce dernier paramètre n' ayant pas été pris en considération lors de notre étude , il conviendrait de réitérer cette expérience en tenant compte de la masse , de l' âge et du stade de mue des animaux . De nos observations , il ressort que Wolbachia semble : - modifier le nombre d' hémocytes circulants ( diminution ) ; cette variation quantitative peut être liée à un ralentissement du fonctionnement des organes hématopoïétiques , ainsi qu' à une réduction de la durée de vie des hémocytes parasités . - les rendre plus fragiles et plus « sensibles » à la fixation , ce que nous avons interprété comme une possible déstabilisation du cytosquelette . IV . ASSIGNEMENT DE LA FONCTION DE PHAGOCYTOSE Notre modèle semblant s' écarter du modèle écrevisse , nous avons voulu savoir quels étaient les types cellulaires impliqués dans la phagocytose . Pour cela , nous avons injecté une suspension de particules d' encre de chine ( 30 - 40 nm ) à nos animaux et après 2 ou 3 jours d' incubation , nous avons collecté les hémocytes puis nous les avons traités en vue d' observations en MET . L' examen à l' échelle ultrastructurale nous a montré que les particules d' encre de chine ont été phagocytées principalement par les cellules hyalines ( Figure 13 ) . Dans ces cellules , de nombreux lysosomes contenant les particules d' encre de chine mais également des endosomes primaires sont observables . Des particules ont également été retrouvées dans des lysosomes d' hémocytes semi-granulaires , par contre nous n' avons jamais observé de cellules granulaires contenant de particules d' encre de chine . Il semblerait donc que chez Armadillidium vulgare , comme chez l' écrevisse , les cellules hyalines et semi-granulaires possèdent les propriétés de phagocytose , à l' opposé de ce qui a été décrit chez les crevettes chez lesquelles ce sont les cellules granulaires qui jouent principalement ce rôle . De ce fait , la présence de Wolbachia dans les cellules granulaires ne serait pas la conséquence d' une phagocytose mais plutôt d' une endocytose , probablement provoquée par la bactérie elle-même . Ce type d' endocytose provoquée par une bactérie a déjà été montré chez des bactéries endocellulaires comme Ehrlichia risticii risticii ( Rikihisa et al. , 1994 ) ou d' autres bactéries du genre Rickettsia mais également chez des bactéries telles que les Brucella ( Gorvel et Moreno , 2002 ) ou les Salmonella ( Brumell et Grinstein , 2004 ; pour revue ) . Figure 13 . A. : Cellules hyalines d' Armadillidium vulgare après injection de particules d' encre de chine ( 30 - 40 nm ) . Les particules d' encre de chine sont observées dans des lysosomes . La présence d' endosomes primaires témoigne de l' activité phagocytaire et lysosomale . Figure 13 . B : Hémocyte semi-granulaire d' Armadillidium vulgare après injection de particules d' encre de chine ( X 12 000 ) . Les particules sont visibles dans des vacuoles lysosomales . V. ASSIGNEMENT DE LA FONCTION D' ENCAPSULATION Un autre point intéressant était de savoir si Wolbachia inhibait les fonctions des hémocytes , notamment leur capacité à adhérer , à encapsuler , mais également leur capacité à produire des protéines conduisant à la mélanisation . Une première expérience d' encapsulation a été réalisée . Un bâtonnet de résine polymérisé a été introduit dans la cavité générale d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia . Les animaux ont été disséqués 8 et 16 jours après implantation et les capsules ( bâtonnets enrobés par les hémocytes ) ont été fixées pour des observations en microscopie électronique à transmission et à balayage . Quels que soient les animaux considérés , les capsules présentent le même état général . Les hémocytes ont adhéré à la résine , se sont allongés et ont créé une gangue constituée d' un empilement de plusieurs couches ( Figure 14 ) . Les premières couches de cellules déposées sont très aplaties , les organites et les noyaux ne sont plus visibles . Après 8 et 16 jours , les capsules sont bien formées et de nouveaux hémocytes sont toujours recrutés à la périphérie . Les cellules nouvellement arrivées adhèrent à la capsule mais ne sont pas encore étirées . Chez les deux types d' animaux , les cellules semi- granulaires semblent les plus impliquées dans ce phénomène d' encapsulation , ce qui est en accord avec la description de capsules obtenues chez Porcellio dilatatus ( Coutant , 1977 ) . Des phénomènes de mélanisation sont observables , témoignant de la libération locale des protéines contenues dans les granules hémocytaires ( système prophénoloxydase ) . Ces phénomènes de mélanisation sont détectés après plusieurs jours au niveau de l' empilement des hémocytes . Certaines cellules présentent les caractéristiques d' entrée en apoptose avec la formation de corps myéliniques et une dissociation particulière du noyau . Cette lyse cellulaire conduit ainsi à la libération du contenu des granules hémocytaires et notamment des enzymes de la cascade de mélanisation ( ProPO , ppA ... ) et des protéines d' agglutination ( Mitta et al. , 1999 ; Destoumieux et al. , 2000 ) . En microscopie à balayage , les capsules apparaissent entourées d' un réseau de lanières intriquées constituées par les hémocytes accolés et allongés ( Figure 15 p 84 ) . De nouvelles cellules continuent à venir adhérer sur la capsule au niveau de ces sangles adhésives . Chez Armadillidium vulgare , les hémocytes présentent de nombreuses villosités ( les cellules semblent hérissées ) contrairement aux hémocytes des animaux infectés par Wolbachia qui semblent rester beaucoup plus ronds et plus lisses . A . Hémocytes accolés et allongés ( X 6 000 ) Mélanisation Corps myélinique B . Hémocytes accolés et allongés ( X 8 000 ) C . Hémocytes étirés Hémocytes semi- granulaires ( X 6 000 ) nouvellement fixés , pas encore étirés Figure 14 : Encapsulement d' un bâtonnet de résine , après 8 jours d' incubation dans la cavité générale , par les hémocytes d' Armadillidium vulgare infecté ( C. ) ou non ( A. et B. ) par Wolbachia . S' il ne semble donc pas y avoir de différences notables entre les animaux infectés ou non par Wolbachia quant à l' adhésion des cellules hémocytaires , la capacité des cellules à s' étirer et à produire des digitations semble amoindrie chez les animaux infectés par Wolbachia . Cette observation renforce l' hypothèse d' une déstabilisation du cytosquelette . Cette étude préliminaire nécessitera d' être confirmée et approfondie , d' une part pour observer si les hémocytes des animaux infectés par Wolbachia présentent toujours moins de digitations et , d' autre part , corréler cette perte de fonction à un éventuel retard dans la formation des capsules . Pour ce faire , le prélèvement des capsules devra être effectué à des temps plus courts , permettant d' observer la cinétique de l' évolution de la capsule dans les premiers jours . Capsule hémocytaire de 16 jours [ A.vulgare ( X 260 ) ] . Capsule hémocytaire de 16 jours . De nouvelles cellules ( présence de cellules hérissées ) adhèrent à la surface de la capsule [ A.vulgare ( X 780 ) ] . Capsule hémocytaire de 16 jours . De nouvelles cellules adhèrent ( les hémocytes sont moins nettement hérissés ) [ A.vulgare infecté par Wolbachia ( X 660 ) ] . Figure 15 : Encapsulement d' un bâtonnet de résine , après 16 jours d' incubation dans la cavité générale , par les hémocytes d' Armadillidium vulgare infecté ou non par Wolbachia . VI . OBSERVATION DES ORGANES HÉMATOPOÏETIQUES Les hémocytes des crustacés , comme ceux des autres invertébrés , sont produits dans des tissus spécialisés : les organes hématopoïétiques . La localisation et la structure de ces organes sont très variables même au sein de groupes taxonomiques proches . Chez les homards , les crabes ou les écrevisses , le tissu hématopoïétique se présente sous la forme d' une grappe de lobules , couvrant l' estomac broyeur ou le coeur . Les hémocytes sont maturés à l' intérieur des lobules qui présentent des tailles différentes ( Ghiretti-Magaldi et al. , 1977 ; Johnson , 1980 ) . Les cellules souches sont situées sur la bordure apicale de chaque lobule et les hémocytes matures migrent vers la région lacunaire puis sont libérés dans la circulation générale . Chez la crevette Sicyonia ingentis , les nodules hématopoïétiques apparaissent comme deux masses logées sur la face dorso-latérale de l' estomac . Chaque nodule comporte des vaisseaux reliés à l' artère hématopoïétique qui se branche à l' artère ophtalmique antérieurement au coeur . Les cellules souches et les hémocytes en voie de maturation sont logés dans la paroi épaisse des vaisseaux au sein d' une matrice de collagène extracellulaire . La libération des hémocytes dans la circulation ne peut avoir lieu qu' après dégradation de la matrice extracellulaire , ce qui exclut une libération directe et continue ( Martin et al. , 1987 ) . Chez les isopodes oniscoïdes , les organes hématopoïétiques sont au nombre de trois paires localisées dans le sixième et le septième segment du péréion et dans le premier segment du pléon ( Coutant , 1977 ) . Leur aspect a été décrit chez Porcellio dilatatus par l' auteur précité ( Figure 16 ) . Chez Armadillidium vulgare ( porteurs ou non de Wolbachia ) , les organes hématopoïétiques apparaissent sous forme de petits amas qui se présentent comme des aggrégats cellulaires de forme irrégulière , mesurant 50 à 60 & 206;& 144;m d' épaisseur , 150 & 206;& 144;m de long et 150 & 206;& 144;m de large et sont accolés à la face externe du septum péricardique . Chaque organe est constitué de cellules hémocytaires à différents stades de maturation qui semblent empaquetées et entourées par une couche de tissu connectif . Ce tissu semble limité par une membrane basale fibrillaire du côté du septum périphérique . Les cellules les moins matures sont présentes au milieu des amas , dans une zone qui a été décrite par Coutant ( 1977 ) comme la région centrale . Les cellules sont isolées et semblent baigner dans un conjonctif . Les cellules présentent un noyau de petite taille , pourvu de chromatine en mottes ( Figure 17 ) . Le cortex qui entoure la région centrale présente une forte densité cellulaire . Les cellules sont plus grosses et leur migration vers la lame basale semble s' accompagner d' une maturation et d' une différenciation . Le cortex peut être séparé en trois parties : le cortex interne , le cortex central et le cortex lacunaire ( Figure 18 , p 88 ) . Dans la partie interne du cortex , les cellules adhèrent les unes aux autres et s' organisent en travées . Les cellules sont peu différenciées et vont être maturées au cours de leur avancée vers le cortex central puis le cortex lacunaire . A partir du cortex central , deux grands types de cellules sont déjà identifiables dans un même amas , d' une part des cellules dépourvues de granules , probablement précurseurs des cellules hyalines et , d' autre part , des cellules possédant des granules qui seront à l' origine des deux types d' hémocytes granulaires et semi-granulaires . Quelque soit le type cellulaire , la structure des cellules est proche : le noyau est de taille importante , de nombreuses mitochondries sont présentes et le réticulum endoplasmique est bien développé au sein d' un cytoplasme relativement réduit . Figure 16 : Organe hématopoïétique de Porcellio dilatatus : un nodule observé en microscopie photonique ( Coutant , 1977 ) . Le nodule est placé sous le septum périphérique ( SP ) . Il est constitué d' une région centrale ( RC ) qui contient des cellules « souches » dans une matrice , d' un cortex ( Cor ) présentant plusieurs couches de cellules hémocytaires à des stades de maturation différents , d' une région lacunaire ( RL ) représentée par des cellules matures baignant dans une matrice lâche . Matrice de la région centrale Hémocyte immature , présentant des digitations Région du cortex A . Cortex interne ( X 3 000 ) : Les cellules commencent à se joindre les unes aux autres . Elles ne semblent pas dans le même état physiologique ( aspects clairs et sombres ) . B . Cortex central ( X 5 000 ) : Les cellules adhèrent les unes aux autres et débutent leur maturation . De petits granules plus ou moins sphériques sont en formation . C . Cortex latéral ( X 5 000 ) : Les cellules sont matures , les cellules granulaires sont bien identifiables par la présence de leurs nombreux granules polymorphes très denses . Figure 18 : Les trois régions du cortex des organes hématopoïétiques ( Armadillidium vulgare ) . A . Cortex interne . B . Cortex central . C . Cortex latéral . A . 500 nm B . Division cellulaire dans la région centrale de l' organe hématopoïétique . Les figures A. et B. montrent respectivement une cellule en métaphase ( X 5 000 ) et une cellule en anaphase ( X 8 000 ) . Ces cellules présentent très peu de granules . C . Apoptose d' une cellule hémocytaire ( X 5 000 ) peu différenciée dans le cortex interne de l' organe hématopoïétique . Figure 19 : Division ( A. et B. ) et apoptose ( C. ) des cellules hémocytaires dans l' organe hématopoïétique d' Armadillidium vulgare . Dans le cortex latéral , les cellules présentant des granules denses aux électrons sont beaucoup plus nombreuses que les cellules n' en présentant pas , cette proportion est par ailleurs conservée dans l' hémolymphe ou les hémocytes semi-granulaires et granulaires représentent la majorité des hémocytes circulants . De telles observations ont également été rapportées chez le homard Homarus americanus ( Martin et al. , 1993 ) chez lequel les cellules granulaires représentent plus de 90 % des cellules présentes dans les organes hématopoïétiques . Les deux types d' hémocytes granulaires ne sont pas toujours différenciables dans le cortex , principalement à cause des différents stades de maturation des hémocytes . Le cortex est lui aussi entouré d' une région dite lacunaire qui se prolonge par des ramifications de formes assez irrégulières étalées sur le septum péricardique ; cette dernière zone , à faible densité cellulaire , évoque un sinus périphérique . Comme nous l' avons vu , les organes hématopoïétiques sont les lieux de production des hémocytes , et de nombreuses cellules du cortex interne apparaissent en phase de division ( Figure 19 ) . Chez l' écrevisse , il existe une régulation de cette production d' hémocytes dans les organes hématopoïétiques , par des phénomènes d' apoptose ( 5 à 7 % ) ( Söderhäll et al. , 2003 ) . Lorsque le taux d' hémocytes circulants subit une importante chute , lors de la mue , de blessures ou d' infections par exemple , les hémocytes matures sont libérés dans l' hémolymphe , comblant ainsi la perte des cellules impliquées dans les phénomènes de coagulation , de cicatrisation , d' encapsulement ... Les nouvelles cellules alors libérées dans l' hémolymphe vont pouvoir agir pour compléter la réponse immunitaire ou pour remplacer les hémocytes matures dans leur fonction préventive . Il a été récemment montré que lors d' une infection , le taux d' apoptose des hémocytes en formation dans les organes hématopoïétiques diminuait ( moins de 1 % ) , permettant ainsi une libération plus importante d' hémocytes et un renouvellement plus rapide ( Söderhäll et al. , 2003 ) . Toutes nos observations relatives à la cytologie fine ont été effectuées sur des animaux infectés ou non par Wolbachia . Précisons que lors de la fixation des organes Figure 20 : Cellules hémocytaires ( Armadillidium vulgare ) en voie de maturation dans les organes hématopoïétiques infectés par Wolbachia . Des bactéries sont présentes dans le cytoplasme des cellules . hématopoïétiques des animaux infectés par Wolbachia , nous avons constaté la difficulté d' obtenir des tissus bien préservés . En effet , il semble que ces organes soient beaucoup plus fragiles que ceux des animaux non infectés . Cette remarque est en accord avec celle faite lors de la fixation des hémocytes infectés par Wolbachia . Ces bactéries endocellulaires ont été décrites dans tous les tissus étudiés jusqu'à maintenant chez Armadillidium vulgare , cependant nous montrons pour la première fois leur présence dans les organes hématopoïétiques . Cette fragilité cellulaire liée à la présence bactérienne conforte l' hypothèse suspectant une influence sur la structure du cytosquelette des cellules infectées ( Figure 20 ) . Cette étude préliminaire sur les tissus hématopoïétiques devra être poursuivie afin de déterminer leur fonctionnement , que ce soit au niveau de la prolifération ou de l' apoptose des cellules . Une étude du lignage cellulaire pourrait permettre de comprendre la différenciation des trois populations d' hémocytes ainsi que leur relargage dans l' hémolymphe . En effet , chez les crustacés , le lignage des cellules hémocytaires n' a pas été déterminé et actuellement deux hypothèses ont été proposées : - Chez l' écrevisse , il existerait deux lignées cellulaires , l' une conduisant aux hémocytes semi-granulaires et l' autre conduisant aux hémocytes granulaires . - Chez le homard et les crevettes , deux lignées cellulaires ont également été décrites , une évoluant en hémocytes hyalins et une autre évoluant en hémocytes granulaires ( Martin et al. , 1993 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) . Une approche moléculaire pourra également être envisagée , afin de déterminer l' expression de différentes protéines , respectivement dans les organes hématopoïétiques et dans les hémocytes circulants . Récemment , chez l' écrevisse P. leniusculus , une étude de la transcription de certains gènes codant des protéines du système immunitaire a été réalisée sur les organes hématopoïétiques en comparaison avec les hémocytes circulants . Il a été montré que le gène codant la ProPO n' est pas transcrit dans ces organes mais le devient lorsque les hémocytes sont libérés dans l' hémolymphe . Par contre , d' autres protéines comme les péroxinectines , protéines d' adhésion cellulaire , sont produites par 80 à 90 % des cellules ( Söderhäll et al. , 2003 ) . La présence de cette protéine expliquerait la structuration du cortex et les liaisons étroites des cellules hémocytaires dans cette région de l' organe hématopoïétique chez Armadillidium vulgare . Nous savons que le taux d' hémocytes circulants diminue fortement au moment de la mue , lors d' une blessure ou d' une infection par des pathogènes , puis retrouve un taux normal par libération de nouveaux hémocytes à partir des organes hématopoïétiques . Des analyses biochimiques des organes hématopoïétiques ou des expériences de fractionnement par tri cellulaire , suite à une blessure ou à une infection microbienne , permettrait de mieux comprendre les mécanismes de prolifération / apoptose , mais aussi les phénomènes de maturation des hémocytes au sein de ces tissus . En effet , la transcription des gènes homologues de Runt , qui codent pour des facteurs de différenciation chez la drosophile et les mammifères , a été mise en évidence dans les organes hématopoïétiques de Pacifastacus leniusculus ( Söderhäll et al. , 2003 ) . L' injection de LPS ou de laminarine , mimant une infection bactérienne , conduit à l' augmentation de la transcription de ces gènes Runt , ce qui permet une différenciation des cellules hémocytaires afin de produire de nouvelles cellules qui seront libérées dans l' hémolymphe . Chez l' écrevisse , deux protéines Runt ont été mises en évidence ; il semble , par ailleurs , que chacune soit spécifique d' un type cellulaire ( une des cellules granulaires , l' autre des cellules semi-granulaires ) . Ces gènes constitueraient donc de bons marqueurs des différentes populations de cellules ( Söderhäll et al. , 2003 ) . L' identification de telles protéines chez Armadillidium vulgare pourrait s' avérer très utile dans la détermination du lignage et de la maturation de ses différentes populations d' hémocytes . VII . EVOLUTION DU TAUX D' HEMOCYTES CIRCULANTS APRES INDUCTION DU SYSTEME IMMUNITAIRE Dans cette étude préliminaire , nous avons voulu essayer de déterminer l' évolution de la population hémocytaire au cours d' une infestation bactérienne expérimentale . Cette induction a été réalisée par des deux types d' infections ( 1 ) injections de bactéries pathogènes en phase de croissance ( Bacillus megaterium , Escherichia coli ; chauffés ou non à 100 °C ) chez des animaux sains et des animaux hébergeant Wolbachia . Le chauffage des bactéries permet de conserver les déterminants antigéniques tout en supprimant la virulence de la bactérie ( 2 ) injections de Wolbachia ( contenues dans des extraits tissulaires ) chez des animaux sains uniquement . Des lots de 4 animaux ont reçu une injection soit de B.megaterium chauffés ou non à 100 °C , soit d' Escherichia coli chauffés ou non à 100 °C , soit de Wolbachia ou soit d' une solution de Ringer ( témoin de l' expérience ) . Les hémocytes , prélevés après différents temps , ont été colorés au bleu Trypan pour une numération à l' aide d' une cellule de Mallassez . Le nombre d' individus testés n' étant pas suffisamment important , nous n' avons pas pu effectuer de tests statistiques , aussi il conviendra de compléter ces comptages sur une plus grande échelle pour obtenir une étude significative au niveau statistique . Toutefois , les premiers résultats obtenus au cours de nos expériences préliminaires se sont avérés reproductibles et nous ont fournis un certain nombre d' informations sur l' évolution de la population hémocytaire suite à une infection bactérienne provoquée . Ainsi , les cinétiques obtenues pour les animaux infectés par B. megaterium ( chauffés ou non ) et pour E. coli ( chauffés ) sont similaires ( Figure 21 , A / B / C ) . Les résultats obtenus après injections de Ringer ou après injections d' extraits tissulaires contenant Wolbachia semblent identiques ( Figure 21 , D / E ) . Seule l' injection d' E. coli non chauffés semble induire une réponse hémocytaire différente ( Figure 21 , F ) . Le graphe obtenu pour la réponse de nos témoins montre qu' une heure après l' injection de Ringer , une chute des hémocytes est observée , puis le taux hémocytaire remonte pour atteindre son niveau basal ( 20 000 cellules / & 206;& 144;l ) 6h après l' injection . Cette chute du taux hémocytaire est imputable en partie aux pertes liquidiennes provoquées lors du percement du trou nécessaire à l' injection . De plus , les hémocytes sont mobilisés sur le site de la blessure pour la colmater et assurer la cicatrisation . Cette chute des hémocytes devrait se retrouver dans tous les types d' infection par inoculation . Le taux d' hémocytes remonte progressivement 3h après l' injection , ce qui peut être corrélé à une libération , par les organes hématopoïétiques , de nouveaux hémocytes circulants . En ce qui concerne les animaux infectés par B. megaterium ( chauffés ou non ) et par E. coli ( chauffés ) , une chute rapide des hémocytes est observée dans la première heure suivant l' infection . Puis le nombre d' hémocytes augmente lentement entre la 3 éme et la 6 éme heure post-injection , pour atteindre un niveau plus faible que celui observé dans les témoins avant de diminuer une seconde fois entre la 6 éme et la 9 éme heure . Enfin , après 9h d' infection , le taux d' hémocytes augmente alors rapidement dans l' hémolymphe pour retrouver son taux basal entre 18 à 24 heures après l' inoculation . Comme pour les témoins « Ringer » , la première chute du nombre d' hémocytes suivie d' une lente remontée sont attribuables à la rupture du tégument . La deuxième diminution du taux hémocytaire , 6h après l' injection , pourrait correspondre à une lyse des hémocytes ayant participé activement , depuis l' infection , aux différents aspects de la réponse immunitaire ( dégranulation , phagocytose ... ) . L' infestation bactérienne étant d' emblée massive , la disparition des hémocytes ne serait plus comblée par les organes hématopoïétiques . Enfin , une seconde libération d' hémocytes par les organes hématopoïétiques aurait lieu environ 9h après l' injection et se poursuivrait jusqu'au rétablissement du taux basal . La quantité d' hémocytes circulant est probablement régulée par un contrôle de leur libération ; en cas de traumatismes importants , la forte diminution des hémocytes circulants ne peut être instantanément compensée . De nos observations , il semble ressortir que la première priorité est de rétablir l' intégrité et l' étanchéité du tégument , à partir de ce moment , la jugulation de l' infection concomitante nécessitera plusieurs heures et la libération de nouveaux hémocytes . En ce qui concerne les infections par E. coli ( non chauffés ) , les résultats sont plus difficilement interprétables . En effet , l' injection de cette bactérie Gram ( - ) conduit , après 3h , à 80 % de mortalité chez les animaux infectés et ce , même si des quantités moins importantes de bactéries ( dilution de 10 à 50 fois ) sont inoculées . Le suivi du nombre d' hémocytes en fonction du temps d' incubation des E. coli a montré que suite à la première chute du nombre d' hémocytes consécutive à la blessure , il ne semble pas y avoir de restauration du nombre d' hémocytes dans l' hémolymphe . Les quelques animaux qui survivent 24h après l' injection présentent un taux hémocytaire très bas ( 5000 cellules / & 206;& 144;l ) par rapport au niveau basal . De tels résultats nous portent à penser que chez Armadillidium vulgare , les hémocytes sont particulièrement sensibles à la présence d' E.coli infectieux . L' injection d' E.coli tués par la chaleur n' est pas létale mais induit une diminution marquée des hémocytes sur plus de 24h. Il semble donc que des facteurs de virulence sont capables de détruire les hémocytes et probablement de bloquer le fonctionnement des organes hématopoïétiques . Une question se pose : nos animaux ont -ils acquis un système leur permettant de détecter les bactéries Gram ( - ) ? Il conviendra d' identifier ce système qui est en place chez les décapodes où des protéines sont capables de reconnaître la signature LPS ( Lee et al. , 2000 ) Enfin , l' injection d' une suspension de tissus broyés contenant des Wolbachia montre que l' animal ne réagit pas du tout et la réponse obtenue est similaire à celle du témoin Ringer . Cette expérience devra être reproduite en considérant des temps plus longs car les bactéries injectées sont incluses dans des débris cellulaires ( Wolbachia n' est pas cultivable ) qui pourraient leurrer les hémocytes jusqu'à la phase d' infestation active des cellules du nouvel hôte . Toutefois , le fait que cette bactérie ne soit pas reconnue par les hémocytes n' est pas à exclure du fait de son incapacité à synthétiser des LPS ( Wu et al. , 2004 ) . Cette étude préliminaire a été effectuée dans le but d' estimer le temps nécessaire à l' organisme pour monter une réponse immunitaire efficace ; ces données sont donc importantes pour la recherche de protéines du système immunitaire dans le plasma , mais également pour quantifier l' expression de ces protéines . Ces indications devraient nous permettre de définir le moment où nous devons effectuer les prélèvements d' hémolymphe , en vue d' études protéiques ou génomiques . Ces données nous apportent également des informations sur la libération des jeunes hémocytes par les organes hématopoïétiques suite à une blessure provoquée . Ces résultats nécessiteront cependant d' être confirmés et complétés par une étude des organes hématopoïétiques , afin de déterminer ( i ) la quantité de cellules que ce tissu peut libérer en conditions normales et chroniques ( ii ) les taux de prolifération et d' apoptose . Il serait également intéressant de rechercher les mécanismes impliqués dans la communication cellulaire qui régulent la libération des jeunes hémocytes . Enfin , est -ce qu' il existe une reconnaissance des bactéries dans les organes hématopoïétiques ? Il a été montré chez la crevette Sicyonia ingentis que les organes hématopoïétiques intervenaient dans la « clearance » des bactéries d' une manière très efficace ( Martin et al. , 1996 ) . Cette étude a confirmé , par la même occasion , que les cellules granulaires contenues dans ces organes hématopoïétiques étaient maturées avant leur libération puisqu' elles étaient capables d' éliminer des bactéries dans l' organe qui les produit mais dont la structure est particulière . VIII . CONCLUSION-PERSPECTIVES Cette étude histologique ( organes hématopoïétiques ) et cytologique ( hémocytes ) , chez Armadillidium vulgare nous a permis de caractériser trois types d' hémocytes dans l' hémolymphe : ( i ) les hémocytes hyalins , dépourvus de granules ; ( ii ) les hémocytes semi-granulaires , pourvus de petits granules ; ( iii ) les hémocytes granulaires , pourvus de gros granules et présents en grand nombre . Ces trois populations d' hémocytes matures sont retrouvées dans le cortex lacunaire des organes hématopoïétiques . Il semblerait donc que les hémocytes soient déjà maturés lors de leur libération par les organes hématopoïétiques . En effet , lors de l' observation des organes hématopoïétiques , il semble que les hémocytes soient produits à partir de cellules souches situées dans la région centrale des organes et subissent leur maturation au cours de leur migration vers les régions lacunaires périphériques . A partir de ces observations , il n' est pas possible d' établir le lignage des cellules . Chez l' écrevisse signal , deux marqueurs spécifiques des hémocytes semigranulaires et des hémocytes granulaires ont été déterminés et devraient être utilisés pour une étude de lignage ( Söderhäll et al. , 2003 ) . L' obtention de tels marqueurs nous permettrait de déterminer l' origine des différents types d' hémocytes circulants . Les expériences de phagocytose et d' encapsulation ont permis de mettre en évidence en partie la fonction des différents hémocytes . Ainsi , les cellules hyalines semblent impliquées dans la phagocytose , toutefois des expériences complémentaires pourront être réalisées notamment par une injection de bactéries marquées à la GFP pour une observation en microscopie confocale . Les cellules semi- granulaires semblent également intervenir dans ce processus mais avec une efficacité moindre . Les expériences d' encapsulement ont montré que les cellules granulaires et semi-granulaires possédaient la capacité à adhérer et à former des couches superposées afin d' emprisonner le corps étranger dans une capsule . La présence de mélanine dans les capsules suggèrent une libération des enzymes du système prophénoloxydase par les cellules granulaires . Nous avons également constaté que chez les animaux infectés , les cellules présentaient moins de digitations et par conséquent devenaient moins adhérantes . Toutefois , aux temps que nous avons choisis pour prélever les capsules , ces dernières étaient déjà complètement formées chez les deux types d' animaux . Cette expérience devra donc être renouvelée mais en choisissant des temps plus courts d' incubation des bâtonnets de résine , afin de déterminer si la formation des capsules chez les animaux infectés présente un décalage dans le temps . Les observations réalisées chez Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia montrent que les animaux présentent les mêmes types d' hémocytes , mais que certains ( principalement les hémocytes granulaires ) hébergent , dans leur cytoplasme , Wolbachia enfermées dans une vacuole . Toutefois la charge bactérienne semble relativement faible car tous les hémocytes ne présentent pas de bactéries et dans les hémocytes infectés , les bactéries sont souvent peu nombreuses . Chez ces animaux , une fragilité des hémocytes et des organes hématopoïétiques aux agents fixateurs ( modification des paramètres de fixation en microscopie électronique ) mais également un manque de plasticité membranaire des hémocytes ont été observés . Ainsi l' une des hypothèses plausibles est que Wolbachia interagirait avec le cytosquelette en le déstabilisant . Une observation en microscopie confocale des hémocytes d' Armadillidium vulgare porteurs et non porteurs de la bactérie , après marquage de l' actine et des microtubules nous permettrait de valider cette hypothèse , pour ensuite engager des études moléculaires . Nous avons également constaté , dans une étude préliminaire , que lors d' infections expérimentales par des bactéries exogènes , le nombre d' hémocytes variait au cours du temps et ceci d' une manière similaire , que les animaux soient sains ou porteurs de Wolbachia . Lors d' infection par des bactéries à Gram ( + ) , les différentes chutes observées du nombre d' hémocytes correspondraient à leur utilisation , dans un premier temps , pour cicatriser la blessure et dans un second temps pour lutter contre l' infection proprement dite . Les augmentations du nombre d' hémocytes correspondraient à la libération de nouveaux hémocytes par les organes hématopoïétiques . Toutefois lors d' infections par des bactéries Gram ( - ) , seule la première augmentation du nombre d' hémocytes est observable mais elle est très faible et bon nombre d' animaux meurent . Cette expérience préliminaire nécessite d' être confirmée sur des échantillons plus grands et avec des doses plus physiologiques , afin de faire une étude statistique . Enfin , il serait également intéressant d' observer le comportement des hémocytes au niveau du site de la blessure à la fois en MET et en MEB mais aussi en immunohistochimie , en utilisant un anticorps anti-armadillidine comme marqueur par exemple ( cf Chapitre II ) . Chapitre II Isolement et caractérisation de l' armadillidine , peptide antibactérien issu des hémocytes d' Armadillidium vulgare . Présence de ce peptide dans la famille des Armadillididae . Herbiniere J , Braquart-Varnier C , Greve P , Strub JM , Frere J , Van Dorsselaer A and Martin G . Armadillidin : a novel glycine - rich antibacterial peptide directed against gram - positive bacteria in the woodlouse Armadillidium vulgare ( Terrestrial Isopod , Crustacean ) . Dev Comp Immunol . 2005 ; 29 ( 6 ) : 489 - 99 . Epub 2004 Dec 21 . Tableau 5 : Activités antibactériennes détectées dans le plasma et dans les extraits des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia ( + / - Wolbachia ) ISOLEMENT ET CARACTÉRISATION DE L' ARMADILLIDINE I. DETECTION D' UNE ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DANS L' HEMOLYMPHE d' Armadillidium vulgare Chez les crustacés , les peptides antibactériens sont synthétisés constitutivement dans les hémocytes et stockés dans les granules hémocytaires . Après une infection bactérienne , le contenu des granules est libéré dans l' hémolymphe , donc dans la circulation générale et souvent précisément au niveau du site d' infection / de blessure . Dans un premier temps , nous avons donc essayé de détecter une activité antibactérienne dans les composants de l' hémolymphe , c' est à dire le plasma et les hémocytes . Pour cela , les protéines plasmatiques ont été acidifiées au TFA afin d' éliminer en partie l' hémocyanine et de concentrer les protéines de plus faibles masses moléculaires . Les protéines hémocytaires ont ensuite été extraites par sonication dans de l' acide acétique 0 , 2 N , puis précipitées à l' acétone . Ces extraits protéiques ( plasmatiques et hémocytaires ) ont été testés sur la croissance de 6 souches de bactéries Gram ( + ) [ Bacillus megaterium , Enterococcus faecalis , Listeria ivanovii , Micrococcus luteus , Staphilococcus aureus , Vibrio alginplyticus ] et 8 souches de bactéries Gram ( - ) [ Acinetobacter baumanii baumanii , Citrobacter freundii , Enterobacter cloacae , Enterobacter aerogines , Escherichia coli , Escherichia coli ( souche pathogène ) , Pseudomonas aeruginosa , Salmonella thyphimurium ] ( Tableau 5 ) . Quels que soient les animaux , infectés ou non par Wolbachia , aucune activité antibactérienne n' a été trouvée dans le plasma . Par contre , la fraction hémocytaire extraite par de l' acide acétique 0 , 2 N présente une activité qui est dirigée contre 2 souches de bactéries Gram ( + ) , B . megaterium et E. faecalis . Dans un second temps , nous avons donc entrepris la caractérisation de cette activité antibactérienne dans les hémocytes , notamment en recherchant la ou les molécules responsables de l' activité antibactérienne . Figure 22 : A : RP-HPLC des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare extraites en conditions acides . Les fractions fléchées 1 , 2 et 3 présentent une activité antibactérienne dirigée contre B. megaterium . B : Spectre MALDI-TOF de la fraction 2 , issue de la chromatographie ci-dessus . Ce spectre est caractérisé par un pic à 5259 Da en parfait accord avec la masse calculée du peptide . II . ISOLEMENT D' UN PEPTIDE ANTIBACTERIEN A PARTIR DES HEMOCYTES D' ARMADILLIDIUM VULGARE II.1 . Purification de l' armadillidine L' extrait acétique hémocytaire a été soumis à une partition en phase solide sur une cartouche Sep-Pak . La fraction , éluée par 40 % d' ACN / TFA 0 , 1 % a été séchée sous vide puis resolubilisée . Une fraction aliquot a ensuite été utilisée pour déterminer l' activité antibactérienne contre B. megaterium et E. faecalis . Pour cela , la fraction principale a été soumise à une purification par chromatographie RP-HPLC ( Figure 22 , A ) . Toutes les fractions , collectées manuellement , ont , après conditionnement pour éliminer l' ACN , été testées contre B. megaterium qui est la souche bactérienne la plus sensible à l' effet détecté . L' activité antibactérienne ainsi observée a pu être rapportée à 3 fractions issues d' un pic complexe éluant entre 31 % et 33 % d' ACN . Toutefois , l' activité antibactérienne était plus importante dans la fraction 2 ( médiane ) que dans les deux autres fractions ( latérales ) . II.2 . Détermination de la structure primaire de l' armadillidine Ces 3 fractions chromatographiées et actives ( Figure 22 , A ) ont ensuite été analysées en spectrométrie de masse de type MALDI-TOF pour une mesure de masse et pour une détermination de la pureté des fractions . Les 3 spectres obtenus ont montré que : - La fraction correspondant au pic 2 est homogène et contient un seul peptide d' une masse moléculaire de 5259 , 7 Da MH + ( Figure 22 , B ) . Ce peptide est donc responsable de l' activité antibactérienne observée . - Les fractions correspondant aux pics 1 et 3 sont hétérogènes et contiennent différents peptides . Pour ces deux fractions , une masse de 5259 Da a été retrouvée parmi les masses obtenues , révélant la présence du même peptide que dans la fraction 2 . La présence de ce peptide dans les fractions 1 et 3 explique donc l' activité antibactérienne observée . Le peptide actif issu du pic 2 étant suffisamment pur , il a été séquencé par dégradation d' EDMAN automatisée . La séquence obtenue est composée de 53 acides aminés et est présentée dans la Figure 23 ci-dessous . Figure 23 : Séquence complète , obtenue par dégradation d' Edman , du peptide antibactérien purifié par RP-HPLC . La masse calculée à partir de cette séquence est de 5259 , 65 Da , elle est donc en accord avec la masse moléculaire déterminée par MALDI-TOF-MS ( 5259 , 7 Da ) . Cette masse moléculaire a été confirmée par une analyse en Nanoelectrospray donnant une masse de 5258 , 7 Da , soit une masse avec un Dalton de différence . Cette différence pouvait correspondre à une amidation du peptide à son extrémité C-terminale , seule modification post-traductionnelle observée . Les interrogations de banques de données ( NCBI / EMBL / SWISSPROT ) n' ont pas permis d' établir d' homologies avec des peptides antibactériens connus , ce nouveau peptide a donc été nommé armadillidine , à partir du nom de genre d' Armadillidium vulgare . Dans le but de connaître la structure de la molécule peptidique obtenue , nous avons interrogé le site www.expasy.org le Network Protein Sequence analysis ( Biopôle de Lyon ) . Quelle que soit la méthode de calcul utilisée , basée sur les propriétés physico-chimiques des acides aminés constituant l' armadillidine , la structure de ce peptide apparaît aléatoire sans formation secondaire particulière , et ne comporterait ni hélice & 206;& 133; , ni feuillets & 206;& 134;. L' armadillidine est un peptide linéaire cationique avec une composition en acides aminés particulière car il n' est composé que de 10 acides aminés différents : Tableau 6 . Comparaison de la composition en acides aminés et de l' activité de l' armadillidine avec des peptides antimicrobiens riches en résidus glycine , issus : d' araignées : acanthoscurrines 1 et 2 ( Lorenzini et al. , 2003 ) ; d' insectes : AFP ( Iijima et al. , 1993 ) , holotricine 3 ( Lee et al. , 1995 ) et tenecine 3 ( Jung et al. , 1996 ) , ( Lee . et al. , 1999 ) et de plantes : shepherines 1 et 2 ( Park et al. , 2000 ) . Ce peptide , particulièrement riche en résidus glycine ( 47 % mol / mol ) , présente 5 motifs répétés GGGFH ( R / S ) et ne contient pas de résidu cystéine . Mis à part la présence d' un fort taux de résidus glycine , l' armadillidine montre un certain nombre de différences avec les autres peptides antimicrobiens riches en glycine caractérisés chez d' autres animaux ou chez des plantes . La comparaison de l' armadillidine avec certains de ces peptides est présentée dans le Tableau 6 . La première grande différence réside dans l' activité antibactérienne de ce peptide . En effet , l' armadillidine présente une activité antibactérienne atypique dirigée contre les bactéries Gram ( + ) et principalement contre B. megaterium ( MIC 0 , 5 - 1 , 25 & 206;& 144;M ) alors que jusqu'à présent la majorité des peptides antimicrobiens riches en glycine connus possèdent une activité antimicrobienne dirigée contre des bactéries Gram ( - ) et/ou contre des champignons ( Tableau 6 ) . Un seul autre peptide antibactérien riche en glycine ( 11 , 1 % ) , isolé chez la larve de l' insecte Oryctes rhinoceros , offre une activité antibactérienne dirigée principalement contre des bactéries Gram ( + ) ( Yang et al. , 1998 ) . Cependant , le taux de glycine est beaucoup plus faible que chez les autres peptides antimicrobiens riches en glycine . De plus , il est également riche en proline et ne présente pas de motifs répétés . La deuxième différence se trouve au niveau de sa composition : - Présence de 12 acides aminés basiques ( 6 arginines et 6 histidines ) . - Absence de résidus chargés négativement , ce qui confère à l' armadillidine une charge nette de + 6 et une valeur de point isoélectrique ( pI ) de 12 , 2 , c& 200;& 135;est-à-dire le pI le plus élevé par rapport aux autres molécules répertoriées . - Pourcentage de résidus hydrophobes dans la séquence de l' armadillidine significativement plus élevé que dans celle des autres peptides . & 239;& 130;& 149;& 239;& 128;& 160;Un autre point remarquable de l' armadillidine est la quintuple répétition du motif GGGFH ( R / S ) . Ces motifs répétés sont couramment retrouvés dans les peptides antimicrobiens riches en glycine . De telles séquences ont été décrites chez Sarcophaga peregrina ( Iijima et al. , 1993 ) , Holotrichia diomphalia ( Lee et al. , 1995 ) , Tenebrio molitor ( Jung et al. , 1996 ) , Acanthoscurria gomesiana gomesiana ( Lorenzini et al. , 2003 ) ou encore Bursa pastoris ( Park et al. , 2000 ) . Chezla plante Bursa pastoris , deux peptides antimicrobiens riches en glycine , de la même famille ( la famille des shepherines ) , ont été isolés ( Park et al. , 2000 ) . Ces peptides présentent une séquence comportant soit 6 , soit 7 répétitions du motif GGH et , il a été montré que la répétition de ce motif était responsable de l' activité antibactérienne . En effet , un peptide de synthèse formé uniquement de 6 répétitions du motif GGH a été produit et son activité testée . Ce peptide de synthèse est responsable d' une activité antibactérienne équivalente à celle obtenue par le peptide natif . Ainsi , la répétition de la séquence GGH a indubitablement une influence majeure sur la structure secondaire de ces peptides et sur leur mode d' action ( Park et al. , 2000 ) . En se basant sur les résultats de Park et al. ( 2000 ) , il est probable que la répétition du motif GGGFH ( R / S ) présent dans l' armadillidine joue un rôle dans l' activité de ce peptide . La réalisation de peptides de synthèse comportant un nombre croissant de motifs ( 2 à 5 ) devrait nous permettre de tester l' importance du nombre de répétitions dans l' activité antibactérienne de l' armadillidine . De même , nous pourrons tester l' importance du résidu phénylalanine dans ces motifs répétés . En effet , nous avons retenu une hypothèse , basée sur les propriétés des acides aminés impliqués dans le motif GGGFH ( R / S ) , qui pourrait expliquer le mode d' action de l' armadillidine ( qui ne semble pas posséder de structure secondaire , comme tous les peptides antimicrobiens riches en glycine ) . Cette hypothèse est renforcée notamment par le fait que la phénylalanine est un composé aromatique très hydrophobe , qui présente une structure encombrante dans la structure secondaire des protéines . Ainsi , les groupements aromatiques des phénylalanines , séparés par 3 glycines , pourraient se situer sur un côté de la molécule pour former une zone fortement hydrophobe . De même , les acides aminés arginine et histidine , chargés positivement se regrouperaient pour former une partie plus hydrophile , à l' opposé des groupements aromatiques . De plus , en conditions physiologiques , le peptide est fortement chargé positivement . Ces propriétés structurales permettraient de le rapprocher des peptides antibactériens présentant une hélice & 206;& 133; , sans qu' il n' y ait de torsion de la molécule . La partie de ce peptide chargée positivement pourrait alors se lier à la membrane des bactéries chargée négativement , puis le peptide s' inclurait dans le bicouche membranaire à l' aide notamment de sa partie hydrophobe . L' association de plusieurs molécules de peptide antibactérien permettrait alors la déstabilisation des membranes selon les deux modèles proposés par ( Shai , 1999 ) et ( Bulet et al. , 2002 ) ( Figure 24 ) : Figure 24 : Schéma des mécanismes de type « carpet » et de type « barrel-stave » suggérés lors de la perméabilisation membranaire des bactéries par des peptides antibactériens présentant une hélice & 206;& 133; ( Shai , 1999 ) . - Le mécanisme « carpet » , les peptides forment un tapis qui recouvre la membrane bactérienne - le mécanisme « barrel-stave » , les peptides s' intègrent dans la membrane bactérienne et se regroupent pour former un cylindre composite qui constitue alors un pore . Ces deux mécanismes conduisent à la lyse des cellules bactériennes , respectivement par fragmentation de la membrane ou par un efflux d' ions passant par les pores non sélectifs ainsi générés . Pour toutes les raisons évoquées précédemment , il apparaît donc important de déterminer la structure secondaire de l' armadillidine afin de lui attribuer un mode d' action , d' autant plus que la présence de résidus glycine en motifs répétés selon Lee et collaborateurs ( 1995 ) serait en faveur d' une activité antifongique . Des premiers essais pour mettre en évidence une activité antifongique ( champignons filamenteux et levures ) dans les extraits protéiques totaux d' hémocytes ( sains et infectés ) , se sont révélés positifs contre deux souches : Botrytis cinerea et Aspergillus niger ( Tableau 7 ) . Des tests utilisant de l' armadillidine purifiée ont montré que l' armadillidine pourrait avoir un effet sur la souche Aspergillus niger . Dans cette même série de tests , l' armadillidine purifiée n' a pas montré d' activité appréciable sur la croissance de Botrytis cinerea , aussi l' existence d' un autre peptide antifongique dans les hémocytes ne peut être formellement exclue . Pour confirmer , ou infirmer ces premiers résultats , ces tests doivent être poursuivis en utilisant des concentrations croissantes de peptide . Par la suite , ils pourront être étendus à d' autres souches de champignons . Toutefois , la disponibilité de quantités notables de peptides actifs demeure un préalable indispensable . Il apparaît donc nécessaire d' obtenir une quantité importante d' armadillidine , ce qui n' est pas aisément réalisable si l' on considère le faible volume d' hémolymphe prélevable par animal . malgré la collaboration des auteurs précités , nous ne sommes pas parvenus à produire ce peptide . Un nouvel essai de production est actuellement envisagé , en collaboration avec le Pr . T. Berges , dans le système d' expression « pMal& 226;& 132;& 162; Protein fusion » commercialisé par NEB . Tableau 7 : Activités antifongiques détectées dans les extraits des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia . ( + ) II.3 . Clonage de l' ADNc de l' armadillidine A partir de la séquence peptidique , 2 oligonucléotides dégénérés ont été déterminés ( ArmF et ArmR , Figure 25 ) et utilisés en RT-PCR sur les ARNs hémocytaires d' Armadillidium vulgare , infectés ou non par Wolbachia . Un fragment d' une taille attendue de 154 pb a été obtenu , cloné et séquencé . La séquence déduite en acides aminés confirme la séquence peptidique obtenue précédemment par dégradation d' Edman . En utilisant la technologie SMART , l' ADNc pleine taille de l' armadillidine a été cloné dans le vecteur pGEM-T-easy . Au moins 3 clones positifs contenant un insert de 656 pb ont été séquencés dans les 2 directions . L' ADNc pleine taille est composé d' une région non transcrite en 5 ' de 79 pb suivie par le cadre de lecture de 219 pb et d' une région non transcrite en 3 ' de 342 pb . Le cadre de lecture code une séquence de 73 acides aminés incluant un peptide signal ( 19 residus ) riche en acides aminés hydrophobes . Le site de clivage pour la peptidase est situé après le résidu alanine ( position 19 ) précédent le premier résidu glycine du peptide ( Figure 25 ) . La séquence peptidique codante , déduite de la séquence d' ADNc , montre que le peptide avant modification post-traductionnelle présente 54 acides aminés et une masse calculée de 5317 , 7 Da , contre une masse de 5259 , 7 Da mesurée par MALDI-TOF sur le peptide mature . Cette différence de masse de 58 Da confirme que l' armadillidine doit être amidée à son extrémité C-terminale ( Arg-NH2 ) par élimination du résidu glycine . Cette amidation constitue la seule modification post-traductionnelle . ( Miyata et al. , 1989 ) ou les cécropines d' insectes ( Lowenberger et al. , 1999 ) . Cette modification a également été décrite dans les peptides antibactériens de vertébrés , tels que les magainines ( Chen et al. , 1988 ) pour lesquels il a été montré que l' amidation était fonctionnellement importante . En effet , la comparaison d' activité antimicrobienne entre les mêmes peptides présentant soit un groupe carboxyl libre , soit un groupe carboxyl amidé , a montré que cette modification post-traductionnelle augmentait l' activité des peptides . La perte partielle de l' activité antimicrobienne des peptides non amidés est probablement due Figure 25 . Séquence de l' ADNc de l' armadillidine et séquence en acides aminés déduite ( numéro d' accession AY644458 ) . Le peptide mature est indiqué en caractères gras . L' acide aminé en italique correspond au résidu glycine impliqué dans l' amidation du résidu arginine C-terminal et l' astérisque indique le codon stop . Le signal de polyadénylation est surligné deux fois . La double flèche verticale montre le site de clivage du peptide signal par une peptidase . Les flèches indiquent la position des amorces utilisées dans les réactions de RT-PCR . à la perte d' une charge positive à leur extrémité C-terminale entraînant des interactions plus faibles entre ces peptides et la membrane des bactéries . La présence d' un peptide signal suggère que l' armadillidine , une fois traduite dans les hémocytes , est transportée vers les granules hémocytaires dans lesquels elle serait stockée . Le stockage des peptides antibactériens dans les granules des hémocytes est un processus largement décrit chez les invertébrés étudiés tels que les moules ( Mitta et al. , 1999 ) , les limules ( Iwanaga et al. , 1998 ) , les araignées ( Lorenzini et al. , 2003 ) et les crustacés ( Silva et al. , 2000 ) . Ce phénomène a également été décrit chez les vertébrés , dans les phagocytes et les neutrophiles de mammifères ( Ganz et Lehrer , 1997 ; Yount et al. , 1999 ) mais aussi dans les cellules intestinales de Paneth ( Ouellette et Selsted , 1996 ) . La localisation de l' armadillidine dans les granules des hémocytes pourra être validée par immunomarquage , soit par hybridation avec un anticorps couplé à un fluorochrome pour une analyse en microscopie confocale , soit par une hybridation avec un anticorps primaire couplé à un deuxième anticorps lié à des particules d' or , pour une observation en microscopie électronique . 1 - Hémocytes ( - Wolbachia ) 2 - Hémocytes ( + Wolbachia ) 3 - Coeur 4 - Cerveau 5 - Chaîne nerveuse 6 - Ovaire 7 - Tissu adipeux 8 - Tube digestif Figure 26 : Analyse de l' expression de l' armadillidine par northern blot : Hybridation sur différents tissus d' Armadillidium vulgare des sondes ( A ) armadillidine et ( B ) actine . II. 4 . Spécificité de l' expression de l' armadillidine 4.1 . Spécificité tissulaire de l' armadillidine L' expression des ARNm de l' armadillidine dans différents tissus d& 200;& 135;Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia a été déterminée par northern blot , ce qui a permis de révéler un transcript d' environs 0 , 65 kb présent spécifiquement dans les hémocytes des deux types d' animaux ( Figure 26 ) . Chez Armadillidium vulgare , l' armadillidine n' est présente que sous une seule forme puisque nous ne détectons qu' un seul transcript . La très faible expression observée dans les ovaires ( Figure 26 ) peut être mise en relation avec la présence d' hémocytes infiltrant les tissus comme cela a été montré chez les moules ( Mitta et al. , 2000a , b ) , les crevettes ( Destoumieux et al. , 1999 ) et les araignées ( Lorenzini et al. , 2003 ) . En effet , les isopodes terrestres comme les décapodes possèdent un appareil circulatoire non clos et les hémocytes peuvent s' insinuer dans tous les tissus , ce qui explique cette contamination . Le même type de contamination a également été observé , pour tous les tissus testés , au cours de l' étude de l' expression de l' armadillidine effectuée par RT-PCR ( résultats non présentés ) . Des tests d' expression de l' armadillidine par RT- PCR ont également été réalisés sur les ARNs des organes hématopoïétiques . Un amplifiat de taille attendue est obtenu dans ce tissu producteur des cellules de l' hémolymphe , il n' est pas improbable que les hémocytes en cours de maturation et/ou les hémocytes matures avant leur libération expriment ce peptide antibactérien . Afin de valider ce dernier résultat relatif à l' expression précoce de l' armadillidine au sein des organes hématopoïétiques , deux types d' expériences complémentaires devront être mises en oeuvre : - l' analyse des ARNs par northern blot ( expression ) - l' immunomarquage par un anticorps polyclonal dirigé contre l' armadillidine ( synthèse et stockage ) . 4.2 . Spécificité du zoologique de l' armadillidine Depuis la caractérisation de trois membres d' une nouvelle famille de peptides antimicrobiens chez la crevette Peneaus vannamei ( Destoumieux et al. , 1997 ) , de nombreuses études ont été réalisées pour retrouver cette famille ( les pénaeidines ) chez d' autres crevettes d' intérêt économique . Ces peptides cationiques présentent une grande diversité au niveau de leur séquence primaire mais ils sont typiquement formés de deux domaines , l' un N-terminal riche en résidus proline et , l' autre côté C- terminal riche en résidus cystéine dont 6 sont engagés dans 3 ponts disulfures . Leur activité est dirigée contre les bactéries Gram ( + ) et les champignons . Actuellement , les pénaéidines ont été décrites chez 6 espèces de crevettes : Litopenaeus setiferus ( Gross et al. , 2001 ) , Penaeus japonicus ( Rojtinnakorn et al. , 2002 ) , Peneaus monodon ( Supungul et al. , 2002 ) , Litopenaeus stylirostris ( Munoz et al. , 2004 ) , Fenneropenaeus chinensis ( Kang et al. , 2004 ) et Litopenaeus setiferus ( Cuthbertson et al. , 2004 ) . Récemment l' isolement , chez Fenneropenaeus chinensis d' une 4ème isoforme de la classe 3 et d' une 4ème classe de pénaeidines chez Litopenaeus setiferus a ainsi confirmé la diversité de cette famille de peptides antimicrobiens spécifiques des crustacés décapodes du genre Penaeus . Les différentes classes sont distinguées par leurs régions variables , qui pour chaque classe présente des caractéristiques particulières . De plus , chacune de ces classes est composée de différentes isoformes , qui correspondent à des substitutions ponctuelles au niveau de la séquence peptidique . Le peptide de la classe 4 présente une très grande spécificité vis à vis de ses cibles , il n' est actif que sur des bactéries de même espèce . Les pénaeidines qui représentent un grand nombre de gènes exprimés au sein des hémocytes ne cibleraient pas ( suivant leur classe ) les mêmes espèces microbiennes ( Cuthbertson et al. , 2004 ) . A l' instar de ces travaux , nous avons voulu savoir si l' armadillidine était synthétisée chez tous les isopodes terrestres ou seulement au sein de la famille des Armadillididae ( Tableau 1 p 37 ) . L' expression de l' armadillidine a donc été recherchée chez des isopodes terrestres ( i ) de genres différents appartenant à des familles différentes ( ii ) d' espèces différentes appartenant au même genre ( famille des Armadillididae ) . Figure 27 : Analyse de l' expression de l' armadillidine chez différentes espèces d' isopodes terrestres ( 1 ) Armadillidium vulgare ( A.v. ) non infecté par Wolbachia , ( 2 ) Armadillidium vulgare infecté par Wolbachia , ( 3 ) Armadillo officinalis ( A.o . ) , ( 4 ) Oniscus asellus ( O.a . ) , ( 5 ) Porcellionides pruinosus pruinosus ( P.p. ) . ( A ) RT-PCR sur les ARNs des hémocytes de différents genres d' Isopodes terrestres en utilisant les amorces spécifiques armadillidine ( Arm 5 / Arm 6 ) . ( B ) . Hybridation de la sonde armadillidine sur les ARNs des hémocytes de différentes espèces d' Armadillididae . ( i ) Les ARNs hémocytaires d' isopodes terrestres , n' appartenant pas à la famille des Armadillididae ( Oniscus asellus , Porcellionides pruinosus pruinosus et Armadillo officinalis ) ont été prélevés et l' expression de l' armadillidine a été testée par RT-PCR , en utilisant les deux amorces spécifiques de l' armadillidine ( Arm 5 / Arm 6 ) . Ces analyses en RT-PCR se sont révélées négatives pour l' armadillidine tandis que les RT-PCR sur les mêmes matrices en utilisant des amorces spécifiques de l' actine sont positives ( Figure 27 , A. ) . Même en utilisant des conditions de PCR moins stringentes ( températures d' hybridation de 45 °C à 55 °C ) aucune amplification n' a été obtenue à l' exception du témoin positif ( ARNs d' Armadillidium vulgare ) , suggérant une expression spécifique de l' armadillidine restreinte au genre . Cette spécificité zoologique a été confirmée par des analyses en Northern blot ou seule une hybridation de la sonde sur les hémocytes d' Armadillidium vulgare est observée ( Figure 27 , B. ) . Figure 28 : Analyse de l' expression de l' armadillidine par RT-PCR ( Arm 5 / Arm 6 ) dans les hémocytes de différentes espèces d' Armadillididae . 1 - Armadillidium assimile ( A.a . ) , 2 - Armadillidium depressum ( A.d . ) , 3 - Armadillidium maculatum ( A.m . ) , 4 - Armadillidium nasatum ( A.n . ) , 5 - Armadillidium vulgare ( A.v. ) , 6 - Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia [ A.v. ( + W ) ] . Figure 29 : Alignement multiple ( CLUSTAL W ) des séquences partielles de l' armadillidine obtenues , après RT-PCR ( Arm 3 / Arm 6 ) chez différentes espèces d' Armadillididae : Armadillidium vulgare ( A.v . ) Armadillidium assimile ( A.a . ) , Armadillidium depressum ( A.d . ) , Armadillidium maculatum ( A.m . ) , Armadillidium nasatum ( A.n . ) . ( ii ) Les ARNs hémocytaires d' isopodes terrestres appartenant à la famille des Armadillididae ainsi qu' au genre Armadillidium ( Armadillidium assimile , Armadillidium depressum , Armadillidium maculatum , Armadillidium nasatum ) , ont été prélevés et l' expression de l' armadillidine a été testée par RT-PCR comme précédemment . Les résultats obtenus présentés Figure 28 montrent qu' un fragment de taille attendue ( 210 pb en utilisant les amorces Arm 3 / Arm 6 ) est présent chez toutes les espèces testées . Ces produits de PCR ont ensuite été purifiés et séquencés . L' analyse des séquences en acides aminés déduites ( Figure 29 ) confirme qu' elles correspondent toutes à l' armadillidine , ce qui suggère que ce peptide pourrait être présent chez toutes les espèces d' Armadillididae . Les séquences sont très proches , puisque les 11 premiers acides aminés et la répétition du motif spécifique de l' armadillidine sont entièrement conservés . La composition de ce motif peut toutefois présenter une variation supplémentaire , elle devient alors : GGGF ( H / N ) ( R / S ) . La comparaison des séquences protéiques , en prenant celle d' Armadillidium vulgare comme référence , montre que la séquence obtenue pour Armadillidium assimile est totalement identique . Les trois autres espèces présentent quelques variations , notamment Armadillidium depressum qui présente un motif GGGFNR supplémentaire , un résidu glycine en moins en position 12 , et 6 changements de résidus ( positions : 26 , 27 , 33 , 38 , 50 , 57 ) . La séquence obtenue chez Armadillidium nasatum montre le remplacement de deux motifs FNR par les motifs IYG et FRT . La séquence identifiée chez Armadillidium maculatum est très proche ( une substitution en position 48 ) de celle d' Armadillidium depressum si on excepte le motif répété supplémentaire par rapport à Armadillidium vulgare . Ce peptide semble donc bien conservé au sein de la famille des Armadillididae et notamment en C-terminal ou le résidu glycine est présent chez toutes les espèces ( chez Armadillidium vulgare , ce résidu sert lors de l' amidation du peptide ) . Si une seule forme du peptide semble présente pour chaque espèce , il n' est cependant pas exclus qu' il existe d' autres isoformes au sein d' une même espèce . En effet si le transcrit isolé est le plus représenté , il peut masquer d' autres transcrits . La présence d' un transcrit majoritaire a déjà été montré pour la classe 3 des pénaeidines qui représente 90 % des transcrits de ce peptide antimicrobien ( Cuthbertson et al. , 2002 ) . Ces résultats obtenus pour les différentes espèces d' Armadillididae pourront être confirmés avec l' obtention des ADNc complets de chaque isoforme isolée . De plus , l' isolement de ce peptide devra être réalisé chez ces trois nouvelles espèces afin de tester l' activité antibactérienne de ces trois isoformes , notamment pour déterminer si la présence d' un motif supplémentaire chez Armadillidium depressum et l' altération de deux motifs chez Armadillidium nasatum entrainent une modification de l' activité antibactérienne . Ces études ultérieures devraient nous permettre de classer ces isoformes de l' armadillidine au sein d' une même famille de peptides antibactériens riches en glycine et présentant des motifs répétés GGGF ( H / N ) ( R / S ) . II.5 Libération de l' armadillidine Des observations en MET réalisées sur les hémocytes granulaires montrent qu' après une infection des animaux par B.megaterium ( chauffés ou non ) , les organites de stockage des composants du système immunitaire subissent une modification bien marquée . Dès la première heure suivant l' infestation , la plupart des grands granules des hémocytes granulaires prennent un aspect particulier et il est manifeste que la densité électronique d' une partie du granule est affectée ( Figure 30 , A ) . De plus , nous observons la formation de nombreuses digitations à la surface cellulaire de ces hémocytes . Ces deux modifications de l' aspect cytologique des cellules perdurent pendant plusieurs heures après l' infestation ( Figure 30 , B ) . La diminution de la densité électronique de la matrice granulaire évoque une libération d' un ou plusieurs produits . Il n' a pas été possible de déterminer le mécanisme de libération au travers de la membrane granulaire . Si la diffusion au sein du cytoplasme n' est pas exclue , reste à comprendre le transfert à la membrane plasmique . Selon certains auteurs ( Mitta et al. , 2000 ) , une libération intracellulaire du contenu granulaire semble possible : chez la moule , les granules hémocytaires contenant les peptides antibactériens peuvent fusionner avec les lysosomes , suggérant une coopération dans la destruction des bactéries phagocytées . Un phénomène analogue a également été observé au sein des neutrophiles humains ( Ganz et Lehrer , 1997 ) . Lors d' une infection bactérienne consécutive à une blessure , l' armadillidine est -elle libérée seulement sur le site de contamination et/ou dans la circulation générale ? Après injection de B.megaterium dans la cavité générale de nos animaux et récupération du plasma d' un seul individu sur une échelle de temps allant de 1h à 24h , nous avons , par une analyse en MALDI-TOF , recherché la présence d' un signal à 5259 Da correspondant à la masse de l' armadillidine ( Figure 31 ) . Notre analyse démontre clairement que suite à l' infection bactérienne , l' armadillidine est bien détectable dans le plasma . Il est vraisemblable que le taux de l' armadillidine circulante présente une évolution dans le temps qui pourrait être corrélée au nombre d' hémocytes circulants ( Chapitre I , § VII , p 95 ) . L' observation du témoin Ringer dont l' hémolymphe a été prélevée très rapidement après l' injection montre la présence d' un signal faible mais cependant détectable ; soit l' armadillidine est présente en permanence dans le plasma à un niveau très faible , soit suite à un traumatisme , elle est libérée immédiatement dans la circulation générale mais de façon graduée . Nos observations en MET sur la cytologie des granules ainsi que l' identification de l' armadillidine dans le plasma par la technique MALDI-TOF , apportent des indices sur le lieu de stockage , le mode et la cinétique de libération de ce peptide . Les variations de la charge en armadillidine présente dans le plasma suite à une infection microbienne ou une blessure devront être complétées par un dosage de l' armadilline ( test ELISA avec un anticorps anti-armadillidine ) . Figure 31 : Spectres MALDI-TOF ( réalisés sur des protéines plasmatiques totales d' un seul animal ) après différents temps d' infection ( 0h , 3h , 6h , 9h , 12h , 24h ) par B . megaterium : suivi de la présence de l' armadillidine ( 5259 Da ) . III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES Nous avons isolé chez Armadillidium vulgare , que les animaux soient infectés ou non par Wolbachia , un peptide antibactérien nommé armadillidine . Ce peptide ( 5259 Da ) , synthétisé constitutivement dans les hémocytes , est riche en glycine et offre une activité contre les bactéries Gram ( + ) . Ce peptide est spécifique du genre Armadillidium et ne présente pas d' homologie avec les peptides antibactériens décrits dans la littérature . Pour une caractérisation plus complète de ce peptide plusieurs études restent à réaliser . La possibilité d' obtenir un peptide recombinant , constituerait un atout pour les études structure-fonction en dichroïsme circulaire , mais aussi pour tester son activité antimicrobienne de façon plus exhaustive , notamment contre un plus grand nombre de souches de champignons . La détermination de sa structure secondaire nous permettra de suspecter son mode d' action vis-à-vis des bactéries . Une étude par immunomarquage apparaît nécessaire pour déterminer la répartition de l' armadillidine dans les granules de différents types hémocytaires . Ce même type d' approche pourra être utilisée pour essayer de répondre à plusieurs questions qui pourraient être ( i ) comment se fait la libération de l' armadillidine ? est -ce une libération extracellulaire et/ou intracellulaire ? ( ii ) est -ce que les granules sont tous identiques en terme de stockage ou existe t -il une ségrégation granulaire ? ( iii ) lors d' une infection , est -ce qu' il y a exocytose de quelques espèces moléculaires déterminées ou est -ce une diffusion non spécifique ? Chapitre III Libération d' un peptide antifongique par clivage de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare . LIBÉRATION D' UN PEPTIDE ANTIFONGIQUE PAR CLIVAGE DE L' HÉMOCYANINE L' hémocyanine , qui est la protéine majoritaire ( 95 % ) dans le plasma ( Sellos et al. 1997 ) , a pour fonction de transporter l' oxygène par fixation des molécules d' oxygène au niveau d' hèmes constitués de cuivre . L' hémocyanine possède deux sites de liaison au cuivre au niveau de deux régions comportant trois histidines chacune . Cependant , cette fixation de l' oxygène n' est pas l' unique propriété de cette molécule multifonctionnelle . Chez les arthropodes , l' hémocyanine peut également posséder des pouvoirs d' osmolytes ou tampon ( Paul et Pirow 1998 ) , servir de transporteur pour la 20- hydroxyecdysone ou l' ecdysone ( Jaenicke et al. 1999 ) ou encore être un constituant de la cuticule ( Paul et al. 1994 ) . Chez certaines espèces , il a récemment été montré que l' hémocyanine pouvait avoir des propriétés analogues à la phénoloxydase ( Nagai et Kawabata 2000 ; Nagai et al. 2001 ; Lee et al. 2004 ) . Un rôle encore plus inattendu vient d' être mis en évidence chez deux espèces de crustacés , la participation de l' hémocyanine à la libération de peptides antimicrobiens . En effet , suite à une induction par du LPS ou par acidification du plasma , cette molécule subit un clivage de son extrémité C-terminale et génère un ou plusieurs peptides antimicrobiens ( Destoumieux-Garzon et al. 2001 ; Lee et al. 2003 ) . Chez les crevettes pénaeides , les peptides libérés ( PvHCt , PsHCt ) par clivage de l' extrémité C-terminale de l' hémocyanine sont antifongiques ( Destoumieux-Garzon et al. 2001 ) tandis que celui libéré ( astacidine ) chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus est dirigé contre les bactéries Gram ( - ) et les bactéries Gram ( + ) ( Lee et al. 2003 ) . Il nous est donc apparu logique de vérifier si un tel processus engendrant des peptides actifs existait chez Armadillidium vulgare . Etant donné que les séquences protéiques et nucléotidiques n' étaient pas connues chez les isopodes terrestres , il nous a fallu isoler l' ADNc de l' hémocyanine , ce qui nous a ensuite permis de déduire sa séquence protéique . En parallèle , nous avons réalisé l' induction du clivage de l' hémocyanine par acidification du plasma ainsi que la caractérisation des peptides présents dans les fractions plasmatiques acidifiées . Tableau 8 : Séquences des amorces utilisées pour isoler l' ADNc partiel de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare . I. CLONAGE DE L' ADNC DE L' HÉMOCYANINE Chez les crustacés , l' hémocyanine est une protéine , de masse moléculaire comprise entre 70 et 90 kDa , qui est synthétisée dans l' hépatopancréas . Chez l' animal , on rencontre différentes sous-unités de l' hémocyanine , de séquences variables , qui vont s' associer dans le plasma pour former des structures quaternaires , principalement sous forme d' hexamères . Les séquences protéiques de 5 hémocyanines de crustacés décapodes , Pacifastacus leniusculus ( écrevisse ) , Penaeus vannamei ( crevette ) , Pontastacus leptodactylus ( écrevisse ) , Panulirus interruptus ( crabe de Californie ) , Penaeus monodon ( crevette ) ont été alignées et comparées . Des amorces dégénérées ( Hem 1 et Hem 2 ) ont ainsi été déterminées dans les régions conservées de ces 5 espèces . Le positionnement de ces amorces est présenté dans la Figure 32 et leur séquence respective est donnée dans le Tableau 8 . Les amorces Hem 1 / Hem 2 ont permis d' amplifier un fragment de 324 pb qui a été cloné et séquencé . La séquence nucléotidique obtenue présente une taille attendue et sa séquence protéique déduite est homologue aux autres hémocyanines de crustacés . Le clonage et le séquençage des régions 3 ' et 5 ' de l' ADNc de l' hémocyanine a été réalisé par RACE-PCR selon la technologie SMART en utilisant de nouvelles amorces spécifiques ( Hem 3 et Hem 4 , Tableau 8 ) déterminées à partir de la séquence nucléotidique préalablement obtenue . Le séquençage des différents clones obtenus , réalisé grâce à l' utilisation d' amorces plus internes ( Figure 33 p 130 - 131 ) , nous a permis d' obtenir la séquence complète de l' ADNc de cette hémocyanine et de déduire sa séquence protéique complète . L' ADNc pleine taille ( 2147 pb ) est constitué d' une région codante de 2064 pb flanquée d' une région 5 ' UTR de 36 pb et d' une région 3 ' UTR de 47 pb . Le cadre de lecture ouvert code pour une protéine de 684 acides aminés qui présente une masse calculée de 78 062 Da si on considère les acides aminés constituant la proprotéine . Figure 33 . : Séquence nucléotidique de l' ADNc de l' hémocyanine . La séquence protéique déduite est indiquée sous la séquence nucléique . Le codon stop est écrit en italique et souligné . Le site de polyadénylation est doublement souligné . Sont indiqués en rouge et soulignés , les résidus histidine supposés être impliqués dans la liaison au cuivre . Le site potentiel de clivage du peptide signal est signalé par une double flèche verticale . Les amorces utilisées pour le séquençage de l' hémocyanine sont indiquées , sous la séquence protéique , par des flèches oranges . Cette masse calculée est en accord avec celle des autres hémocyanines , comme par exemple , 75 320 Da pour Pacifastacus leniusculus ( Lee et al. 2003 ) ou 74 980 Da pour Peneaus vannamei ( Sellos et al. 1997 ) . La séquence protéique de l' hémocyanine a été analysée par le logiciel PSORT II ( http ) , ce qui nous a permis de mettre en évidence la présence d' un peptide signal dont le site de clivage serait localisé entre les résidus 16 ( alanine ) et 17 ( tryptophane ) pour libérer la molécule fonctionnelle ( 76 437 Da ) . Les interrogations des banques de données ( NCBI / EMBL / SWISSPROT ) ont montré que cette protéine appartenait bien à la famille des hémocyanines . Comme les autres hémocyanines séquencées , elle présente deux sites de liaison au cuivre qui impliquent des résidus histidines ( soulignées et notées en rouge dans la Figure 33 , p 130 - 131 ) . Cette liaison à deux atomes de cuivre lui permet de jouer son rôle premier de transporteur de l' oxygène . Conformément aux hémocyanines connues , elle possède également un domaine potentiel phénoloxidase conservé dans la partie N- terminale tandis que sa partie C-terminale est variable . Ce travail préalable nous a permis de rechercher la présence du ou des peptides antimicrobiens potentiellement libérés par un ou plusieurs clivages de l' extrémité C-terminale de cette molécule multipotente . II . CLIVAGE DE L' EXTRÉMITÉ C-TERMINALE Deux études antérieures , chez Penaeusvannamei ( Destoumieux-Garzonetal . 2001 ) d' une part et , chez Pacifastacusleniusculus ( Leeetal . 2003 ) d' autre part ont rapporté l' isolement de peptides antibactériens issus du clivage de l' hémocyanine . Les deux techniques utilisées sont très similaires , il s' agit d' une acidification du plasma , respectivement par HCl 0 , 1 M ou par du TFA 0 , 1 % . Cette acidification permet d' induire le clivage de l' hémocyanine mais aussi la précipitation des grosses molécules y compris celles oxyphoriques qui sont alors éliminées par centrifugation . II.1 . Acidification du plasma par du TFA 0 , 1 % Après acidification du plasma par du TFA ( 0 , 1 % final ) , nous avons réalisé une cinétique de clivage de l' hémocyanine en fonction du temps ( 0h à 24h ) ; en fin d' expérience , après centrifugation , les protéines solubles ont été analysées en gels d' électrophorèse . Deux types de gels ont été utilisés , les gels classiques ( 12 , 5 % et 15 % d' acrylamide ) pour vérifier l' élimination de l' hémocyanine et , des gels comportant de la tricine , plus résolutifs , permettant de visualiser les peptides et les protéines de faible masses moléculaires éventuellement libérés suite au traitement avec le TFA . Quel que soit le type de gel utilisé , il s' est avéré que l' élimination de l' hémocyanine n' était pas optimale , ce qui posait un problème pour l' analyse des résultats électrophorétiques et surtout compromettait gravement nos futures analyses en RP-HPLC . Nous avons donc introduit une étape supplémentaire dans la précipitation des protéines solubles plasmatiques . En fin de cinétique , les protéines ont été fractionnées sur cartouches Sep Pak C 18 et éluées par élutions successives d' ACN / 0 , 1 % TFA à 20 % , 50 % et 80 % . Après concentration sous vide , les différents éluats solubilisés dans du tampon échantillon ont été déposés uniquement sur un gel de tricine . Bien que plusieurs bandes de masses moléculaires estimées entre 5 et 2 kDa soient visibles dans le bas des gels , il n' a pas été possible d' établir une variation quantitative de l' intensité de ces bandes en fonction du temps de coupure . De plus , des traces en tête de gel suggéraient également que l' hémocyanine était encore notablement présente . Ces résultats préliminaires , nous ont conduit à opter pour la technique de précipitation de l' hémocyanine par HCl ( 0 , 1 M final ) proposée par Destoumieux- Garzon et collaborateurs ( 2001 ) . II.2 . Acidification du plasma par du HCl 0 , 1M Le plasma a été acidifié par HCl 0 , 1 M , pendant des temps variables ( 4 à 8h ) , sous agitation constante et à une température de 4 °C. Les protéines plasmatiques solubles ont été fractionnées sur cartouche Sep-Pak C18 . Comme dans les expériences précédentes , les différents éluats ont été analysés sur gels de tricine . Il est alors apparu que si l' intensité des bandes de faibles masses moléculaires étaient équivalentes ( pour des volumes initiaux de plasma identiques ) à celles observées lors de la précipitation par le TFA , par contre l' hémocyanine était réduite à l' état de traces . Ces résultats nous autorisaient à utiliser les éluats plasmatiques après Sep-Pak C18 pour effectuer des chromatographies du type RP-HPLC . Une analyse des plasmas d' animaux sains ( non infectés par Wolbachia ) et d' animaux infectés par Wolbachia a été conduite ( Figures 34 et 35 , p 136 - 137 ) . Le chromatogramme du plasma d' animaux sains comporte six pics majeurs ( Figure 34 ) dont les caractéristiques ( temps d' élution , pourcentage d' ACN , masses ) sont consignées dans le Tableau 9 . Le chromatogramme du plasma d' animaux infectés par Wolbachia comporte seulement 4 pics majeurs ( Figure 35 et Tableau 9 ) . Dans ces deux chromatogrammes deux pics offrent des masses respectives en MALDI-TOF de 1539 Da et 2932 Da . Ces masses mesurées correspondent aux masses calculées de deux peptides composés respectivement des 12 et 24 derniers acides aminés de l' hémocyanine d' Armadilldium vulgare ( Figure 36 ci-dessous ) . Figure 36 : Séquence protéique de l' extrémité C-terminale de l' hémocyanine . Les doubles flèches indiquent les sites de clivage qui conduisent à la libération de 2 peptides d' une masse respective de 1539 et 2932 Da . Figure 34 : A . RP-HPLC des protéines plasmatiques d' Armadillidium vulgare extraites en conditions acides ( HCl 0 , 1 M ; 6 h ) . Les fractions numérotées de 1 à 6 ont été analysées en spectrométrie de masse MALDI-TOF . Les spectres MALDI-TOF obtenus pour les fraction 1 et 4 sont présentés en B. et C . Figure 35 : RP-HPLC des protéines plasmatiques d' Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia extraites en conditions acides ( HCl 0 , 1 M ; 6 h ) . Les fractions numérotées 1 , 4 , 5 et 6 ont été analysées en spectrométrie de masse MALDI-TOF . Figure 37 : Alignement des séquences obtenues par dégradation d' Edman des deux peptides C-terminaux ( contenus dans les pics 1 et 4 ) sur la séquence déduite de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare . Afin de confirmer nos données relatives à ces peptides , nous avons déterminé la séquence N-terminale de ces peptides par dégradation d' Edman . Les résultats obtenus ( Figure 37 ) ont confirmé notre attente . Le premier peptide composé de 12 acides aminés ( pic 1 ) présente 42 % de résidus histidine , 33 % d' acide aspartique et 8 , 3 % de phénylalanine et de valine . Ce peptide est chargé négativement ( - 5 ) à pH physiologique et présente un pI de 5 , 08 . Le second peptide composé de 24 acides aminés ( pic 4 ) présente 25 % de résidus histidine , 16 , 7 % d' acide aspartique , 12 , 5 % de valine , 8 , 3 % de d' acide glutamique , de lysine et de phénylalanine et 4 , 2 % d' asparagine , de proline , de sérine , d' isoleucine et de leucine . Ce peptide est aussi chargé négativement et présente un pI de 5 , 73 . Ces deux peptides ont donc des propriétés physico-chimiques assez proches . Après interrogation de la banque de données SwissProt , aucune homologie significative avec d' autres peptides n' a pu être obtenue . Chez la crevette Penaeus vannamei , le clivage de l' hémocyanine à son extrémité C-terminale conduit à la libération d' un peptide antifongique , qui ne présente aucune activité antibactérienne . Par contre , le peptide issu du clivage de l' hémocyanine chez l' écrevisse Pacifastacus leptodactylus présente une activité antibactérienne dirigée contre les 2 types de bactéries . Nous avons donc voulu savoir si les deux peptides de 12 et 24 acides aminés libérés après clivage de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare ont une activité antimicrobienne . La faible quantité de ces peptides obtenue après clivage de l' hémocyanine ne nous permettait pas de réaliser des tests d' activité antimicrobienne sur toutes les souches de champignons et de bactéries dont nous disposions . Nous avons donc , dans un premier temps , tester l' effet des protéines plasmatiques traitées par HCl sur 9 souches de champignons [ Aspergillus niger , Botrytis cinerea , Eutypa lata , Phaeomoniella chlamydospora , Saccharomyces cerevisiae ( FL100 , Erg 6 & 204;& 135; , WT Euroscarf ) , Pichia pastoris , Candida glabrata ] , 2 souches de bactéries Gram ( - ) ( Escherichia coli et Enterobacter cloacae ) et 2 souches de bactéries Gram ( + ) ( Bacillus megaterium et Micrococcus luteus ) . Une activité antifongique , dirigée contre Botrytis cinerea a été observée , par contre aucune activité n' a été détectée contre les autres champignons , ni contre les bactéries Gram ( - ) ou Gram ( + ) testées . Afin de déterminer si cette activité antifongique était due à l' un des deux peptides purifiés de 12 et 24 acides aminés , nous les avons testés contre la souche de champignon sensible , Botrytis cinerea . Pour ces premiers essais , la quantité de peptide testée n' a pas pu être dosée par des méthodes classiques . Une quantification basée sur la surface des pics ( correspondant à chacun des peptides ) obtenus par RP-HPLC nous permet toutefois d' estimer que la même quantité de peptide a été utilisée . Les premiers résultats indiquent que le peptide issu du pic 4 est actif contre Botrytis cinerea , confirmant l' action observée des protéines plasmatiques solubles après acidification par HCl contre cette même souche . Par contre , le peptide issu du pic 1 ne montre pas d' activité . Il convient toutefois d' être prudent avec ce résultat négatif qui devra être confirmé en utilisant notamment des quantités déterminées du peptide de 12 acides aminés . De même , l' activité dirigée contre Botrytis cinerea imputable au peptide de 2932 Da devra être précisée notamment en déterminant la MIC . Les peptides isolés chez les crevettes P. vannamei et P. stylorostris ( PvHCt et PsHCt ) présentent une charge négative , un pI de 5 , 5 et offrent une activité antifongique . Aux vues des premiers résultats , il semblerait que le peptide de 2932 Da se rapprocherait par ces fonctions physico-chimiques et fonctionnelles des peptides isolés chez Penaeus vannamei . Par contre , il est très différent du peptide ( astacidine ) isolé chez l' écrevisse , qui lui présente des propriétés classiques de peptide antibactérien , puisqu' il est cationique et est dirigé contre les bactéries à Gram ( - ) et à Gram ( + ) . III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES Dans cette étude , nous avons cloné l' ADNc de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare , déterminé sa séquence nucléotidique et déduit la séquence protéique . Nous avons également montré que l' hémocyanine pouvait être clivée en conditions acides et libérer deux peptides chargés négativement , un premier composé de 12 acides aminés d' une masse moléculaire de 1539 Da et un second constitué de 24 acides aminés d' une masse moléculaire de 2932 Da , ce dernier présentant une activité antifongique dirigée contre Botrytis cinerea . Ces premiers résultats devront être confirmés et notamment , il conviendra de s' assurer que le peptide de 12 acides aminés ne présente réellement pas d' activité antimicrobienne . Pour cela , il faudrait disposer d' une grande quantité de peptide car , comme pour l' armadillidine , la quantité de produit purifié obtenue à partir des animaux est très faible . De plus , à la différence de l' armadillidine , ces peptides de 12 et 24 résidus sont trop petits pour être exprimés dans un système d' expression / production , il faudrait donc les faire synthétiser chimiquement pour tester leur activité . Le clivage de l' hémocyanine , libérant un peptide antifongique ou antibactérien , est un mécanisme décrit chez d' autres espèces de crustacés . Deux isoformes d' un peptide antifongique ont été décrites chez Penaeus stylirostris , alors qu' un seul peptide a été jusqu'à maintenant caractérisé chez Penaeus vannamei ( Destoumieux-Garzon et al. 2001 ) . Chez Pacifastacus leniusculus , un seul peptide antibactérien a pour l' instant été identifié ( Lee et al. 2003 ) . Dans les deux cas , des expériences de clivage de l' hémocyanine ont été réalisées par une stimulation microbienne . Chez les crevettes , les auteurs ont induit la réponse immunitaire par l' ajout d' un mélange de champignons , de bactéries Gram ( + ) et de bactéries Gram ( - ) préalablement tuées ( Destoumieux-Garzon et al. 2001 ) . Chez l' écrevisse , la réponse immunitaire a été induite par des injections de LPS ou de & 206;& 134; 1 , 3- glucan ( Lee et al. 2003 ) . Dans les deux cas , une augmentation des peptides antimicrobiens issus du clivage de l' hémocyanine a été observée . Lee et collaborateurs ( 2003 ) ont également montré que le clivage de l' hémocyanine est réalisé par une protéinase cystéine-like ou une aspartyl protéase , probablement issues des lysosomes . Le mécanisme de clivage de l' hémocyanine n' est pas connu avec certitude , mais il est suspecté que les enzymes responsables de ce clivage pourraient être induites , libérées et activées lors de la réponse immunitaire . Ces enzymes proviendraient des hémocytes , qui lors des infections libèreraient le contenu de leur granules par exocytose ( ou par lyse des hémocytes ) dans l' hémolymphe . Chez Armadillidium vulgare , le clivage de l' hémocyanine libère un peptide dont nous avons montré l' activité antifongique . L' analyse quantitative , par immunoprécipitation ou ELISA , de la libération de ce peptide de l' hémocyanine pourra également être développée après induction par des déterminants antigéniques ( LPS ou & 206;& 134; 1 , 3- glucanes ) déjà utilisés chez les décapodes . Le mécanisme de clivage de l' hémocyanine chez Armadillidiumvulgare pourrait , comme chez l' écrevisse , également faire intervenir une aspartyl protéase . En effet , à partir de protéines hémocytaires analysées en électrophorèse bidimensionnelle ( cf Chapitre IV ) , une cathepsine D-like lysosomale a été trouvée ; cette cathepsine est une aspartyl protéase et pourrait donc être une des enzymes potentiellement capables de cliver l' hémocyanine . L' action de la ou des enzymes qui clivent l' hémocyanine [ cystéine-like protéase , aspartyl protéases ( Lee et al. , 2003 ) ] serait facilitée par la position structurale de l' extrémité C-terminale au sein de l' hémocyanine . En effet , Decker et Jaenicke ( Decker et Jaenicke 2004 ) , proposent , par analogie , une analyse structurale de l' hémocyanine et de la position relative des peptides antibactériens potentiels situés à l' extrémité C-terminale de la molécule . Cette modélisation , présentée Figure 38 , a été réalisée à partir de la structure cristallographique de l' hémocyanine de Panulirus interruptus qui présente une forte homologie avec les sous-unités des hémocyanines dont sont issus les peptides antimicrobiens trouvés chez P. vannamei , P. stylirostris et P. leniusculus . Elle montre que tous les peptides sont localisés à la surface des sous-unités et sont très facilement accessibles aux pathogènes ( même dans les hexamères ) et semblent faire partie du domaine III qui présente une structure en feuillets & 206;& 134;. Après libération dans l' hémolymphe , la structure de ces peptides doit être modifiée , malheureusement l' étude structurale de PvHCt , PsHCt 1 et PsHCt 2 n' a pas été réalisée . Par contre , un spectre de dichroïsme circulaire a été obtenu pour l' astacidine , il suggère une structure en feuillets & 206;& 134; pour des valeurs de pH comprises entre 4 et 8 et à différentes températures . Une étude structurale du peptide , issu du clivage de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare , actif contre Botrytiscinerea pourra être réalisée afin de comprendre son mécanisme d' action . Cependant , il est probable que sa structure soit aléatoire , comme le prédit la modélisation virtuelle dans ExPasy ( Swissprot ) . Il est à noter que cette expérience du clivage de l' hémocyanine a été réalisée sur des animaux infectés ou non par Wolbachia , et il ne semble pas y avoir de différences qualitatives quant aux peptides générés . Il serait donc intéressant de voir ultérieurement , si Wolbachia peut affecter l' activité de l' enzyme qui clive l' hémocyanine ou si cette bactérie endocellulaire affecte la synthèse de l' hémocyanine au sein des cellules de l' hépatopancréas . Les nombreuse propriétés de l' hémocyanine déjà décrites chez différents arthropodes , n' interdisent pas d' envisager des approches complémentaires pour préciser les rôles de cette protéine chez Armadillidium vulgare . En effet , une étude sur l' activité phénoloxydase potentielle ainsi que son activité catécholoxydase suspectée seraient intéressantes à appréhender , notamment pour savoir si l' activité phénoloxydase de l' hémocyanine activée complète celle produite par le système ProPO ( spécifique de la réponse immunitaire des arthropodes sauf des chélicérates ) ou bien si cette activité est un vestige d' un système plus ancestral . En effet , chez les chélicérates , le système ProPO n' existe pas et l' hémocyanine assure l' activité phénoloxydasique . Le système ProPO est un système de reconnaissance du non-soi qui est constitué d' une série d' enzymes du type sérine protéase qui agissent en cascade . Lors de leur libération , par exocytose régulée ( Cerenius et Söderhäll 2004 ; pour revue ) , toutes ces enzymes contenues dans les granules des hémocytes sont activées . Le précurseur de la phénoloxydase ( ProPO ) est clivé par une sérine protéase ( ppA ) qui libère la forme active ( PO ) . La PO va alors oxyder les phénols en quinones , qui vont se polymériser par une réaction non-catalytique et produire la mélanine . Chez les arthropodes , la partie N-terminale de l' hémocyanine présente de fortes homologies avec la phénoloxydase mais également des ressemblances avec les tyrosinases d' autres phylums et des hémocyanines de mollusques . Toutefois , si les hémocyanines de mollusques et celles d' arthropodes ne présentent pas de réelles homologies de séquence , elles peuvent cependant être toutes activées et acquérir alors une activité phénoloxydase sur des substrats o-diphénoliques ( Cerenius et Söderhäll 2004 ; pour revue ) La comparaison de notre séquence de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare avec d' autres hémocyanines et prophénoloxydases de crustacés montre que les domaines de liaison au cuivre entre les différentes hémocyanines et les différentes prophénoloxydases présentent de fortes homologies ( voir annexe III ) . Cependant , ces 2 types de protéines possèdent des propriétés physico-chimiques très différentes , telles que leur charge et leur hydrophobicité . Les hémocyanines sont fortement chargées négativement ( afin de minimiser les interactions avec les autres protéines de l' hémolymphe ou avec les tissus ) , alors que les phénoloxydases sont neutres ce qui diminue leur solubilité dans l' hémolymphe et favorise leur interaction avec la surface des tissus ( Jaenicke et Decker 2003 ) . Il serait donc intéressant d' étudier la capacité de l' hémocyanine à acquérir cette activité phénoloxydase chez Armadillidium vulgare et d' établir : - Si comme chez les autres crustacés étudiés , cette activité est induite par un clivage de l' hémocyanine et d' identifier ce site spécifique d' une sérine protéase qui est libérée par les hémocytes lorsqu' ils sont eux-mêmes stimulés par une infection microbienne . Ce clivage permet ainsi l' accessibilité du site catalytique phénoloxydase aux groupements phénol des molécules circulant dans l' hémolymphe ( Adachi et al. 2003 ; Lee et al. 2004 ) . - Ou , si comme chez les chélicérates , qui sont dépourvus de système prophénoloxydase , ce sont les peptides antibactériens , libérés par les hémocytes lors d' une infection bactérienne , qui en se liant à l' hémocyanine modifient sa conformation , permettant l' accessibilité au site catalytique phénoloxydase ( Nagai et Kawabata 2000 ; Nagai et al. 2001 ) . L' utilisation de molécules oxyphoriques ( hémoglobine , hémocyanine , hemerythrine ... ) comme matrice pour générer des peptides actifs dans différents registres est un phénomène qui existe chez les invertébrés comme chez les vertébrés . Ainsi , il a été montré que ces molécules peuvent engendrer des peptides présentant des activités antimicrobiennes ( Ivanov et al. , 1997 ; Fogoca et al. , 1999 ; Destoumieux- Garzon et al. , 2001 ; Lee et al. , 2003 ; Vergote et al. , 2004 ) ou neuropeptidiques ( Salzet et al. , 1996 ; Salzet et Deloffre , 2000 ) . Récemment , le panel d' activités de l' hémocyanine vient d' être complété par l' attribution d' une activité nouvelle antivirale chez la crevette Peneaus monodon ( Zhang et al. 2004 ) , confirmant ainsi son rôle très important dans la réponse immunitaire innée . Chapitre IV Recherche d' effecteurs impliqués dans le système immunitaire : Approche protéomique RECHERCHE D' EFFECTEURS IMPLIQUÉS DANS LE SYSTÈME IMMUNITAIRE : APPROCHE PROTÉOMIQUE Comme nous l' avons vu précédemment , la majorité des effecteurs de l' immunité innée chez les crustacés est produite et stockée dans les hémocytes . Cependant , d' autres organes participent à l' édification de cette réponse immunitaire . C' est notamment le cas des organes hématopoïétiques qui sont à l' origine des hémocytes matures . Récemment , il a été montré que les pré-hémocytes encore contenus dans les organes hématopoïétiques synthétisent précocement certaines protéines du système immunitaire , comme les péroxynectines ou des peptides antimicrobiens ( Destoumieux et al. , 2000b ; Destoumieux-Garzon et al. , 2001 ; Lee . et al. , 2003 ; Somboonwiwat et al. , 2005 ) ; par contre , d' autres n' y sont pas encore exprimées comme par exemple la prophénoloxydase ( Söderhäll et al. , 2003 ) . Les caecums digestifs contribuent également à la réponse immunitaire en produisant diverses protéines , dont l' hémocyanine ( cf Chapitre II ) , les & 206;& 134; 1 , 3- glucan binding protéines ( Lee et al. , 2000 ; Cheng et al. , 2005 ) ou les facteurs de coagulation ( Hall et al. , 1999 ) , qui sont ensuite sécrétées dans l' hémolymphe . Dans un système circulatoire ouvert , le plasma sert de transporteur et baigne tous les tissus . Wolbachia est présente dans tous les tissus des animaux infectés , toutefois les charges bactériennes sont très variables selon les tissus considérés et les ovaires sont le tissu de choix pour ces bactéries qui se transmettent verticalement . Les facteurs de virulence et les toxines libérées par la Wolbachia pourraient être transportés par le plasma et provoquer une dérégulation du fonctionnement des tissus participant à la réponse immunitaire . Aussi , l' analyse de l' hémolymphe ( hémocytes et plasma ) , des organes hématopoïètiques et des caecums digestifs a été effectuée chez des Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia . L' analyse protéomique des tissus constituant les trois principales sources de la réponse immune innée , relatée dans cette étude a un double but : - Identifier et caractériser les protéines du système immunitaire d' Armadillidium vulgare . - Comparer les profils d' expression protéique d' Armadillidium vulgare infecté ou non par Wolbachia , afin de déterminer si cette bactérie endocellulaire est capable de modifier l' expression de certaines protéines de son hôte ou de produire une ou des protéines qui interféreraient avec le système immunitaire et permettrait ainsi son maintien dans la cellule hôte . Pour ce faire , nous avons utilisé différentes approches . Afin d' observer des différences d' expression des protéines entre les différents animaux au niveau de l' hémolymphe ( hémocytes et plasma ) , des organes hématopoïétiques et des caecums digestifs , une analyse en électrophorèse 1- dimension a été réalisée en première approche . Ensuite , nous avons mis en place l' analyse des protéines par électrophorèse bidimensionnelle . C' est une méthode très utilisée parce qu' elle est résolutive , sensible , fiable et reproductible si l' on s' adresse à des protéines dont la masse moléculaire est & 199;& 131; à 10 kDa . Nous avons appliqué cette technique essentiellement à l' analyse des hémocytes et du plasma . Figure 39 : Protéines d' Armadillidium vulgare ( A.v. ) infectés ou non par Wolbachia ( + W ) . ( A ) Protéines plasmatiques . ( B ) Protéines totales de 8 caecums digestifs . ( C ) . Protéines totales de 120 organes hématopoïétiques . ( D ) Protéines hémocytaires . La flèche blanche indique la bande qui pourrait inclure l' armadillidine . La tête de flèche orange indique la zone de migration des sous-unités de l' hémocyanine ( masses apparentes 67 à 73 kDa ) . La tête de flèche jaune indique une bande différentielle de 32 kDa . I. ÉLECTROPHORÈSE 1-D I.1 . Hémocytes Les protéines issues des hémocytes d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia ont été extraites puis séparées sur gels d' acrylamide . L' observation des gels colorés nous a permis de comparer les profils des protéines de masses moléculaires comprises entre 6 kDa et 200 kDa ( Figure 39 , D. ) . Cette comparaison n' a pas mis en évidence de différences notables entre les profils protéiques qui présentent un grand nombre de protéines matérialisées par des bandes de tailles et d' intensités comparables . Dans le bas du gel , près du front de migration , une bande mieux résolue en gel tricine pourrait correspondre à l' emplacement de l' armadillidine ( Figure 39 , D. ) . I.2 . Plasma Le plasma est un milieu complexe qui véhicule les produits libérés par les hémocytes mais également ceux d' autres tissus tels que les caecums digestifs , le tissu adipeux et les organes endocrines . Hors épisode infectieux , les protéines du système immunitaire ne sont pas décelables dans le plasma sauf certaines protéines de reconnaissance telles que les De la même manière que pour les hémocytes , nous avons entrepris la mise en évidence et l' identification de quelques protéines plasmatiques . Avant d' être déposées sur gels d' acrylamide , les protéines plasmatiques ont été traitées à l' HCl ou au TFA pour éliminer le plus possible l' hémocyanine . La Figure 39 , A p 148 montre les profils obtenues après migration des protéines plasmatiques après précipitation par du TFA ( 0 , 1 % final ) . La précipitation de l' hémocyanine dans ces échantillons n' est que partielle , ce qui perturbe la migration et ne permet pas une bonne visualisation des protéines faiblement représentées ou de faibles masses moléculaires inférieures à 20 kDa . I.3 . Autres tissus : Organes hématopoïétiques et caecums digestifs Les hémocytes sont produits par les organes hématopoïétiques et il semble , d' après les analyses en microscopie électronique , que la maturation des hémocytes s' opère in situ et non dans la circulation générale après leur libération . La présence de granules denses aux électrons permet de reconnaître les deux types de cellules granulaires et laisse donc supposer que des protéines du système immunitaire sont déjà stockées et que leur synthèse précoce s' est opérée dans les organes hématopoïétiques . La synthèse précoce de certaines molécules de l' immunité innée a déjà été mis en évidence à la fois chez les crevettes par la recherche des pénaeidines ( peptides antimicrobiens ) ( Destoumieux et al. , 2000 ) , mais également chez l' écrevisse par l' identification des péroxinectines ( Söderhäll et al. , 2003 ) . L' analyse électrophorétique comparative des protéines constitutives des organes hématopoïétiques et des hémocytes circulants pouvait nous montrer s' il existait des différences importantes entre ces deux échantillons . De plus , la présence de Wolbachia dans les organes hématopoïétiques pouvait -elle induire des variations marquées dans l' expression des protéines étudiées ? Les profils électrophorétiques obtenus à partir des organes hématopoïétiques sont pour le moins aussi complexes que ceux réalisés à partir des hémocytes . Cependant , dans la zone 14 , 4 - 20 , 1 kDa , un ensemble de deux bandes dont l' une est très intense paraît caractéristique des organes hématopoïétiques ( Figure 39C , p 148 ) . Dans le haut du gel ( zone 67 - 94 kDa ) , les protéines semblent moins intensément exprimées que dans les hémocytes circulants , de même pour les protéines de masses apparentes comprises entre 25 et 30 kDa . Notons aussi , qu' une bande visible au bas du gel pourrait correspondre à un ensemble de peptides mal résolus où pourrait figurer l' armadillidine . Aucune différence n' est appréciable entre les profils électrophorétiques d' organes hématopoïétiques d' animaux sains et d' animaux infectés . Chez l' écrevisse P . leniusculus ( Söderhäll et al. , 2003 ) , il a été montré que les protéines d' adhésion et de prolifération cellulaire s' expriment déjà dans les organes hématopoïétiques ; la prophénoloxydase ne serait synthétisée que plus tard dans les hémocytes circulants . Entre les patterns protéiques des organes hématopoïétiques et ceux des hémocytes circulants , il existe une certaine analogie cependant , les différences observées laissent penser que la maturation des hémocytes n' est peut-être pas complète au moment de leur libération dans la circulation générale . En l' absence d' anticorps , notre étude n' a pu caractériser une ou des protéines spécifiques des hémocytes in situ et circulants . Le caecums digestifs des crustacés peuvent être comparés , de par leurs fonctions , au foie des vertébrés et ils synthétisent une diversité de molécules dont certaines sont libérées dans l' hémolymphe : Sur nos gels , nous avons pu identifier deux bandes qui doivent correspondre à des sous- unités de l' hémocyanine présentant des masses apparentes entre 67 à 73 kDa ( Figure 39 , B ) . La présence ou non de Wolbachia ne semble pas affecter qualitativement les profils électrophorétiques , cependant une bande additionnelle ( 32 kDa ) existe chez les animaux hébergeant Wolbachia . Nos gels montrent clairement que les sous-unités de l' hémocyanine sont synthétisées dans les caecums digestifs comme chez tous les autres crustacés . Il semble que la présence de Wolbachia s' accompagne d' une légère diminution de la quantité des sous-unités de l' hémocyanine synthétisées dans les caecums . Cette donnée devra être validée soit en PCR quantitative soit en slot-blots . Que ce soit pour les protéines du plasma , des hémocytes , des organes hématopoïétiques et des caecums digestifs , cette approche en électrophorèse 1D , indispensable , d' une part pour tester l' efficacité des techniques d' extraction des protéines qui seront appliquées à l' analyse en 2-D et , d' autre part pour apprécier la complexité des profils obtenus , s' est révélée assez peu résolutive . L' étude de ces différents extraits protéiques a alors été entreprise par la technique d' électrophorèse bidimensionnelle pour améliorer la séparation des nombreuses protéines mais également pour faciliter l' identification des différentes protéines présentes sur les gels . II . ÉLECTROPHORÈSE 2-D Dans le but de comparer les profils protéiques hémocytaires d' Armadillidium vulgareinfectés ou non par Wolbachia , mais aussi d' identifier des protéines du système immunitaire , nous avons choisi la technique d' électrophorèse en 2-D . Cette technique a été choisie car elle est plus résolutive que celle des gels en 1-D , d' une part ( parce ce que les protéines sont séparées selon leur point isoélectrique et leur masse moléculaire ) et d' autre part parce que les analyses de spots protéiques obtenus à l' issue de ces gels permettent l' identification de protéines par spectrométrie de masse après digestions trypsiques . Les problèmes de migration des protéines de même masse moléculaire et de contamination des bandes à prélever sont ainsi diminués . Nous nous sommes intéressés , comme pour les analyses en 1-D , au protéines hémocytaires et plasmatiques . Les protéines hémocytaires ont été extraites par sonication dans de l' acide acétique 0 , 2 N , puis précipitées à l' acétone et reprises dans le tampon de solubilisation pour être déposées sur les strips . Cette méthode d' extraction nous permet d' obtenir les protéines cytosoliques et granulaires . Les protéines plasmatiques , quant à elles , ont subit un traitement HCl 0 , 1 M , afin d' éliminer au maximum l' hémocyanine , puis elles ont été déposées sur cartouche Sep-Pak et éluées par une solution d' ACN à 80 % . Une fois séchées et reprises dans le tampon de solubilisation , les protéines ont été dosées et les strips ont été chargées en protéines hémocytaires ou plasmatiques à raison de 400 & 206;& 144;g par strip . Dans un premier temps , l' isofocalisation et l' électrophorèse des protéines ont été réalisées au laboratoire afin de mettre au point les meilleures conditions expérimentales . En effet , de nombreux paramètres sont très importants et particulièrement l' extraction des protéines ( les échantillons ont été désalés et les lipides de réserve et membranaires ont été éliminés ) . Ces premiers gels ont été colorés à l' argent ce qui permet une bonne résolution et donc de déterminer les conditions optimales de préparation des échantillons . Par contre , cette méthode de coloration ne permet pas leur exploitation car la présence d' argent est incompatible avec les analyses en spectrométrie de masse . Une fois les mises au point réalisées , les gels ont été effectués plusieurs fois et leur reproductibilité nous a autorisé à poursuivre cette étude en utilisant une coloration au bleu colloïdal ( G- 105 ) qui permet une analyse des protéines en spectrométrie de masse de type Q-TOF , ceci après digestion enzymatique . Au cours d' un stage de deux semaines dans le Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio- Organique de Strasbourg ( dirigé par le Dr . A . Van Dorsselaer ) , les gels d' électophorèse bidimensionnelle , leur analyse et le prélèvement des spots d' intérêt ont été réalisés avec l' aide de Mme Danièle Thiersé . Les protéines contenues dans ces spots ont été digérées et analysées en spectrométrie de masse de type Q-TOF par le Dr J.M . Strub . Toutes les données obtenues ont été traitées avec le logiciel MASCOT et toutes les microséquences ont été comparées dans les banques de données afin d' identifier les protéines dont elles étaient issues . Quand l' analyse dans MASCOT s' est avérée infructueuse , chaque microséquence a été soumise à un Blast dans l' EBI . Figure 40 . : Carte 2-D des protéines hémocytaires de femelles d' Armadillidium vulgare non infectées . Les protéines entourées d' un rond vert ont été prélevées et analysées en spectrométrie de masse ( Q-TOF ) après coupure trypsique . Les protéines identifiées sont indiquées en blanc . Le triangle et les carrés blancs indiquent les protéines identiques . MM : Masse Moléculaire . NL : strip non linéaire . II.1 . Hémocytes L' identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare a été réalisée à partir de 8 gels . Trois cents spots ont ainsi été prélevés et analysés . Pour les protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia , 59 spots ont été prélevés et analysés à partir de 2 gels . L' analyse des microséquences obtenues pour ces spots nous a conduit à l' identification de 54 protéines spécifiques d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia et 3 protéines bactériennes dont une spécifique de Wolbachia . 1.1 . Identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare . L' ensemble des résultats obtenus pour les gels des protéines hémocytaires est figuré sur une carte bidimensionnelle ( Figure 40 ) . Les différentes protéines identifiées à partir de cette carte sont regroupées dans le Tableau 10 , p 156 . Il faut souligner que les comparaisons de microséquences ne peuvent être réalisées qu' à partir d' organismes plus ou moins proches tels que les crustacés décapodes ou les insectes ( drosophile , anophèle ... ) puisque très peu de protéines d' Armadillidium vulgare ont été déposées dans les banques de données . Il en est de même pour les protéines de Wolbachia qui seront comparées avec l' ensemble des bactéries connues . Ces protéines ont été regroupées en quatre catégories : les protéines impliquées dans la réponse au stress , dans la constitution du cytosquelette , dans les réactions enzymatiques et les protéines non classables . Les protéines enzymatiques : La majorité des protéines enzymatiques identifiées , par soumission dans les banques de données , des microséquences obtenues en spectrométrie de masse , intervient dans le métabolisme du glucose : 6 phosphogluconate dehydrogenase , fructose 1 - 6 diphosphate aldolase , glyceraldéhyde 3 phosphate dehydrogénase , énolase , NAD dependant malic enzyme , pyruvate kinase , transketolase . Ces protéines enzymatiques , présentes en quantité importante ( intensité des spots et répartition ) , fournissent l' énergie nécessaire au fonctionnement des cellules mais également à la synthèse des protéines spécifiques de la réponse immunitaire qui sont stockées dans les granules . D' autres protéines enzymatiques , telles que des kinases et des protéases , sont trouvées abondamment , preuve d' une activité cellulaire importante . Parmi les protéases , une a retenu notre attention : la cathepsine lysosomale . En effet lors de la caractérisation de l' astacidine ( peptide antibactérien clivé à partir de l' hémocyanine ) , Lee et collaborateurs ( 2003 ) ont montré que le clivage de l' hémocyanine était inhibé par ajout de pepstatine ou de E- 64 . Ces deux inhibiteurs de protéases agissent respectivement sur des aspartyl protéases et sur des cystéine-protéases . Pour ces auteurs , ces protéases doivent être lysosomales pour être libérés dans l' hémolymphe , en même temps que les autres effecteurs de l' immunité . Comme les cathepsines D sont des aspartyl protéases , la cathepsine D « lysosomale » identifiée semble être un bon candidat pour générer des peptides à partir de l' extrémité C-terminale de l' hémocyanine . L' activité de cette cathepsine D « lysosomale » pourra être testée sur l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare afin de voir si elle est capable de la cliver et de générer des peptides antimicrobiens , dont le peptide antifongique que nous avons caractérisé ( Chapitre III . ) . Figure 41 : Représentation schématique des caractéristiques structurales de différentes protéines apparentées au cytosquelette . Parmi ces protéines , la profiline , la vinculine et les différentes formes de l' actine ont été identifiées en électrophorèse bidimensionnelle ( Golstreyn et al. , 2000 ; pour revue ) . Les protéines du cytosquelette : De nombreuses protéines constitutives du cytosquelette ont également été identifiées . Ces protéines constituent une part importante de l' ensemble des protéines hémocytaires . En effet , de nombreux spots , dont un très dense , ont été identifiés comme différentes formes de l' actine ( & 206;& 133;-actine et & 206;& 134;-actine ) , d' autres correspondent à la & 206;& 134; II tubuline . L' analyse des microséquences a permis de mettre en évidence cinq protéines associées au cytosquelette : la vinculine , la profiline , la tropomyosine et deux calponines . L' implication de ces protéines associées au cytosquelette est schématisée Figure 41 . La profiline est une protéine de modulation et de contrôle des mouvements de l' actine . Elle lie les molécules monomériques d' actine pour former des complexes qui vont s' associer avec les extrémités des filaments d' actines permettant ainsi leur croissance . La vinculine est une protéine des plaques focales d' adhésion qui permet l' ancrage du cytosquelette d' actine à la membrane plasmique . Cette protéine est la cible de certaines bactéries telles que les Shigella ( Figure 42 , p 160 ) . En effet , ces bactéries produisent une protéines appelée IpaA , qui est excrétée dans la cellule hôte par un système de sécrétion de type III . Figure 42 : Schéma des différents mécanismes d' entrée des bactéries dans les cellules hôtes . A . Le mécanisme « Zipper » utilisé par Yersinia et Listeria . B . Le mécanisme « Trigger » utilisé par Salmonella et Shigella ( d' après Cossart et Sansonetti , 2004 ) . Cette IpaA se lie spécifiquement à la vinculine dans son domaine N-terminal , ce qui entraîne une modification de la structure de la vinculine qui se déplie et induit l' activation du complexe . L' activation de la vinculine par IpaA interviendrait dans la formation d' une structure d' adhésion transitoire de la bactérie à la membrane de la cellule ( Cossart et Sansonetti , 2004 ; pour revue ) . De plus , ce complexe présente une activité de dépolymérisation des filaments d' actine ( Bourdet-Sicard et al. , 1999 ) . La déstabilisation de cette protéine permet donc l' entrée de bactéries dans les cellules sans que celles -ci ne soient reconnues . Le mécanisme d' entrée de Wolbachia dans les cellules de son hôte n' est pas connu , cependant au cours de la caractérisation du génome de cette bactérie , un système de secrétions de type IV a pu être identifié ( Felix et al. , Soumis ) et rapporté à deux opérons distincts . Ce système de type IV doit permettre le transfert des facteurs de virulence vers le cytoplasme de la cellule hôte au travers de la paroi bactérienne . Néanmoins , lors de la colonisation de nouvelles cellules saines , cette bactérie peut se retrouver à l' extérieur des cellules , alors elle doit adresser ces facteurs de virulence à la surface externe des cellules hôtes pour se faire phagocyter . Donc , des interactions avec le cytosquelette sont probables d' autant plus que certaines de nos observations effectuées par ailleurs les suspectent . A ce titre , la vinculine pourrait être une des protéines cible . Les calponines constituent une famille de protéines , dépendantes du calcium , qui se lient aussi bien à l' actine monomérique ( actine G ) qu' aux filaments d' actines ( actine F ) mais également à la tropomyosine dans les muscles . Dans les autres tissus , la calponine est dite acide et n' est pas dépendante du calcium . Quelque soit sa forme et sa localisation tissulaire , elle intervient dans l' organisation du cytosquelette des cellules . La tropomyosine est une protéine associée au cytosquelette des cellules musculaires qui permet la liaison entre les fibres d' actines et les fibres de myosines . Chez les crustacés , la tropomyosine est un allergène qui , jusqu'à présent , a été uniquement trouvé dans les muscles . Il est alors surprenant d' identifier cette protéine dans les hémocytes d' Armadillidium vulgare puisque ces cellules ne sont pas musculaires et ne sont donc pas constituées de tropomyosine . Il est peu probable que des cellules musculaires aient été prélevées en même temps que l' hémolymphe et aient contaminé les échantillons . D' autant plus que cette protéine a été retrouvée systématiquement dans tous les gels qui ont été analysés . Des analyses plus complètes de cette protéine , notamment au niveau de sa transcription ( par northern blot ) permettrait de confirmer sa présence dans les hémocytes ou de mettre en évidence une contamination insoupçonnée des protéines hémocytaires par des protéines musculaires . Les cyclophilines sont des peptidyl-prolyl cis / trans isomérases , qui peuvent être ou non cytosoliques . La cyclophiline A ( cytosolique ) se lie aux cyclosporines A munosuppressives ( Fischer et al. , 1989 ) pour former un complexe qui supprime les réactions immunitaires en inhibant une sérine protéase : la calcineurine ( Liu et al. , 1991 ) . La cyclophiline B présente les mêmes propriétés enzymatiques que la précédente . Elle se trouve principalement dans le réticulum endoplasmique où elle est impliquée dans les processus de sécrétion des protéines ( Galat , 1993 ) . Une cyclophiline G , isolée chez la limule ( chélicérates ) ( Takaki et al. , 1997 ) , est présente dans les granules L , un des deux types de granules sécrétoires des hémocytes . Ces granules sont fonctionnellement proches de ceux observés dans les hémocytes granulaires de crustacés . De la même manière , ils comportent de nombreuses protéines impliquées dans les réactions de défense , telles que les facteurs de coagulation , les lectines et les peptides antibactériens ( Seki et al. , 1994 ; Muta et Iwanaga , 1996 ) . De part son activité cis / trans isomérase , cette protéine a un rôle dans le maintien de conformation appropriée de certaines protéines telles que les protéines de coagulation . Les cyclophilines étant aussi généralement des protéines chaperonnes , Takaki et collaborateurs ( 1997 ) proposent que la cyclophiline G agisse également sur le repliement des protéines ; cette protéine serait donc impliquée dans le contrôle de la qualité du stockage des protéines . Le mécanisme de stockage des protéines hémocytaires de la limule pourrait être semblable à celui des crustacés et ainsi , la présence d' une cyclophiline G dans les hémocytes d' Armadillidium vulgare suggère une fonction équivalente : éviter la dégradation des protéines intragranulaires . Une immunolocalisation de cette protéine serait alors nécessaire pour lui attribuer cette fonction . Protéines de réponse au stress : Les heat shock protéines sont les protéines chaperonnes intracellulaires les plus conservées , au niveau structural et fonctionnel , elles constituent plusieurs superfamilles multigéniques . Elles sont présentes dans tous les compartiments cellulaires ( noyau , mitochondries , réticulum endoplasmique , cytosol ) de toutes les cellules depuis les procaryotes jusqu'aux eucaryotes . Les fonctions attribuées à ces heat shock protéines sont : - Prévenir l' agrégation des protéines lors d' un stress physique . - Servir de chaperonne lors du transport des protéines entre les différents organites . - Contribuer au repliement des protéines natives . - Agir dans les processus immunologiques ( innés et acquise ) ( Robert , 2003 ) . L' analyse des protéines hémocytaires a permis de mettre en évidence deux types de Heat Shock protéines , appartenant à deux familles ( la nomenclature de ces protéines est basée sur leur masse moléculaire apparente ) : la famille des hsp 70 ( cytosolique ) et celle des hsp 90 ( gp 96 , réticulum endoplasmique ) . Les hsp 70 ne sont pas exprimées dans tous les tissus et sont hautement inductibles lors de stress ( Robert 2003 , pour revue ) . Dans le réticulum endoplasmique gp 96 est la protéine la plus abondante ( Koch et al. , 1986 ) . C' est une glycoprotéine dépendante du calcium qui peut former des oligomères pour s' associer à de nombreuses protéines telles que les protéines kinases , la calréticuline ou le grp 78 . Chez les mammifères , les hsp sont impliquées dans la réponse médiée par les macrophages et les lymphocytes T ( Robert 2003 , pour revue ) . Réponse immunitaire : Chez Armadillidium vulgare , avant ce travail , aucune molécule du système immunitaire n' était connue . La cartographie bidimensionnelle des protéines hémocytaires a permis d' identifier , par homologie de séquence , toutes les sérines protéases impliquées dans la cascade de mélanisation , différentes protéines d' adhésion / communication cellulaire , mais également des molécules de détoxification . La cascade des sérines protéases de mélanisation est schématisée Figure 43 , p 164 . Lors d' une infection microbienne , les déterminants antigéniques des pathogènes sont reconnus par des protéines de reconnaissance ( & 206;& 134;GBP ou LGBP ) circulantes qui vont activer la voie des sérine protéases au niveau des hémocytes . Une première enzyme , la Pro-prophénoloxydase activating activating enzyme ( pro-ppA ) va être activée sous sa forme prophénoloxydase activating activating factor ( ppA ) par clivage grâce à une sérine protéase du type masquerade-like protéine . Cette ppA alors activée va à son tour cliver la Prophénoloxydase ( ProPO ) pour libérer sa forme active , la phénoloxyase ( PO ) . Cette dernière enzyme catalyse alors , en présence d' O 2 , la transformation des composés phénoliques en quinones , qui vont , par une réaction non enzymatique s' associer et former la mélanine ( pigments noirs ) . Toutes les sérines protéases impliquées dans cette cascade ont été identifiées sur les gels d' électrophorèse bidimensionnelle . Par contre l' analyse des microséquences ne nous a pas permis d' établir la présence de la ProPO . Cette analyse des spot a uniquement révélé la présence de microséquences ayant des homologies avec les séquences de l' hémocyanine de plusieurs espèces de décapodes . Comme nous l' avons déjà signalé , l' hémocyanine et la ProPO présentent de nombreuses homologies de séquence ( Annexe III ) . Les microséquences obtenues peuvent correspondre à des séquences communes à l' hémocyanine et aux ProPO , nous pouvons donc supposer que les microséquences obtenues correspondent à la ProPO . Cependant , une contamination des protéines hémocytaires de l' échantillon par l' hémocyanine plasmatique n' est pas possible à exclure malgré le lavage des hémocytes avant l' extraction des protéines . D' autre part , une protéine inhibitrice des sérines protéases a été identifiée , il s' agit d' une & 206;& 133; 2- macroglobuline . Cette protéine est membre de la famille des & 206;& 133; 2 - macroglobulines , qui inclut de nombreux inhibiteurs de protéases mais aussi les protéines C3 , C4 et C5 du système du complément ( Armstrong et Quigley , 1999 ) . Cette protéine , isolée chez toutes les classes de vertébrés et chez de nombreux invertébrés , présente un large spectre de liaison aux protéases , qui permet l' élimination des protéases circulantes dans le plasma ( Melchior et al. , 1995 ) . Chez les crustacés , différentes & 206;& 133; 2- macroglobulines ont été isolées et caractérisées dans les hémocytes ( Spycher et al. , 1987 ; Hergennahn et al. , 1988 ; Stöcker et al. , 1991 ; Gollas- Galvanet al. , 2003 ; Rattanachaiet al. , 2004 ) et de plus , il a été montré qu' elles ont d' une part une activité contre les pathogènes ( Dieguez-Uribeondo et Cerenius , 1998 ) et que d' autre part elles sont nécessaires à l' activation du système ProPO ( Aspan et al. , 1990 ; Lee et Söderhäll , 2002 ) . De plus , son domaine de liaison riche en glycine et localisé dans sa partie C-terminale est capable de se lier à des protéines de surface cellulaire , permettant ainsi les phénomènes d' endocytose médiée par des récepteurs ( Sottrup-Jensen , 1989 ) . Rattanachai etal . ( 2004 ) ont par ailleurs montré que l' expression de l' & 206;& 133; 2- macroglobuline est augmentée lors de l' induction de la réponse immunitaire par des polyglycanes ou du LPS , confirmant l' importance de cette protéine dans la réponse immunitaire . Cette protéine présente donc de nombreux intérêts et nécessitera une attention particulière dans la caractérisation du système immunitaire d' Armadillidium vulgare . Plusieurs péroxinectines ont été identifiés dans les protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare . Les péroxinectines ont été isolées pour la première fois dans les hémocytes de l' écrevisse Pacifastacus leniusculus ( Johanssonet al. , 1995 ) . Cette protéine est une molécule d' adhésion cellulaire qui présente un domaine péroxydasique et un motif de liaison aux intégrines . De nombreux rôles , en plus de son rôle de détoxifiant ( activité péroxydase ) , sont attribués à cette molécule et notamment un rôle d' opsonination ( Thörnqvistet al. , 1994 ) , d' induction de la dégranulation ( Johansson et Söderhäll , 1989 ) et de la phagocytose ( Kobayashi et al. , 1990 ) . De plus , les péroxinectines , liées à une superoxyde dismutase extracellulaire ( EC-SOD ) , peuvent produire des acides hypochloreux , à partir du péroxyde d' hydrogène produit par la EC-SOD , qui agiraient comme un système microbicide lors des attaques bactériennes ( Holmblad et Söderhäll , 1997 ) . Chez les décapodes , deux études ( Johanssonet al. , 1995 ; Sritunyalucksanaet al. , 2001 ) ont montré que l' activité péroxydasique des péroxinectines n' était pas nécessaire à leurs propriétés d' adhésion cellulaire , celles -ci étant démasquées lors de l' activation du système ProPO . Récemment , plusieurs publications relatives aux péroxinectines ont montré d' une part , que ces protéines d' adhésion cellulaire étaient fortement exprimées dans les organes hématopoïétiques ( Söderhället al. , 2003 ) et , d' autre part , leur surexpression dans les cellules semi-granulaires et granulaires lors d' une infection par certains pathogènes ( Liu et al. , 2005 ) . De part ces diverses propriétés , la péroxinectine constitue une des molécules clés de la réponse immunitaire et méritera également une attention particulière principalement lors d' études expérimentales de la phagocytose des microorganismes . La transglutaminase ( TGase ) est une protéine du système de coagulation , qui est localisée dans les hémocytes des crustacés , et plus particulièrement dans les hémocytes hyalins et semi-granulaires ( Aono et Mori , 1996 ) . Les TGases sont des enzymes dépendantes du Ca 2 + capables de former des liaisons covalentes entre des lysines libres et les résidus glutamines de certaines protéines . Lors de l' activation de la réponse immunitaire , ces protéines sont libérées dans le plasma ( en même temps que le système ProPO , les peptides antimicrobiens ... ) . Figure 43 : Schéma du système prophénoloxydase ( ProPO ) et de sa cascade d' activation chez les crustacés ( d' après Cerenius et Söderhäll , 2004 ) . Sont encadrées en rouge , les protéines identifiées dans les hémocytes d' Armadillidium vulgare . Dans le plasma , les TGases sont activées , de manière non enzymatique , par la concentration en Ca 2 + . Elles vont alors lier entre elles les protéines de coagulation synthétisées dans l' hépatopancréas chez les décapodes pour former un caillot ( Kopacek et al. , 1993a ; Hall et al. , 1995 ; Hall et al. , 1999 ) . Il a été montré qu' une protéine apparentée à la vitellogénine , présente aussi bien chez les mâles que les femelles joue ce rôle de facteur de coagulation ( Hallet al. , 1999 ) . Cependant , de par leurs fonctions très différentes et la production constitutive de la protéine de coagulation , cette dernière n' est pas considérée comme une véritable vitellogénine . Le phénomène de coagulation est très important pour préserver l' homéostasie de l' animal . En effet , il permet de combler les brèches du tégument limitant ainsi les hémorragies mais aussi , par des réactions extrêmement ciblées , la gélification localisée de l' hémolymphe entraînant l' immobilisation des microorganismes . La cascade aboutissant à la coagulation ainsi que celle conduisant à la production de mélanine sont des phénomènes coopératifs si l' on considère la guérison des blessures mais également des infections microbiennes . L' isolement de ces facteurs de coagulation devra donc être entrepris chez Armadillidium vulgare au niveau des caecums digestifs , tissu équivalent de l' hépatopancréas des décapodes . Une dernière protéine d' intérêt , la calréticuline ( CRT ) est présente dans les hémocytes d' Armadillidium vulgare . La CRT est une protéine ubiquitaire dépendante du Ca 2 + , qui possède des propriétés multifonctionnelles . A l' origine , cette protéine a été identifiée comme une protéine chaperonne associée au réticulum endoplasmique ( Michalaket al. , 1992 ) . Depuis , cette protéine a été isolée chez différentes espèces animales et végétales et dans différents tissus . Il apparaît que les CRT peuvent être subdivisées en trois domaines dont chacun possède une fonction particulière : la partie N-terminale , la région centrale riche en proline et la partie C-terminale ( Nakhasiet al. , 1998 , pour revue ) . La partie N-terminale est impliquée dans les interactions protéines-protéines , la liaison aux métaux et à l' ARN . Le domaine riche en proline , abritant le site de liaison au Ca 2 + , présente des fonctions de chaperonne et de liaisons aux lectines . Contrairement au deux première régions identifiées , la partie C-terminale est très peu conservée d' une CRT à l' autre . La CRT est impliquée dans la régulation de l' adhésion cellulaire ( Malhotra et al. , 1993 ) , l' élimination des cellules apoptotiques ( Ogden et al. , 2001 ) , et il a été montré que les capsules formées par les larves de Galleria mellonella mellonella en sont enrichies ( Choi et al. , 2002 ) . Récemment , Asgari et collaborateurs ont montré que la CRT est impliquée dans la phagocytose des corps étrangers chez certains insectes ( Asgari et Schmidt , 2003 ) . La CRT est donc impliquée dans le système immunitaire et plus particulièrement dans la réponse cellulaire . La caractérisation moléculaire et fonctionnelle de cette protéine pourrait nous permettre de compléter l' étude des modifications probables du cytosquelette lors des infections d' Armadillidium vulgare par Wolbachia . Des molécules de détoxification ont également été mises en évidence dans les hémocytes de notre modèle d' étude , notamment une catalase , dont le rôle est proche de celui des péroxydases ( également présente ) , une SOD cytosolique dépendante du manganèse et une glutathion S transférase . Ces enzymes se retrouvent dans toutes le cellules , permettant leur détoxification . Enfin , deux protéines ont été identifiées comme des protéines d' Armadillidium vulgare déjà connues , il s' agit de deux facteurs d' élongation de type 1 et 2 . Ces deux facteurs participent à l' élongation de la chaîne protéique chez la majorité des eucaryotes . 1.2 . Identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia . Pour cette expérience , les protéines des hémocytes de 50 animaux infectés ou non par Wolbachia ont été extraites et soumises à une isofocalisation puis à une électrophorèse sur gel d' acrylamide ( 12 , 5 % ) . Les gels obtenus sont présentés Figure 44 , p 170 et 45 , p 171 . Les spots prélevés correspondent d' une part à des protéines représentées sur les deux gels et , d' autre part , à des protéines n' apparaissant que sur un des deux gels . En effet , la comparaison des deux cartes bidimensionnelles d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia montre que certains spots présentent un différentiel d' expression protéique . Pour plus de facilité , le résultat de cette analyse différentielle est synthétisée sur la Figure 46 , p 172 . Ainsi , certaines protéines semblent moins exprimées chez les animaux porteurs de la bactérie , le spot correspondant à l' actine en est le meilleur exemple . Parmi ces protéines sous exprimées ( entourées en bleu , Figure 46 , p 172 ) , différentes protéines du cytosquelette ( actine , tubuline ) ainsi que certaines de leur protéines associées ( profiline , calponine ) sont retrouvées . D' autres protéines semblent également être moins exprimées , c' est le cas des facteurs d' élongation , des Heat shock protéines , des arginines kinases mais aussi de certaines protéines non identifiées . Par contre , certaines protéines semblent surexprimées chez les animaux infectés par Wolbachia la NADP pyruvate kinase , l' UDP glycosyl transferase et les cathepsines D lysosomales présentent des spots plus intenses que ceux des animaux non infectés . Enfin , huit protéines identifiées et trois protéines inconnues semblent être exprimées en quantité équivalente chez les animaux infectés ou non par Wolbachia . Ces protéines correspondent à la péroxinectine , à une transkétolase , à l' énolase , à la calréticuline , à la vinculine , à la 14 - 3-3 zêta protéine , à la tyrosine 3 monooxygénase et à la tropomyosine . Ainsi , après comparaison des deux gels , il semble que le cytosquelette des hémocytes d' Armadillidium vulgareporteurs deWolbachia soit déstabilisé par une diminution quantitative de ses protéines spécifiques ( actine , tubuline , profiline , calponine ) . D' autre part , l' elongation facteur 1 , protéine responsable de l' élongation des protéines lors de leur synthèse apparaît également fortement diminuée . Par contre , certaines protéines du système immunitaire paraissent affectées de façons diverses au niveau de leur expression . Ainsi , le taux de ProPO semble augmenter bien que paradoxalement , la quantité de ppA , enzyme qui permet son activation ( par clivage ) , semble diminuer . Les péroxinectines et les transglutaminases sont présentes en quantité équivalente chez les deux types d' animaux . Bien évidemment , ces résultats nécessitent d' être confirmés , puisque le gel correspondant aux protéines hémocytaires des animaux infectés par Wolbachia n' a été réalisé que deux fois . Quoiqu' il en soit , ces premiers résultats sont en accord avec les observations faites en microscopie électronique , pour lesquelles une déstabilisation du cytosquelette a été soupçonnée . Pour compléter ces analyses d' expression protéiques , une étude quantitative de l' expression de ces protéines pourra être envisagée . La comparaison de l' expression des protéines du cytosquelette , entre les animaux infectés ou non par Wolbachia , par PCR quantitative en temps réel nous permettra de savoir si Wolbachia a une influence directe sur la transcription de ces gènes ou bien si son intervention est plus tardive . Figure 44 : Analyse par électrophorèse bidimensionnelle des protéines cytosoliques des hémocytes de femelles d' Armadillidium vulgare non infectées . Les ronds et carrés rouges indiquent des protéines ne présentant pas la même expression chez les animaux infectés par Wolbachia ( Figure 45 ) . MM : masse moléculaire . NL : strip non linéaire . Figure 45 : Analyse par électrophorèse bidimensionnelle des protéines cytosoliques des hémocytes de femelles d' Armadillidium vulgare infectées par Wolbachia . Les ronds rouges indiquent des protéines uniquement identifiées chez les animaux infectés par Wolbachia . MM : Figure 46 : Analyse différentielle entre les protéines cytosoliques des hémocytes des femelles d' Armadillidium vulgare non infectées et celles des femelles d' Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia . Les ronds bleus correspondent aux protéines sous exprimées chez les animaux infectés par Wolbachia . Le rectangle et les ronds verts indiquent les protéines surexprimées chez les animaux infectés par Wolbachia . Les carrés et les ronds correspondent aux protéines exprimées en quantité équivalente chez les deux types d' animaux . Les ronds rouges indiquent les protéines uniquement identifiées chez les animaux infectés par Wolbachia . MM : masse moléculaire . NL : srip non linéaire . Enfin , chez les animaux porteurs de Wolbachia , ces bactéries sont présentes dans les hémocytes et bien que leur charge par cellule soit généralement faible , nous devions retrouver des protéines de la bactéries , non présentes chez les animaux sains , sur nos gels d' électrophorèse bidimensionnelle . L' analyse des spots a montré la présence de trois protéines bactériennes un ABC transporteur ATP-dépendant , une NAD formate déshydrogénase et une protéine Wsp ( pour Wosp : Wolbachia outer surface protein ) . La comparaison des microséquences obtenue dans les banques de données montre des homologies avec la séquence de la protéine WOSP ( une protéine de surface ) de Wolbachia d' Armadillidium vulgare ( wVul ) . Nous avons donc pu mettre en évidence une protéine spécifique de la bactérie , confirmant sa présence dans les hémocytes des animaux infectés . Les deux autres protéines ont été identifiées à partir des séquences de Thermotogamaritima pour l' ABC transporteur ATP-dépendant et à partir de Mycosphaerellagraminicola pour la NADP formate déshydrogénase . Aucune homologie de séquence n' a été trouvée avec des protéines de Wolbachia . Toutefois , bien que le génome de Wolbachia ait été séquencé pour la souche issue de Drosophila mélanogaster ( wMel ) , de nombreuses différences existent entre les génomes des Wolbachia suivant les hôtes dont elles proviennent . Ainsi le génome de wVulprésente une taille estimée à 1 , 76 Mb ( Felix , 2004 ) tandis que celui de wMel est estimé à 1 , 36 Mb ( Sun et al. , 2001 ) . Le séquençage et l' annotation du génome de wVul ( travaux en cours ) devrait nous permettre d' identifier les protéines spécifiques à Wolbachia dans les profils protéiques des animaux infectés par la bactérie . Deux protéines supplémentaires semblent être présentes chez les animaux infectés , l' une d' entre elle n' a pas pu être identifiée par contre l' autre a été identifiée comme une protéine liant le sélénium ( Arabidopsis thaliana ) . De telles protéines ont été caractérisées dans le cerveau de boeuf ( Porat et al. , 2000 ) et dans les hématies des rats- taupes ( Spalax ehrenbergi ) ( Yanget al. , 1998 ) . Chez les bovins , cette protéine est impliquée dans le transport des protéines dans le golgi , tandis que dans les globules rouges des rats-taupes cette protéine doit jouer un rôle dans le stockage et le transport du sélénium vers d' autres tissus . Cette protéine n' a jamais été rapportée chez un crustacé , seule sa caractérisation permettra de lui attribuer une fonction . 1.3 . Identification des protéines plasmatiques d' Armadillidium vulgare Les cartes bidimensionnelles correspondant aux protéines plasmatiques de femelles d' Armadillidium vulgare infectées ou non par Wolbachia sont présentées sur les Figures 47 , p 175 et 48 , p 176 . Ces deux profils d' expression protéique sont très semblables et aucune différence majeure n' est évidente . Une cinquantaine de spots , pour la plupart communs aux deux gels , ont été analysés . Seulement une dizaine d' entre eux ont pu être identifiés . Dans les deux cas , l' hémocyanine et la vitellogénine sont retrouvées en grande quantité puisque ces deux protéines sont les principales composantes du plasma des femelles ( Figures 47 et 48 , p 176 - 177 ) . Ces protéines sont résolues avec des masses moléculaires différentes , nous obtenons ainsi des protéines natives ( hémocyanine 70 kDa environ , vitellogénine 100 kDa ) mais également des produits de dégradation ( protéines dans le bas du gel ) . Ces dégradations peuvent être en partie attribuées au traitement subit par les protéines plasmatiques lors de leur acidification par HCl . La vitellogénine est une protéine synthétisée dans le tissu adipeux ( Picaud et Souty , 1980 ) , elle est présente en plus grande quantité chez les animaux infectés par Wolbachia . Cette observation est à mettre en relation avec le fait que les ovaires des animaux infectés par Wolbachia sont toujours beaucoup plus gros . Les microséquences qui correspondent à la vitellogénine ne présentent pas d' homologies avec celle d' Armadillidium vulgare qui a été partiellement caractérisée ( Okuno et al. , 2000 ) . Comme nous l' avons vu précédemment , chez les crustacés décapodes , les facteurs de coagulation sont proches des vitellogénines ( Hall et al. , 1999 ) . Leur étude pourrait permettre de mettre en évidence des facteurs de coagulation mais également de vérifier que la vitellogénine en plus grande quantité chez les animaux infectés par Wolbachia correspond bien à la protéine , responsable de la maturation des ovocytes . Figure 47 : Analyse par électrophorèse bidimensionnelle des protéines plasmatiques , après traitement àHCl 0 , 1 M , des femelles d' Armadillidium vulgare non infectées . Les protéines entourées d' un rond vert ont été prélevées et analysées en spectrométrie de masse ( Q-TOF ) après coupure trypsique . Les protéines identifiées sont indiquées en vert . Les rectangles verts correspondent aux protéines identiques . MM : masse moléculaire . NL : strip non linéaire . Figure 48 : Analyse par électrophorèse bidimensionnelle des protéines plasmatiques , traitées par HCl 0 , 1 M , de femelles d' Armadillidium vulgare infectées par Wolbachia . Les protéines entourées d' un rond vert ont été prélevées et analysées en spectrométrie de masse ( Q-TOF ) après coupure trypsique . Les protéines identifiées sont indiquées en vert . Les rectangles verts correspondent aux protéines identiques . MM : masse moléculaire . NL : strip non linéaire . Trois enzymes ont été également identifiées : une aldéhyde déshydrogénase , une phosphogluconate déshydrogénase et une & 206;& 134;-fibrinogénase , qui a retenu notre attention . La & 206;& 134;-fibrinogénase est une enzyme isolée dans le venin de serpent ( Zhang et al. , 1995 ; Guo et al. , 2001 ) . Cette enzyme , apparentée aux thrombines , modifie les processus de coagulation du sang . La présence d' une telle molécule chez les crustacés n' a jamais été rapportée . Toutefois , on peut supposer qu' elle agit comme une enzyme de prévention de la coagulation de l' hémolymphe . D' autres protéines présentant des propriétés anticoagulantes ont été découvertes ces dernières années chez différents invertébrés . Ainsi , l' étude comparative des génomes de Drosophila melanogaster et d' Anopheles gambiae a montré que ces deux insectes possèdent des facteurs anticoagulants . Toutefois , ces gènes sont beaucoup plus nombreux chez le moustique que chez la drosophile ( 58 contre 13 ) , cette différence est probablement due au fait que les anti-coagulants de moustiques servent pour limiter la coagulation de leur repas de sang ( Zdobnov et al. , 2002 ) . Chez la sangsue Theromyson tessulatum , un inhibiteur du facteur Xa de coagulation a été isolé et caractérisé dans les glandes salivaires . Cette protéine permettrait de limiter la coagulation du sang lors de son aspiration mais également agirait au niveau de son stockage ( Chopin et al. , 2000 ) . Une étude plus approfondie de cette & 206;& 134;-fibrinogénase mériterait d' être poursuivie quand on connaît les implications cliniques que les thrombines peuvent avoir . En effet , les enzymes fibrinolytiques pourraient être utilisées en thérapies clinique pour la prévention de la formation des thromboses ( Willies et al. , 1989 ) . III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES Cette étude d' identification des protéines hémocytaires et plasmatiques par la technique d' electrophorèse bidimensionnelle est la première qui ait été réalisée chez un crustacé . Elle nous a donc permis de mettre en évidence chez Armadillidiumvulgare de nombreuses protéines impliquées dans le système immunitaire , notamment toutes les enzymes de la cascade de mélanisation , mais également d' autres protéines telles que les transglutaminases , les & 206;& 133; 2- macroglobulines ou les péroxynectines . Toutes ces protéines ont été identifiées par homologie de leurs microséquences avec les protéines connues chez d' autres invertébrés , et devront être caractérisées . Pour ce faire , des amorces seront déterminées à partir de ces microséquences puis utilisées pour amplifier par RT-PCR les ADNc correspondant à ces protéines d' intérêt . Après vérification des séquences nucléotidiques et des séquences protéiques déduites , les amplifiats obtenus pourront servir de sondes pour cribler la banque d' ADNc d' hémocytes que nous avons construite . La caractérisation des différentes protéines du système immunitaire mais également du cytosquelette nous permettra d' appréhender par quel mécanismes Wolbachia parvient à pénétrer dans la cellule hôte tout en échappant au système immunitaire . Les différences d' expression des protéines hémocytaires et plasmatiques des animaux sains et infectés pourraient être déterminées en PCR quantitative , et donneraient ainsi un aspect tangible à la « course aux armements » entre hôtes et parasites . A ce titre , le rôle des messagers hormonaux ( opiacés , amines ) , rencontrés dans le système nerveux central , sur la modulation de la réponse immunitaire pourra être envisagé , d' autant que certains parasites ( éloignés de Wolbachia ) utilisent ce type de médiateurs pour détourner le système immunitaire de leurs hôtes ( Capron , 1985 ) . Par injections de molécules correspondant à des déterminants de bactéries Gram ( - ) ( LPS ) ou de champignons ( Laminarine ) , nous pourrons induire des réponses immunitaires adaptées principalement au niveau humoral . L' analyse de ces réponses en fonction du temps devrait matérialiser les conséquences ( au niveau protéique ) de la dégranulation hémocytaire provoquée , phénomène illustré par nos observations en microscopie électronique sur la perte de densité de la matrice granulaire . Conclusion Générale CONCLUSION GENERALE Ce travail a donné une trame au champ des effecteurs impliqués dans la réponse immunitaire chez un crustacé isopode terrestre ( Armadillidium vulgare ) qui peut par ailleurs héberger naturellement une bactérie endocellulaire , Wolbachia . Cette étude apporte d' une part la première caractérisation de plusieurs molécules impliquées dans la réponse immunitaire et d' autre part , elle complète nos connaissances sur l' aspect cellulaire de la réponse innée . Sur des critères de cytologie ultrastructurale , nous avons confirmé la présence de trois types hémocytaires chez Armadillidium vulgare . Ces hémocytes se différencient et subissent une maturation dans les organes hématopoïétiques . Si les différents aspects de la réponse cellulaire peuvent être partagés à des degrés divers par au moins deux types d' hémocytes , notre étude sur la réponse humorale n' apporte pas de données irréfutables quant à la spécialisation fonctionnelle des types hémocytaires ; en conséquence , une localisation précise des marqueurs potentiels ( déterminés notamment lors de l' étude en électrophorèse 2-D ) devra être entreprise par immunomarquage ou par tri cellulaire . L' analyse par chromatographie haute performance et par clonage moléculaire des peptides contenus dans les hémocytes a conduit à la caractérisation d' une molécule de 5259 Da , dont la séquence riche en glycines comporte une quintuple répétition d' un motif GGGFH ( R / S ) et dont l' activité est principalement dirigée contre les bactéries Gram ( + ) . Ce peptide est synthétisé de façon constitutive . Son lieu de synthèse précis ainsi que son mode de libération ( exocytose ? ) reste à déterminer : cette libération est -elle systémique et continue ou localisée et induite ? L' étude structurale de ce peptide propre au genre Armadillidium permettrait de mieux comprendre son mode d' action . Par un même type d' approche , l' analyse sur les protéines du plasma a démontré le clivage de l' hémocyanine invitro en conditions acides : suite à l' hydrolyse de la partie C-terminale de cette molécule oxyphorique , nous avons isolé un peptide de 24 acides aminés présentant une activité antifongique principalement dirigée contre une souche de Botrytis cinerea . Nos résultats en électrophorèse 2-D accréditent l' hypothèse qu' une cathepsine D lysosomale assurerait ce clivage . Ces résultats ont par ailleurs apporté des données fructueuses qui permettent de comprendre les originalités du modèle au travers un schéma général de l' immunité innée des arthropodes . Ce travail devra être poursuivi ( 1 ) en exploitant la banque d' ADNc d' hémocytes que nous avons construite ( 2 ) par une étude en électrophorèse 2-D qui s' efforcera de mettre en évidence des protéines « up » ou « down » régulées lors d' une induction . Le cytosquelette des hémocytes est une nouvelle cible potentielle des facteurs de virulence de Wolbachia dont on peut envisager la caractérisation par des techniques d' interactions protéines-protéines ; cette bactérie exploite -t-elle une caractéristique particulière du système immunitaire de son hôte ? ou est -elle parfaitement furtive ? Références Bibliographiques REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES A Abel , C. A . , P. A . Campbell , J. VanderWall et A. L. Hartman ( 1984 ) . " Studies on the structure and carbohydrate binding properties of lobster agglutinin 1 ( LAg 1 ) , a sialic acid binding lectin . " Prog . Clin . Biol . Res . 157 : 103 - 114 . Adachi , K. , T. Hirata , T. Nishioka et M. Sakaguchi ( 2003 ) . " Hemocyte components in crustaceans convert hemocyanin into a phenoloxidase-like enzyme . " Comp . biochem . Physiol . [ B ] 134 : 135 - 141 . Ando , K. et S. Natori ( 1988 ) . " Inhibitory effect of sarcotoxin IIA , an antibacterial protein of Sarcophaga peregrina , on growth of Escherichia coli . " J. Biochem . 103 ( 4 ) : 735 - 739 . Aono , H. et K. Mori ( 1996 ) . " Interaction between hemocytes and plasma is necessary for hemolymph coagulation in the spiny lobster , Panulirus japonicus . " Comp . Biochem . Physiol . [ A ] 113 : 301 - 305 . Armstrong , P. B . et J. P. Quigley ( 1999 ) . " Alpha 2 -macroglobulin : an evolutionarily conserved arm of the innate immune system . " Dev . Comp . Immunol . 23 : 375 - 390 . Asgari , S. et O. Schmidt ( 2002 ) . " A coiled-coil region of an insect immune suppressor protein is involved in binding and uptake by hemocytes . " Insect Mol . Biol . 32 : 497 - 504 . Asgari , S. et O. Schmidt ( 2003 ) . " Is cell surface calreticulin involved in phagocytosis by insect hemocytes ? " J. Insect Physiol . 49 : 545 - 550 . Ashida , M. ( 1990 ) . " The prophenoloxidase cascade in insect immunity . " Res . Immunol . 141 : 908 - 910 . Aspan , A . , M. Hall et K. Söderhäll ( 1990 ) . " The effect of endogenous proteinase inhibitors on the prophenoloxidase activating enzyme , a serine proteinase from crayfish haemocytes . " Insect Biochem . 20 : 485 - 492 . B Bachère , E . , Y. Gueguen , M. Gonzalez , J. d . Lorgeril , J. Garnier et B. Romestand ( 2004 ) . " Insight into the anti-microbial defense of marine invertebrates : the penaeid shrimps and the oyster Crassostrea gigas . " Immunol . Rev . 198 : 149 - 168 . Bachère , E . , E . Mialhe , D . Noel , A . Morvan et J. Rodriguez ( 1995 ) . " Knowledge and research prospect in marine molluscs and crustacean immunity . " Aquaculture 132 : 17 - 32 . Bandi , C . , T. J . Anderson , C . Genchi et M. L. Blaxter ( 1998 ) . " Phylogeny of Wolbachia in filarial nematodes . " Proc . R. Soc . Lond . B . Biol . Sci . 265 ( 1413 ) : 2407 - 2413 . Bandi , C . , A. M . Dunn , G. D . Hurst et T. Rigaud ( 2001 ) . " Inherited microorganisms , sexspecific virulence and reproductive parasitism . " Trends Parasitol . 17 ( 2 ) : 88 - 94 . Bandi , C . , J. W . McCall , C . Genchi , S. Corona , L. Venco et L. Sacchi ( 1999 ) . " Effects of tetracycline on the filarial worms Brugia pahangi and Dirofilaria immitis and their bacterial endosymbionts Wolbachia . " Int . J. Parasitol . 29 : 357 - 364 . Barlett , T. C . , B. J . Cuthbertson , E. F . Shepard , R. W . Chapman , P. S . Gross et G. W. Warr ( 2002 ) . " Crustin , homologues of an 11 , 5 kDa antibacterial peptide , from two species of penaeid shrimp , Litopenaeus vannamei and Litopenaeus setifus . " Mar . Biotechnol . 4 : 278 293 . Barracco , L. , B . Duvic et K. Söderhäll ( 1991 ) . " The beta- 1 , 3- glucan-binding protein from the crayfish Pacifastacus leniusculus , when reacted reacted with a beta- 1 , 3- glucan , induces spreading and degranulation of crayfish granular cells . " Cell . Tissue Res . 266 : 491 - 497 . Bauchau , A. G . ( 1980 ) . Crustacean . In Invertebrate Blood Cells . N. A . Ratcliffe and A . F . Rowley . New York , Academic Press : 385 - 420 . Bayne , C. J . ( 1990 ) . " Phagocytosis and non-self recognition in invertebrates . Phagocytosis appears to be an ancient line of defense . " Bioscience 40 : 723 - 731 . Bell , K. L . et V. J. Smith ( 1993 ) . " In vitro superoxide production by hyaline cells of the shore crab Carcinus maenas . " Dev . Comp . Immunol . 17 ( 3 ) : 211 - 219 . Bellamy , W. , M. Takase , K. Yamauchi , H. Wakabayashi , K. Kawase et M. Tomita ( 1992 ) . " Identification of the bactericidal domain of lactoferrin . " Biochim . Biophys . Acta . 1121 ( 1 - 2 ) : 130 - 136 . Boman , H. ( 1995 ) . " Peptide antibiotics and their role in innate immunity . " Ann . Rev . Immunol . 13 : 61 - 92 . Boman , H. G . et H. Steiner ( 1981 ) . " Humorale immunity in Cecropia . " Curr . Op . Microbiol . Immunol . 94 - 95 : 75 - 91 Bothwell , A . , G. Yankopoulos et F. Alt ( 1990 ) . Methods for cloning and analysis of eucaryotic genes . In Methods for cloning and analysis of eucaryotic genes . J. A . Barlett . Boston , Jones and Barlett : 15 - 17 . Bouchon , D . , T. Rigaud et P. Juchault ( 1998 ) . " Evidence for widespead Wolbachia infection in isopod crustaceans : molecular identification and host feminization . " Proc . R. Soc . Lond . B . Biol . Sci . 265 ( 1401 ) : 1081 - 1090 . Boulanger , N. , R. J. L . Munks , J . V . Hamilton , F . Vovelle , R. Brun , M. J . Lehane et P. Bulet ( 2002 ) . " Epithelial Innate Immunity . A novel antimicrobial peptide with antiparasitic activity in the blood-sucking insect Stomoxy calcitrans . " J. Biol . Chem . 277 : 49921 - 49926 . Bourdet-Sicard , R. , M. Rudiger , B. M . Jockusch , P. Gounon , P. Sansonetti et G. T. Nhieu ( 1999 ) . " Binding of the Shigella protein IpaA to vinculin induces F-actin depolymerization . " EMBO J . 18 ( 21 ) : 5853 - 5862 . Bradford , M. M . ( 1976 ) . " A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding . " Anal . Biochem . 72 : 248 254 . Braig , H. R . , W. Zhou , S. L . Dobson et S. L. O'Neill ( 1998 ) . " Cloning and characterization of a gene encoding the major surface protein of the bacterial endosymbiont Wolbachia pipientis . " J. Bacteriol . 180 ( 9 ) : 2373 - 2378 . Breeuwer , J. A . et F. Jacobs ( 1996 ) . " Wolbachia : intracellular manipulators of mite reproduction . " Exp . Appl . Acarol . 20 : 421 - 434 . Broakaert , W. F . , F. R. G . Terras et B . P. A . Cammue ( 1995 ) . " Plant defensins : novel antimicrobial peptides as components of the host defense system . " Plant . Physiol . 108 : 13531358 . Brumell , J. H . et S. Grinstein ( 2003 ) . " Role of lipid-mediated signal transduction in bacterial internalization . " Cell . Microbiol . 5 ( 5 ) : 287 - 297 . Brumell , J. H . et S. Grinstein ( 2004 ) . " Salmonella redirects phagosomal maturation . " Curr . Op . Microbiol . 7 : 78 - 84 . Bulet , P. , M. Charlet et C. Hetru ( 2002 ) . Antibacterial Peptides in Insect Immunity . In Infectious Disease : Innate Immunity . R. A. B . Ezekowitz and J . A . Hoffmann . Totowa NJ , Humana Press Inc . Bulet , P. , C . Hetru , J. L . Dimarcq et D. Hoffmann ( 1999 ) . " Antimicrobial peptides in insects ; structure and function . " Dev . Comp . Immunol . 23 : 329 - 344 . Bulet , P. , R. Stöcklin et L. Menin ( 2004 ) . " Anti-microbial peptides : from invertebrates to vertebrates . " Immunol . Rev . 198 : 169 - 184 . C Capron , A . ( 1995 ) . " Le language moléculaire des parasites . " M / S 11 : 431 - 439 Casteels , P. , C . Ampe , F . Jacobs , M. Vaeck et P. Tempst ( 1989 ) . " Apidaecins : antibacterial peptides from honeybees . " EMBO J . 8 ( 8 ) : 2387 - 2391 . Casteels-Josson , K. , T. Capaci , P. Casteels et P. Tempst ( 1993 ) . " Apidaecin multipeptide precursor structure : a putative mechanism for amplification of the insect antibacterial response . " EMBO J. 12 ( 4 ) : 1569 - 1578 . Cerenius , J. , Z. Liang et B. Duvic ( 1994 ) . " Structure and biological activity of a beta- 1 , 3 glucan binding protein in crustacean blood . " J. Biol . Chem . 269 : 29462 - 29467 . 184 Cerenius , L. et K. Söderhäll ( 2004 ) . " The prophenoloxidase-activating system in invertebrates . " Immunol . Rev . 2004 198 : 116 - 126 . Chanock , S. J . , J. el Benna , R. M . Smith et B. M. Babior ( 1994 ) . " The respiratoty burst oxidase . " J. Biol . Chem . 269 ( 40 ) : 24519 - 24522 . Charlet , M. , C. S . , H. Philippe , C . Hétru , J. A . Hoffmann et P. Bulet ( 1996 ) . " Innate immunity : isolation of several cysteine-rich antimicrobial peptides from the blood of a mollusc Mytilus edulis . " J. Biol . Chem . 271 : 21808 - 21813 . Chen , H. , J. Brown , J. Morell et C. Huang ( 1988 ) . " Synthetic magainin analogues with improved antimicrobial activity . " FEBS Lett . 236 ( 2 ) : 462 - 466 . Cheng , W. , C. H . Liu , C. H . Tsai et J . C . Chen ( 2005 ) . " Molecular cloning and characterization of a pattern recognition molecule , lipopolysaccharide- and beta- 1 , 3- glucan binding protein ( LGBP ) from the white shrimp Litopenaeus vannamei . " Fish Shellfish Immunol . 18 : 297 - 310 . Chisholm , J. R. S . et V. J. Smith ( 1992 ) . " Antibacterial activity in the haemocytes of the shore crab , Carcinus maenas . " J. Mar . Biol . Assoc . UK . 72 : 529 - 542 . Choi , J. Y . , M. M. A . Whitten , M. Y . Cho , K. Y . Lee , M. S . Kim , N. A . Ratcliffe et e . al . ( 2002 ) . " Calreticulin enriched as an early-stage encapsulation protein in wax moth Galleria mellonella larvae . " Dev . Comp . Immunol . 26 : 335 - 343 . Chopin , V. , M. Salzet , J. L . Baert , F . Vandenbulcke , P. E . Sautière , J. P . Kerckaet et J. Malecha ( 2000 ) . " Therostatin , a novel clotting factor Xa inhibitor from the Rhynchobdellid leech , Theromyzon tessulatum . " J. Biol . Chem . 275 : 32701 - 32707 . Christensen , B . , J. Fink , R. B . Merrifield et D. Mauzerall ( 1990 ) . " Antimicrobial defensin peptides form voltage dependent ion-permeable channels in planner lipid bilayer membranes . " Proc . Nat . Acad . Sci . USA 87 : 210 - 214 . Cociancich ( 1991 ) . " DEA Strasbourg . " Cociancich , S. , A . Dupont , G. Hegy , R. Lanot , F . Holder , C . Hetru , J. A . Hoffmann et P. Bulet ( 1994 ) . " Novel inducible antibacterial peptides from a hemipteran insect , the sapsucking bug Pyrrhocoris apterus . " Biochem . J . 300 : 567 - 575 . Combes , C . ( 2001 ) . In Les associés du vivant . Paris , Ed . Flammarion . Corzo , G. , E . Villegas , F . Gomez-Lagunas , L. D . Possani , O. S . Belokoneva et T. Nakajima ( 2002 ) . " Oxyopinins , large amphipathic peptides isolated from the venom of the wolf spider Oxyopes kitabensis with cytolytic properties and positive insecticidal cooperativity with the spider neurotoxins . " J. Biol . Chem . 277 : 23627 - 23637 . Cossart , P. et P. Sansonetti ( 2004 ) . " Bacterial invasion : The paradigms of Enteroinvasive Pathogens . " Science 304 : 242 - 248 . Coutant , M. F . ( 1977 ) . Contribution a l' étude cytologique et fonctionnelle des hémocytes et des organes hématopoïétiques chez l' oniscoïde Porcellio dilatatus , Brandt . Thèse , Université de Poitiers . Cuthbertson , B. J . , E. E . Büllesbach , J. Fievet , E . Bachère et P.S. Gross ( 2004 ) . " A new class ( penaeidin class 4 ) of antimicrobial peptides from the Atlantic white schrimp ( Litopenaeus setiferus ) exhibits target specificity and an independent prolin-rich-domain function . " Biochem . J. 381 : 79 - 86 . Cuthbertson , B. J . , E. F . Shepard , R. W . Chapman et P.S. Gross ( 2002 ) . " Diversity of the penaeidin antimicrobial peptide in two shrimp species . " Immunogenetics 54 : 442 - 445 . D Decker , H. et E. Jaenicke ( 2004 ) . " Recent findings on the phenoloxidase activity and antibacterial activity of hemocyanins . " Dev . Comp . Immunol . 28 : 673 - 687 . Decker , H. , M. Ryan , E . Jaenicke et N. Terwilliger ( 2001 ) . " SDS-induced phenoloxidase activity of hemocyanins from Limulus polyphemus , Eurypelma californicum , and Cancer magister . " J. Biol . Chem . 276 : 17796 - 17799 . Dedeine , F . , F . Vavre , F . Fleury , B . Loppin , M. E. Hochberg et M. Bouletreau ( 2001 ) . " Removing symbiotic Wolbachia bacteria specifically inhibits oogenesis in a parasitic wasp . " Proc . Natl . Acad . Sci . USA 98 ( 11 ) : 6247 - 6252 . Destoumieux , D . , P. Bulet , D . Loew , A . V. Dorsselaer , J. Rodriguez et E. Bachère ( 1997 ) . " Penaeidins , a new family of antimicrobial peptides isolated from the shrimp Penaeus vannamei ( Decapoda ) . " J. Biol . Chem . 272 ( 45 ) : 28398 - 28406 . Destoumieux , D . , P. Bulet , J. Strub , A . V. Dorsselaer et E. Bachère ( 1999 ) . " Recombinant expression and range of activity of penaeidins , antimicrobial peptides from penaeid shrimp . " Eur . J. Biochem . 266 : 335 - 346 . Destoumieux , D . , M. Munoz , P. Bulet et E. Bachère ( 2000 ) . " Penaedins , a family of antimicrobial peptides from penaeid shrimp ( Crustacea , Decapoda ) . " Cell . Mol . Life Sci . 57 : 1260 - 1271 . Destoumieux , D . , M. Munoz , C . Cosseau , J. Rodriguez , P. Bulet , M. Comps et E. Bachère ( 2000 ) . " Penaedins , antimicrobial peptides with chitin-binding activity , are produced and stored in shrimp granulocytes and released after microbial challenge . " J. Cell Sci . 113 : 461 - 469 . Destoumieux-Garzon , D . , D . Saulnier , J. Garnier , C . Jouffrey , P. Bulet et E. Bachère ( 2001 ) . " Antifungal peptides are generated from the C-terminus of shrimp hemocyanin in response to microbial challenge . " J. Biol . Chem . 276 ( 50 ) : 47070 - 47077 . Dieguez-Uribeondo , J. et J. Cerenius ( 1998 ) . " The inhibition of extracellular proteinases from Aphanomyces spp by three different proteinase inhibitors from the crayfish blood . " Mycol . Res . 102 : 820 - 824 . Dimarcq , J . - L . , P. Bulet , C . Hetru et J . A . Hoffmann ( 1998 ) . " Cystein-rich antimicrobial peptides in invertebrates . " Biopolymers 47 : 465 - 477 . Doolittle , R. F . et M. Riley ( 1990 ) . " The amino-terminal sequence of lobster fibrinogen reveals common ancestry with vitellogenins . " Biochem . Biophys . Res . Comm . 167 : 16 - 19 . Duvic , B . et K. Söderhäll ( 1990 ) . " Purification and characterization of a beta- 1 , 3- glucan binding protein from plasma of the crayfish Pacifastacus leniusculus . " J. Biol . Chem . 265 : 9327 - 9332 . Duvic , B . et K. Söderhäll ( 1992 ) . " Purification and partial characterization of a beta- 1 - 3 glucan binding protein membrane receptor from blood cells of the crayfish Pacifastacus leniusculus . " Eur . J. Biochem . 207 : 223 - 228 . Duvic , B . et K. Söderhäll ( 1993 ) . " Beta- 1 - 3- glucan binding proteins from plasma of the freshwater crayfish Astacus astacus and Procambarus clarkii . " J. Crust . Biol . 13 : 403 - 408 . E Ehret-Sabatier , L. , D . Loew , M. Goyffon , P. Fehlbaum , J. A . Hoffmann , A . Van . Dorsselaer et P. Bulet ( 1996 ) . " Characterization of novel cystein-rich antimicrobial peptides from scorpion blood . " J. Biol . Chem . 271 ( 47 ) : 29537 - 29544 . Engström , Y. ( 1998 ) . Insect immune gene regulation . In Molecular Mecanisms of immune Responses in Insects . P. T . Brey and D. Hultmark . London , Chapman Hall : 211 - 244 . F Fehlbaum , P. ( 1996 ) . " Structure-activity analysis of thanatin , a 21- residue inducible insect defense peptide with sequence homology to frog skin antimicrobial peptides . " Proc . Nat . Acad . Sci . USA 93 : 1221 - 1225 . Feinberg , A. P . et B. Volgelstein ( 1983 ) . " A technique for radiolabeling DNA restriction endonuclease fragments to high specific activity . " Anal . Biochem . 132 : 6 - 13 . Felix , C . ( 2004 ) . Etude moléculaire de la bactérie intracellulaire féminisante Wolbachia chez Armadillidium vulgare ( crustacé isopode terrestre ) . Thèse , Université de Poitiers . Felix , C . , P. Grève , C . Braquart-Varnier , H. Braig et G. Martin ( Soumis ) . " Characterization and transcriptional analysis of two gene clusters for a type IV secretion machinery in the feminizing intracellular symbiont Wolbachia . " J. Bacteriol . 187 Fischer , G. , B . Wittmann-Liebold , K. Lang , T. Kiefhaber et F. X. Schmid ( 1989 ) . " Cyclophilin and peptidyl-propyl cis / trans isomerase are probably identical proteins . " Nature 327 ( 6232 ) : 351 - 352 . Fogaça , A. C . , P . I . da Siva , M. T. M . Miranda , A. G . Bianchi , A . Miranda et P . E. M . Ribolla ( 1999 ) . " Antimicrobial activity of a bovine hemoglobin fragment in the tick Bophilus microplus . " J. Biol . Chem . 274 ( 36 ) : 25330 - 25334 . Fuller , G. M . et R . F . Doolittle ( 1971a ) . " Studies of invertebrate fibrinogen . II . Transformation of lobster fibrinogen into fibrin . " Biochem . 10 : 1311 - 1315 . Fuller , G. M . et R . F . Doolittle ( 1971b ) . " Studies of invertebrate fibrinogen . I. Purification and characterization f fibrinogen from the spiny lobster . " Biochem . 10 : 1305 - 1311 . G Galat , A . ( 1993 ) . " Peptidylproline cis / trans isomerases : immunophilins . " Eur . J. Biochem . 216 ( 3 ) : 689 - 707 . Ganz , T. ( 2003 ) . " Defensins : antimicrobial peptides of innate immunity . " Nature Rev . Immunol . 3 : 710 - 720 . Ganz , T. et R. I. Lehrer ( 1997 ) . " Antimicrobial peptides of leukocytes . " Curr . op . hematol . 4 : 53 - 58 . Gargioni , R. et M. A. Barracco ( 1998 ) . " Hemocytes of the Palaemonids Macrobrachium rosenbergii and M. acanthurus and of the Penaeid Penaeus paulensis . " J. Morphol . 236 : 209 221 . Ghiretti-Magaldi , A . , C . Milanese et G. Tognon ( 1977 ) . " Hematopoïesis in crustacean decapoda : origin and evolution of hemocytes and cyanocytes of Carcinus maenas . " Cell Differ . 6 : 167 - 187 . Gillespie , J. P . , M. R . Kanost et T. Trenczek ( 1997 ) . " Biologic mediators of insect immunity . " Annu . Rev . Entomol . 42 : 611 - 643 . Gollas-Galvan , T. , R. R . Sotelo-Mundo , G. Yepiz-Plascencia , C . Vargas-Requena et F. Vargas-Albores ( 2003 ) . " Purification and characterization of alpha 2 -macroglobulin from the white shrimp ( Penaeus vannamei ) . " Comp . Biochem . Physiol . [ C ] 134 : 431 - 438 . Golsteyn , R. M . , M. Arpin , E . Friederich et D. Louvard ( 2000 ) . " Les proteines du cytosquelette d' actine : bien placées pour la motilité . " M / S 16 : 722 - 731 . Gorvel , J. P . et E. Moreno ( 2002 ) . " Brucella intracellular life : from invasin to intracellular replication . " Vet . Microbiol . 90 : 281 - 297 . Gouin , E . , M. D . Welch et P. Cossart ( 2005 ) . " Actin-based motility of intracellular pathogens . " Curr . Opin . Microbiol . 8 : 35 - 45 . Gross , P. S . , T. C . Bartlett , C. L . Browdy , R. W . Chapman et G. W. Warr ( 2001 ) . " Immune gene discovery discovery by expressed sequence tag analysis of hemocytes and hepatopancreas in the pacific white shrimp , Litopenaeus vannamei , and the atlantic white shrimp , Litopenaeus setiferus . " Dev . Comp . Immunol . 25 : 565 - 577 . Guo , Y. W . , T. Y . Chang , K. T . Lin , H. W . Liu , K. C . Shih et S. H. Cheng ( 2001 ) . " Cloning and functional expression of the mucrosobin protein , a beta-fibrinogenase of Trimeresurus mucrosquamatus ( Taiwan Habu ) . " Prot . Express Purif . 23 : 483 - 490 . H Hall , M. , M. C . V. Heusden et K. Söderhäll ( 1995 ) . " Identification of the major lipoproteins in crayfish hemolymph as proteins involved in immune recognition and clotting . " Biochem . Biophys . Res . Comm . 216 ( 3 ) : 939 - 946 . Hall , M. et K. Söderhäll ( 1994 ) . " Crayfish alpha- 2- macroglobulin as a substrate for transglutaminases . " Comp . Biochem . Physiol . [ B ] 108 : 65 - 72 . Hall , M. , R. Wang , R. v . Antwerpen , L. Sottrup-Jensen et K. Söderhäll ( 1999 ) . " The crayfish plasma clotting protein : a vitellogenin-related protein responsible for clot formation in crustacean blood . " Proc . Nat . Acad . Sci . USA 96 : 1965 - 1970 . Hara , S. et M. Yamakawa ( 1995 ) . " A novel antibacterial peptide family isolated from the silkworm , Bombyx mori . " Biochem . J . 310 : 651 - 656 . Hergennahn , H. G . , M. Hall et K. Söderhäll ( 1988 ) . " Purification and characterization of an alpha 2 -macroglobulin-like proteinase inhibitor from plasma of the crayfish Pacifastacus leniusculus . " Biochem . J. 255 : 801 - 806 . Hertig , M. et S . B . Wolbach ( 1924 ) . " Studies on Rickettsia-like micro-organisms in insects . " J. Med . Res . 44 : 329 - 374 . Hétru , C . , P. Bulet , S. Cociancich , J. L . Dimarcq , D . Hoffmann et J . A . Hoffmann ( 1994 ) . In Phylogenic Perspectives in Immunity : The insect Host Defense . J. A . Hoffmann , C . A . Janeway and J. S. Natori , CRC Press , Boca Raton , FL : 43 - 66 . Hétru , C . , D . Hoffmann et P. Bulet ( 1998 ) . Antimicrobial peptides from insects . In Molecular mechanisms in immune responses in insects . P. Brey and D. Hultmark , Chapman Hall . Hétru , C . , L. Troxler et J . A . Hoffmann ( 2003 ) . " Drosophila melanogaster antimicrobial defense . " J. Inf . Diseases 187 ( suppl 2 ) : 327 - 334 . Hoebe , K. , E . Jansen et B. Beutler ( 2004 ) . " The interface between innate and adaptative immunity . " Nat . Immunol . 5 : 971 - 974 . Hoffmann , J. A . et C. Hétru ( 1992 ) . " Insect defensins : inducible antibacterial peptides . " Immunol . Today 13 : 411 - 415 . Hoffmann , J. A . et J. M. Reichhart ( 1997 ) . " Drosophila immunity . " Trends Cell Biol . 7 : 309 - 316 . Holmblad , T. et K. Söderhäll ( 1997 ) . " Cell adhesion molecules and antioxidative enzymes in a crustacean , possible role in immunity . " Aquaculture 172 : 111 - 123 . Hong , R. W . , M. Shchepetov , J. N . Weiser et P. H. Axelsen ( 2003 ) . " Transcriptional profile of the Escherichia coli response to the antimicrobial insect peptide cecropin A. " Antimicrob . Agents . Chemother . 47 : 1 - 6 . Hose , J. E . et G. G. Martin ( 1989 ) . " Defense functions of granulocytes in the Ridgeback prawn Sicyonia ingentis . " J. Invert . Pathol . 53 : 335 - 346 . Hose , J. E . , G. G . Martin et A. S. Gerard ( 1990 ) . " A decapod classification scheme integrating morphology , cytochemistry , and function . " Biol . Bull . 178 : 33 - 45 . Huang , T . - S . , H. Wang , S. Y . Lee , M. W . Johansson , K. Söderhäll et L. Cerenius ( 2000 ) . " A cell adhesion protein from the crayfish Pacifastacus leniusculus , a serine proteinase homologue similar to Drosophila Masquerade . " J. Biol . Chem . 275 ( 14 ) : 9996 - 10001 . Hultmark , D . ( 1993 ) . " Immune reaction in Drosophila and other insects : a model for innate immunity . " Trends Genet . 9 : 178 - 183 . Hultmark , D . ( 1996 ) . " Insect lysozymes . " Exp . Suppl . 75 : 87 - 102 . Hultmark , D . , A . Engstrom , K. Andersson , H. Steiner , H. Bennich et H. G. Boman ( 1983 ) . " Insect immunity . Attacins , a family of antibacterial proteins from Hyalophora cecropia . " EMBO J . 2 ( 4 ) : 571 - 576 . Hurst , G. D . , F. M . Jiggins , J. H. G . von der Schulenberg , D . Bertrand , S. A . West , I. I. Goriacheva , I. A . Zakharov , J. H . Werren , R. Stouthamer et M. E. N. Majerus ( 1999 ) . " Male killing Wolbachia in two species of insect . " Proc . R. Soc . Lond . B . 266 : 735 - 740 . I Iijima , R. , S. Kurata et S. Natori ( 1993 ) . " Purification , characterization , and cDNA cloning of an antifungal protein from the hemolymph of Sarcophaga peregrina ( flesh fly ) larvae . " J. Biol . Chem . 268 : 12055 - 12061 . Inamori , K . I . , S. Ariki et S. I. Kawabata ( 2004 ) . " A Toll-receptor in horseshoe crab . " Immunol . Rev . 198 : 106 - 115 . Ivanov , V. , A. A . Karelin , M. M . Phippova , I. Nazimov et V. Pletnev ( 1997 ) . " Hemoglobin as a source of endogenous bioactive peptides : the concept of tissue-specific pepdide pool . " Biopolymers 43 ( 2 ) : 171 - 188 . Iwanaga , S. ( 2002 ) . " The molecular basis of innate immunity in the horseshoe crab . " Curr . Op . Immunol . 14 : 87 - 95 . Iwanaga , S. et S. I. Kawabata ( 1998 ) . " Evolution and phylogeny of defense molecules associated with innate immunity in horseshoe crab . " Frontiers Bioscience 3 : 973 - 984 . J Jaenicke , E . et H. Decker ( 2003 ) . " Tyrosinases from crustacean form hexamers . " Biochem . J . 371 : 515 - 523 . Jaenicke , E . , R. Föll et H. Decker ( 1999 ) . " Spider hemocyanin binds ecdysone and 20 -OHedysone . " J. Biol . Chem . 274 : 34267 - 34271 . Jaquinod , M. , N. Potier , K. Klarskov , J. M . Reymann , O. Sorokine , S. Kieffer , P. Barth , V. Andriantomanga , J. F . Biellmann et A. Van . Dorsselaer ( 1993 ) . " Sequence of pig lens aldose reductase and electrospray mass spectrometry of non-covalent and covalent complexes . " Eur . J. Biochem . 218 : 893 - 903 . Jeyaprakash , A . et M. A. Hoy ( 2000 ) . " Long PCR improves Wolbachia DNA amplification : wsp sequences found in 76 % of sixty-three arthropod species . " Insect Mol . Biol . 9 ( 4 ) : 393 405 . Jiggins , F. M . , G. D . Hurst et M. E. N. Majerus ( 2000 ) . " Sex ratio-distorting Wolbachia causes sex-role reversal in its butterfly host . " Proc . R. Soc . Lond . B . Biol . Sci . 267 : 69 - 73 . Johansson , M. W . ( 1999 ) . " Cell adhesion molecules in invertebrate immunity . " Dev . Comp . Immunol . 23 : 303 - 315 . Johansson , M. W . , T. Holmblad , P . - O . Thörnqvist , M. Cammarata , N. Parrinello et K. Söderhäll ( 1999 ) . " A cell-surface superoxide dimutase is a binding protein for peroxinectin , a cell-adhesive peroxidase in crayfish . " J. Cell Sci . 112 : 917 - 925 . Johansson , M. W . , P. Keyser et K. Söderhäll ( 1994 ) . " Purification and cDNA cloning of a four-domain Kazal proteinase inhibitor from crayfish blood cells . " Eur . J. Biochem . 233 : 389 394 . Johansson , M. W . , P. Keyser , K. Sritunyalucksana et K. Söderhäll ( 2000 ) . " Crustacean haemocytes and haematopoiesis . " Aquaculture 191 : 45 - 52 . Johansson , M. W . , M. Lind , T. Holmblad , P. O . Thörnqvist et K. Söderhäll ( 1995 ) . " Peroxinectin , a novel cell adhesion protein from crayfish blood . " Biochem . Biophys . Res . Comm . 216 : 1079 - 1087 . Johansson , M. W . et K. Söderhäll ( 1985 ) . " Exocytosis of the prophenoloxidase activating system from crayfish haemocytes . " J. Comp . Physiol . 156 : 175 - 181 . Johansson , M. W . et K. Söderhäll ( 1988 ) . " Isolation and purification of a cell adhesion factor from crayfish blood cells . " J. Cell Biol . 106 : 1795 - 1803 . Johansson , M. W . et K. Söderhäll ( 1989 ) . " Cellular immunity in crustaceans and the ProPO system . " Parasitol . Today 5 : 481 - 484 . Johnson , P. T . ( 1980 ) . In Histology of the blue crab , Callactinectes sapidus : a model for the Decapoda . New York , Praeger Scientific . Juchault , P. ( 1966 ) . Contribution à l' étude de la différentiation sexuelle mâle chez les crustacés isopodes . Thèse , Université de Poitiers . Juchault , P. , M. Frelon , D . Bouchon et T. Rigaud ( 1994 ) . " New evidence for feminizing bacteria in terrestrial isopods : evolutionary implications . " C.R. Acad . Sci . Paris . 317 : 225 230 . Juchault , P. , J. J . Legrand et G. Martin ( 1974 ) . " Action interspécifique du facteur épigénétique féminisant responsable de la thélygénie et de l' intersexualité du crustacé Armadillidium vulgare ( Isopode oniscoïde ) . " Ann . Embryo . Morpho . 7 ( 3 ) : 265 - 276 . Jung , Y. , B . Park , D . Lee , Y. Hahn , J. Chung , D . Man , H. Moon , B . Lee et Y. Lee ( 1996 ) . " Biochemical and molecular characterization of an antifungal protein from Tenebrio molitor larvae . " Mol . Cell . 5 : 287 - 292 . K Kang , C . , J. Wang , X. Zhao , X. Yang , H. Shao et J. Xiang ( 2004 ) . " Molecular cloning and expression analysis of Ch-penaeidin , an antibacterial peptide from the Chinese shrimp , Fenneropenaeus chinensis . " Fish Shellfish Immunol . 16 : 513 - 525 . Katsu , T. , S. Nakao et S. Iwanaga ( 1993 ) . " Mode of action of an antimicrobial peptide , tachyplesin I , on biomembranes . " Biol . Pharm . Bull . 16 ( 2 ) : 178 - 181 . Kawabata , S. , T. Osaki et S. Iwanaga ( 2003 ) . Innate immunity in horseshoe crabs . In Infectious disease : Innate Immunity . R. A . Ezekowitz and J . A . Hoffmann . Totowa , NJ , Humana Press . Kawabata , S . I . et R. Tsuda ( 2002 ) . " Molecular basis of non self recognition by the horseshoe crab tachylectins . " Biochem . Biophys . Acta . 1572 : 414 - 421 . Kellenberger , C . , C . Bourdier , I. Bermudez , J. Bieth , B . Luu et H. Hietter ( 1995 ) . " Serine protease inhibition by insect peptides containing a cysteine knot and a triple-stranded betasheet . " J. Biol . Chem . 270 : 25514 - 25519 . Khoo , L. , D. W . Robinette et E. J. Noga ( 1999 ) . " Callinectin , an antibacterial peptide from blue crab , Callinectes sapidus , hemocytes . " Mar . Biotechnol . 1 : 44 - 51 . Kobayashi , M. , M. W . Johansson et K. Söderhäll ( 1990 ) . " The 76 kDa cell-adhesion factor from crayfish haemocytes promotes encapsulation in vitro . " Cell Tissue Res . 260 : 13 - 18 . Koch , G. , M. Smith , D . Macer , P. Webster et R. Mortara ( 1986 ) . " Endoplasmic reticulum contains a common , abundant calcium-binding glycoprotein endoplasmin . " J. Cell Sci . 86 : 217 - 232 . Komastu , M. et S. Ando ( 1998 ) . " A very high density lipoprotein with clotting ability from hemolymph of sand crayfish , Ibacus ciliatus . " Biosci . Biotechnol . Biochem . 62 : 459 - 463 . Kopacek , P. , M. Hall et K. Söderhäll ( 1993a ) . " Characterization of a clotting protein , isolated from plasma of the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus . " Eur . J. Biochem 213 ( 1 ) : 591 - 597 . Kopacek , P. , M. Hall et K. Söderhäll ( 1993b ) . " Isolation and characterization of a hemagglutinin with affinity for lipopolysaccharides from plasma of the crayfish Pacifastacus leniusculus . " Dev . Comp . Immunol . 17 ( 5 ) : 407 - 418 . Kragol , G. , S. Lovas , G. Varadi , B. A . Condie , R. Hoffmann et L. Otvos ( 2001 ) . " The antibacterial peptide pyrrhocoricin inhibits the ATPase actions of DnaK and prevents chaperone-assisted protein folding . " Biochem . 40 : 3016 - 3026 . Krishnakumari , V . et R. Nagaraj ( 1997 ) . " Antimicrobial and hemolytic activities of crabrolin , a 13- residue peptide from the venom of the European hornet , Vespa crabo , and its analogs . " J. Pept . Res . 50 : 88 - 93 . Kuhn-Nentwig , L. , J. Muller , J. Schaller , A . Walz , M. Dathe et W. Nentwig ( 2002 ) . " Cupiennin 1 , a new family of highly basic antimicrobial peptides in the venom of the spider Cupiennius salei ( Ctenidae ) . " J. Biol . Chem . 277 : 11208 - 11216 . L Laemmli , U. K . ( 1970 ) . " Cleavage of the structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4 . " Nature 227 ( 259 ) : 680 - 685 . Lamberty , M. , D . Zachary , R. Lanot , C . Bordereau , A . Robert , J. A . Hoffmann et P. Bulet ( 2001 ) . " Constitutive expression of a cystein-rich antifungal and linear antibacterial peptide in a termite insect . " J. Biol . Chem . 276 : 4085 - 4092 . Langworthy , N. G . , A . Renz , U. Mackenstedt , K. Henkle-Duhrsen , M. B . de Bronsvoort , V. N . Tanya , M. J . Donnelly et A. J. Trees ( 2000 ) . " Macrofilaricidal activity of tetracycline against the filarial nematode Onchocerca ochengi : elimination of Wolbachia precedes worm death and suggests a dependent relationship . " Proc . R. Soc . Lond . B . Biol . Sci . 267 : 10631069 . Lanz , H. , V. Tzutzumi et H. Arechiga ( 1993 ) . " Morphological and biochemical characterization of Procambarus clarkii blood cells . " Dev . Comp . Immunol . 17 : 389 - 397 . Lavine , M. D . et M. R. Strand ( 2002 ) . " Insect hemocytes and their role in immunity . " Insect Biochem . Mol . Biol . 32 ( 10 ) : 1295 - 1309 . Lee , S. , B . Lee et K. Söderhäll ( 2003 ) . " Processing of an antibacterial peptide from hemocyanin of the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus . " J. Biol . Chem . 278 ( 10 ) : 7927 - 7933 . Lee , S. , B . Lee et K. Söderhäll ( 2004 ) . " Processing of crayfish hemocyanin subunits into phenoloxidase . " Biochem . Biophys . Res . Comm . 322 : 490 - 496 . Lee , S. , H. Moon , S. Kurata , S. Natori et B. Lee ( 1995 ) . " Purification and cDNA cloning of an antifungal protein from the hemolymph of Holotrichia diomphalia larvae . " Biol . Pharm . Bull . 18 : 1049 - 1052 . Lee , S.Y . et D.H. Kim , J.Y . Suh , J.H . Chung , B.L . Lee , Y. Lee et B.S. Choi ( 1999 ) . " Structural characteristics of tenecin 3 , an insect antifungal protein . " Biochem . Mol . Biol . Int . 47 ( 3 ) : 369 - 376 . Lee , S. Y . et K. Söderhäll ( 2001 ) . " Characterization of a pattern recognition protein , a masquerade-like protein , in the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus . " J. Immunol . 166 ( 12 ) : 7319 - 7326 . Lee , S. Y . et K. Söderhäll ( 2002 ) . " Early events in crustacean innate immunity . " Fish Shellfish Immunol . 12 : 421 - 437 . Lee , S. Y . , R. Wang et K. Söderhäll ( 2000 ) . " A lipopolysaccharide and beta- 1 - 3- glucan binding protein from hemocytes of the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus : purification , caracterization and cDNA cloning . " J. Biol . Chem . 275 : 1337 - 1343 . Lefebvre , C . , A . Tasiemski et M. Salzet ( 2000 ) . " Peptides opioïdes , substances opiacées et réponse immunitaire . " M / S 16 : 235 - 242 . Legrand , J. J . et P. Juchault ( 1970 ) . " Experimental modification of sex-ratio in terrestrial crustacea isopoda : induction of thelygeny in Armadillidium vulgare Latr . " C.R. Acad . Sci . Hebd . Seances Acad . Sci . D 207 : 706 - 708 . Legrand , J. J . et P. Juchault ( 1986 ) . " Rôle des bactéries symbiotiques dans l' intersexualité , la monogénie et la spéciation chez les crustacés oniscoïdes . " Bull . Zool . 53 . Lehrer , R . I . ( 2004 ) . " Primate defensins . " Nature Rev . Immunol . 2 : 727 - 732 . Levashina , E. A . , S. Ohresser , P. Bulet , J. M . Reichhart , C . Hetru et J . A . Hoffmann ( 1995 ) . " Metchnikowin , a novel immune-inductible proline-rich proline-rich peptide from Drosophila with antibacterial and antifungal properties . " J. Biochem . 233 ( 2 ) : 694 - 700 . Liang , Z. et K. Söderhäll ( 1995 ) . " cDNA cloning of a serpin from crayfish blood cells . " Comp . Biochem . Physiol . [ B ] 112 : 385 - 391 . Liang , Z. , L. Sottrup-Jensen , A . Aspan , M. Hall et K. Söderhäll ( 1997 ) . " Pacifastin , a novel 155 kDa heterodimeric proteinase inhibitor containing a unique transferrin domain . " Proc . Nat . Acad . Sci . USA 94 : 6682 - 6687 . Liu , C. H . , W. Cheng et J . C . Chen ( 2005 ) . " The peroxinectin of white schrimp Litopenaeus vannamei is synthesised in the semi-granular and granular cells , and its transcription is upregulated with Vibrio alginolyticus infection . " Fish Shellfish Immunol . 18 : 431 - 444 . Liu , J. , J. D . Farmer , W. S . Lane , J. Friedman , I. Weissman et S. L. Schreiber ( 1991 ) . " Calcineurin is a common target of cyclophilin-cyclosporin A and FKBP-FK506 complexes . " Cell 66 ( 4 ) : 807 - 815 . Lodge , R. et A. Descoteaux ( 2005 ) . " Modulation of phagolysosome biogenesis by the lipophosphoglycan of Leishmania . " Clinical . Immunol . 114 : 256 - 265 . Loisel , T. P . , R. Boujemaa , D . Pantaloni et M. F. Carlier ( 1997 ) . " Reconstitution of actinbased motility of Listeria and Shigella using pure proteins . " Nature 9 : 244 - 249 . Lorenzini , D. M . , P . I . DaSilva , A. C . Fogaça , P. Bulet et S. Daffre ( 2003 ) . " Acanthoscurrin : a novel glycine-rich antimicrobial peptide constituvely expressed in the hemocytes of the spider Acanthoscurria gomesiana . " Dev . Comp . Immunol . 27 ( 9 ) : 781 - 791 . Lowenberger , C . , M. Charlet , J. Vizioli , S. Kamal , A . Richman , B . Christensen et P. Bulet ( 1999 ) . " Antimicrobial activity spectrum , cDNA cloning and mRNA expression of a newly isolated member of the cecropin family from the mosquito vector Aedes aegypti . " J. Biol . Chem . 274 ( 29 ) : 20092 - 20097 . Luschen , W. , F . Buck , A . Willig et P. P. Jaros ( 1991 ) . " Isolation , sequence analysis , and physiological properties of enkephalins in the nervous tissue of the shore crab Carcinus maenas L. " Proc . Nat . Acad . Sci . USA 88 ( 19 ) : 8671 - 8675 . M Mackintosh , J. A . , D. A . Veal , A. J . Beattie et A . A . Gooley ( 1998 ) . " Isolation from an ant Myrmecia gulosa of two inducible o-glycosylated proline rich antibacterial peptides . " J. Biol . Chem . 273 : 6139 - 6143 . Malhotra , R. , A. C . Willis , J. C . Jesenius , J. Jackson et R . B . Sim ( 1993 ) . " Structure and homology of the human C 1q receptor . " Immunol . 78 : 341 - 348 . Marquez , M. R. F . et M. A. Barracco ( 2000 ) . " Lectin , as non-self-recognition fators in crustacean . " Aquaculture 191 : 23 - 44 . Martin , G. ( 1981 ) . Contribution à l' étude cytologique et fonctionnelle des systèmes de neurosécrétion des crustacés isopodes . Thèse , Université de Poitiers . Martin , G. et M. Dubois ( 1981 ) . " A somatostatin antigen in the nervous system of an isopod Porcellio dilatatus Brant . " Gen . Comp . Endocrinol . 45 : 125 - 130 . 195 Martin , G. , S. G . Gruppe , M. Laulier , D . Bouchon , T. Rigaud et P. Juchault ( 1994 ) . " Evidence for Wolbachia spp. in the estuarine isopod Sphaeroma rugicauda ( crustacea ) : a likely cytoplasmic sex ratio distorter . " Entocyt . Cell Res . 10 : 115 - 225 . Martin , G. , P. Juchault et J. J. Legrand ( 1973 ) . " Mise en évidence d' un micro-organisme intracytoplasmique symbiote de l' oniscoïde Armadillidium vulgare Latr . dont la présence accompagne l' intersexualité ou la féminisation totale des mâles génétiques de la lignée thélygène . " C. R. Acad . Sci . Paris . 276 : 2313 - 2316 . Martin , G. G . , J. E . Hose , M. Choi , R. Provost , G. Omori , N. McKrell et G. Lam ( 1993 ) . " Organization of hematopoïetic tissue in the intermolt lobster Homarus americanus . " J. Morphol . 216 : 65 - 78 . Martin , G. G . , J. E . Hose et J. J. Kim ( 1987 ) . " Structure of hematopoïetic nodules in the ridgeback prawn , Sicyonia ingentis : Light and electron microscopic observations . " J. Morphol . 192 : 193 - 204 . Martin , G. G . , J. E . Hose , G. Minka et S. Rosenberg ( 1996 ) . " Clearance of bacteria injected into the hemolymph of the ridgeback prawn , Sicyonia ingentis ( crustacea : decapoda ) : role of hematopoïetic tissue . " J. Morphol . 227 : 227 - 233 . Martin , G. G . , K. Kay , D . Poole et C. Poole ( 1998 ) . " In vitro nodule formation in the Ridgeback prawn Sicyonia ingentis and the american lobster Homarus americanus . " Invertebr . Biol . 117 : 155 - 168 . Meister , M. ( 2004 ) . " Blood cells of Drosophila : cell lineages and role in host defence . " Curr . Op . Immunol . 16 : 10 - 15 . Meister , M. , B . Lemaître et J . A . Hoffmann ( 1997 ) . " Antimicrobial peptide defense in Drosophila . " Bio . Essay 19 ( 11 ) : 1019 - 1026 . Melchior , R. , J. P . Quigley et P . B . Armstrong ( 1995 ) . " Alpha 2 -macroglobulin-mediated clearance of proteases from the plasma of the american horseshoe crab , Limulus polyphemus polyphemus . " J. Biol . Chem . 270 : 13496 - 13502 . Michalak , M. , R. E . Milner , K. Burns et M. Opas ( 1992 ) . " Calreticulin . " Biochem . J . 285 : 681 - 692 . Mitta , G. , F . Vandenbulcke , T. Nöel , B . Romestand , J. C . Beauvillain , M. Salzet et P. Roch ( 2000a ) . " Differential distribution and defence involvement of antimicrobial peptides in mussel . " J. Cell Sci . 113 : 2759 - 2769 . Mitta , G. , F . Vandenbulcke et P. Roch ( 2000b ) . " Original involvement of antimicrobial peptides in mussel innate immunity . " FEBS Lett . 486 : 185 - 190 . Mitta , G. , F . Vanderbulcke , F . Hubert et P. Bulet ( 1999 ) . " Mussel defensins are synthesized and processed in granulocytes then released into the plasma after bacterial challenge . " J. Cell Sci . 112 : 4233 - 4242 . Miyata , T. , F . Tokunaga , T. Yoneya , K. Yoshikawa , S. Iwanaga , M. Niwa , T. Takao et Y. Shimonishi ( 1989 ) . " Antimicrobial peptides , isolated from horseshoe crab hemocytes , Tachyplesin II , and Polyphemusins I and II : chemical structures and biological activity . " J. Biochem . 106 : 663 - 668 . Mor , A . , V. H . Nguyen , A . Delfour , D . Migliore-Samour et P. Nicolas ( 1991 ) . " Isolation , amino acid sequence , and synthesis of dermaseptin , a novel antimicrobial peptide of amphibian skin . " Biochem . 30 : 8824 - 8830 . Moret , Y. , P. Juchault et T. Rigaud ( 2001 ) . " Wolbachia endosymbiont responsible for cytoplasmic incompatibility in a terrestrial crustacean : effects in natural and foreign hosts . " Heredity 86 : 325 - 332 . Mori , K. et J . E . Stewart ( 1978 ) . " The hemolymph bactericidin of the american lobster ( Homarus americanus ) adsorption and activation . " J. Fish Res . Board Canada 5 : 1504 - 1507 . Morisset , D . et J. Frère ( 2002 ) . " Heterologous expression of bacteriocins using the mesentericin Y105 dedicated transport system by Leuconostoc mesenteroides mesenteroides . " Biochim . 84 : 569 - 76 . Morita , T. , S. Ohtsubo , T. Nakamura , H. Tanaka , S. Iwanaga et K. Ohashi ( 1985 ) . " Isolation and biological activities of Limulus anticoagulant ( anti-LPS factor ) which interacts with lipopolysaccharides ( LPS ) . " J. Biochem . 97 : 1611 - 1620 . Munoz , M. , F . Vandenbulcke , J. Garnier , Y. Gueguen , P. Bulet , D . Saulnier et E. Bachère ( 2004 ) . " Involvement of penaedins in defense reactions of the shrimp Litopenaeus stylirostris to a pathogenic vibrio . " Cell . Mol . Life Sci . 61 ( 961 - 972 ) . Munoz , M. , F . Vandenbulke , D . Saulnier et E. Bachère ( 2002 ) . " Expression and distribution of penaeidin antimicrobial peptides are regulated by haemocyte reactions in microbial challenged shrimp . " Eur . J. Biochem . 269 : 2678 - 2689 . Muta , T. et S. Iwanaga ( 1996 ) . " The role of hemolymph coagulation in innate immunity . " Curr . Opin . Immunol . 8 ( 1 ) : 41 - 47 . N Nagai , T. et S. Kawabata ( 2000 ) . " A link between blood coagulation and prophenoloxidase activation in arthropod host defense . " J. Biochem . Chem . 275 ( 38 ) : 29264 - 29267 . Nagai , T. , T. Osaki et S. Kawabata ( 2001 ) . " Functional conversion of hemocyanin to phenoloxidase by horseshoe crab antimicrobial peptides . " J. Biochem . Chem . 276 ( 29 ) : 2716627170 . Nakhasi , H. L . , G. P . Pogue , R. C . Duncan , M. Joshi , C. D . Atreya , N.S . Lee et e . al . ( 1998 ) . " Implication of calreticulin function in parasite biology . " Parasitol . Today 14 : 157 160 . Nissen-Meyer , J. et I . F . Nes ( 1997 ) . " Ribosomally synthesized antimicrobial peptides : their function , structure , biogenesis and mechanism of action . " Arch . Microbiol . 167 : 67 - 77 . O Ogden , C. A . , A. d . Cathelineau , P. R . Hoffmann , D . Bratton , B . Ghebrehiwet , V. A . Fadok et P. M. Henson ( 2001 ) . " C 1q and mannose binding lectin engagement of cell surface calreticulin and CD91 initiates macropinocytosis and uptake of apoptotic cells . " J. Exp . Med . 194 : 781 - 795 . Okuno , A . , H. Katayama et H. Nagasawa ( 2000 ) . " Partial characterization of vitellin and localization of vitellogenin production in the terrestrial isopod , Armadillidium vulgare . " Comp . Biochem . Physiol . [ B ] 126 ( 3 ) : 397 - 407 . O'Neill , S. L . , R. Giordano , A. M . Colbert , T. L . Karr et H. M. Robertson ( 1992 ) . " 16S rRNA phylogenetic analysis of the bacterial endosymbionts associated with cytoplasmic incompatibility in insects . " Proc . Nat . Acad . Sci . USA 89 : 2699 - 2702 . O'Neill , S. L . , A. A . Hoffman et J. H. Werren ( 1997 ) . In Influential passengers : inherited micro-organisms and arthropod reproduction . New York , Oxford University Press . Orivel , J. et A. Dejean ( 2001 ) . " Comparative effect of the venoms of ants of the genus Pachycondyla ( Hymenoptera Ponerinae ) . " Toxicon . 39 ( 2 - 3 ) : 195 - 201 . Ouellette , A . et E. Selsted ( 1996 ) . " Paneth cell defensins : endogenous peptide components of intestinal host defense . " FASEB . J . 10 : 1280 - 1289 . Oyama , H. , A . Tenku , K. Kakita , S. Matzumura , S. Nishida et M. Horino ( 1978 ) . " Recovery of human C-peptide by acid-ethanol extraction . " Endocrinol . Jpn . 25 ( 5 ) : 493 - 498 . P Park , C . , C . Park , S. Hong , H. Lee , S. Lee et S. Kim ( 2000 ) . " Characterization and cDNA cloning of two glycine- and histidine-rich antimicrobial peptides from the roots of shepherd's purse , Capsella bursa-pastoris . " Plant Mol . Biol . 44 : 187 - 197 . Paul , R. , B . Bergner , A . Pfeffer-Seidl , H. Decker , R. Efinger et H. Storz ( 1994 ) . " Gas transport in the hemolymph of arachnids . Oxygen transport and physiological role of hemocyanin . " J. Exp . Biol . 188 : 25 - 46 . Paul , R. et R. Pirow ( 1998 ) . " The physiological signifiance of respiratory proteins in invertebrates . " Zool . 100 : 319 - 327 . Persson , M. , L. Cerenius et K. Söderhäll ( 1987 ) . " The influence of haemocyte number on the resistance of the freshwater crayfish , Pacifastacus leniusculus Dana , to the parasitic fungus Aphanomyces astaci . " J. Fish Dis . 10 : 471 - 477 . Picaud , J. L . et C. Souty ( 1980 ) . " Démonstration immunohistochimique de la présence la vitellogénine dans le tissu adipeux et l' hépatopancréas du crustacé isopode Oniscoïde Porcellio dilatatus ( Brandt ) . " C.R. Acad . Sci . Paris . 290 : 123 - 125 . Pless , D. D . , M. B . Aguilar , A . Falcon , E . Lozano-alvarez et E. P. Heimer de la Cotera ( 2003 ) . " Latent phenoloxidase activity and N-terminal amino acid sequence of hemocyanin from Bathynomus giganteus , a primitive crustacean . " Arch . Biochem . Biophys . 409 ( 402 - 410 ) . Porat , A . , Y. Sagiv et Z. Elazar ( 2000 ) . " A 56 kDa selenium-binding protein participates in intra-Golgi protein transport . " J. Biol . Chem . 275 ( 19 ) : 14457 - 14465 . Powers , J. P. S . et R . E. W . Hancock ( 2003 ) . " The relationship between peptide structure and antibacterial activity . " Peptides 24 : 1681 - 1691 . R Ratanapo , S. et M. Chulavatnatol ( 1990 ) . " Monodin , a new sialic acid-specific lectin from black tiger prawn ( Penaeus monodon ) . " Comp . Biochem . Physiol . 97B : 515 - 520 . Ratcliffe , N. A . , A. F . Rowley , S. W . Fitzgerald et C. P. Rhodes ( 1985 ) . " Invertebrate immunity : basis concepts and recent advances . " Int . Rev . Cytol . 97 : 183 - 350 . Rattanachai , A . , I. Hirono , T. Ohira , Y. Takahashi et T. Aoki ( 2004 ) . " Molecular cloning and expression analysis of alpha 2 -macroglobulin in the Kuruma shrimp , Marsupenaeus japonicus . " Fish Shellfish Immunol . 16 : 599 - 611 . Ravindranath , M. H . , H. H . Higo , E. L . Cooper et J . C . Paulson ( 1985 ) . " Purification and characterization of an O-acetylsialic acid specific lectin from a marine crab Cancer antennarius . " J. Biol . Chem . 260 ( 15 ) : 8850 - 8856 . Reddy , K . V. R . , R. D . Yedery et C. Aranha ( 2004 ) . " Antimicrobial peptides : premises and promises . " Int . J. Antimicrob . Agent 24 : 536 - 547 . Reynolds , E. S . ( 1963 ) . " The use of lead citrate at high pH as an electron opaque stain in electron microscopy . " J. Cell . Biol . 17 : 208 - 212 . Rikihisa , Y. , Y. Zhang et J. Park ( 1994 ) . " Inhibition of infection of macrophages with Ehrlischia risticii by cytochalasins , monodansylcadaverine , and taxol . " Inf . Immun . 62 ( 11 ) : 5126 - 5132 . Robert , J. ( 2003 ) . " Evolution of heat schock protein and immunity . " Dev . Comp . Immunol . 27 : 449 - 464 . Rodriguez , J. , V. Boulo , E . Mialhe et E. Bachère ( 1995 ) . " Characterization of shrimp haemocytes and plasma components by monoclonal antibodies . " J. Cell Sci . 108 : 1043 - 1050 . Rojtinnakorn , J. , I. Hirono , T. Itami , Y. Takahashi et T. Aoki ( 2002 ) . " Gene expression in haemocyte of Kuruma prawn , Penaeus japonicus , in response to infection with WSSV by EST approach . " Fish Shellfish Immunol . 13 : 69 - 83 . Romo-Figueroa , M. G . , C . Vargas-Requena , R. R . Sotelo-Mundo , F . Vargas-Albores , I. Higuera-Ciapara , K. Söderhäll et G. Yepiz-Plascencia ( 2004 ) . " Molecular cloning of a beta-glucan pattern recognition lipoprotein from the white shrimp Penaeus ( Litopenaeus ) vannamei : correlation between the deduced amino acid sequence and the native protein structure . " Dev . Comp . Immunol . 28 ( 7 - 8 ) : 713 - 726 . Roux , M. M . , A . Pain , K. R . Klimpel et A. K. Dhar ( 2002 ) . " The lipopolysaccharide and beta- 1 - 3- glucan binding protein gene is up-regulated in white spot virus infected shrimp ( Penaeus stylirostris ) . " J. Virol . 76 ( 7140 - 7149 ) . S Salzet , M. ( 2001 ) . " Vertebrate immunity ressembles a mosaic of invertebrate immune responses . " Trends Immunol . 22 ( 6 ) : 285 - 288 . Salzet , M. , P. Bulet , W. M . Weber , W. Clauss , M. Verger-Bocquet et J. Malecha ( 1996 ) . " Structural characterization of a novel neuropeptide from the central nervous system of the leech Erpobdella octoculata . The leech osmoregulator factor . " J. Biol . Chem . 271 : 72377243 . Salzet , M. et A. Tasiemski ( 2001 ) . " Involvement of pro-enkephalin-derived peptides in immunity . " Dev . Comp . Immunol . 25 ( 3 ) : 177 - 185 . Sambrook , J. , E. F . Fritsch et T. Maniatis ( 1989 ) . In Molecular cloning : A Laboratory Manual . C. S . Harbor . NY , Cold Spring Harbor Laboratory Press . Sappington , T. W . et A . F . Raikhel ( 1997 ) . " Molecular characteristics of insect vitellogenins and vitellogenin receptors . " Insect Biochem . Mol . Biol . 28 ( 5 - 6 ) : 277 - 300 . Schnapp , D . , G. D . Kemp et V. J. Smith ( 1996 ) . " Purification and characterization of a proline-rich antibacterial peptide , with sequence similarity to bactenecin- 7 , from the haemocytes of the shore crab , Carcinus maenas . " Eur . J. Biochem . 240 : 532 - 539 . Seki , N. , T. Muta , T. Oda , D . Iwaki , K. Kuma , T. Miyata et S. Iwanaga ( 1994 ) . " Horseshoe crab J. Biol . Chem . 269 ( 2 ) : 1370 - 1374 . Selbach , M. et S. Backert ( 2005 ) . " Cortactin : an Achilles'heel of the actin cytoskeleton targeted by pathogens . " Trends Microbiol . 13 ( 4 ) : 181 - 189 . Sellos , D . , S. Lemoine et A. V. Wormhoudt ( 1997 ) . " Molecular cloning of hemocyanin cDNA from Penaeus vannamei ( Crustacea , Decapoda ) : structure , evolution and physiological aspects . " FEBS Lett . 407 : 153 - 158 . Shai , Y. ( 1999 ) . " Mechanism of the binding insertion and destabilization of phospholipid bilayer membranes by alpha-helical antimicrobial and cell non-selective membrane-lytic peptides . " Biochim . Biophys . Acta 1462 ( 1 - 2 ) : 55 - 70 . Sierra , C . , R. Lascurain , A . Pereyra , J. Guevara , G. Martinez , C . Agundis , E . Zenteno et L. Vasquez ( 2005 ) . " Participation of serum and membrane lectins on the oxidative burst regulation in Macrobrachium rosenbergii hemocytes . " Dev . Comp . Immunol . 29 : 113 - 121 . Silva , P . I . , S. Daffre et P. Bulet ( 2000 ) . " Isolation and characterization of gomesin , an 18 residue cystein-rich defense peptide from the spider Acanthoscurria gomesiana hemocytes with sequence similarities to horseshoe crab antimicrobial peptides of the tachyplesin family . " J. Biol . Chem . 275 ( 43 ) : 33464 - 33470 . Smith , V. J . et P . A . Johnston ( 1992 ) . " Differential haemotoxic effect of PCB congeners in the common shrimp Crangon crangon . " Comp . biochem . Physiol . [ C ] 101 : 641 - 649 . Smith , V. J . et N . A . Ratcliffe ( 1980 ) . " Host defense reactions of the shore crab Carcinus maenas ( L ) ; clearance and distribution of injected particles . " J. Mar . Biol . Assoc . UK . 60 : 89 102 . Smith , V. J . et K. Söderhäll ( 1983 ) . " Induction of degranulation and lysis of heamocytes in the freshwater crayfish Astacus astacus , by components of the prophenoloxidase activating system in vitro . " Cell . Tissue Res . 233 : 295 - 303 . Söderhäll , I. , E . Bangyeekhun , S. Mayo et K. Söderhäll ( 2003 ) . " Hemocyte production and maturation in an invertebrate animal ; proliferation and gene expression in hematopoïetic stem cell of Pacifastacus leniusculus . " Dev . Comp . Immunol . 27 : 661 - 672 . Söderhäll , I. et K. Söderhäll ( 2001 ) . Immune reactions . In Biology of freshwater crayfish . D . M. Holdich , Blackwell Science . 11 : pp. 439 - 464 . Söderhäll , K. ( 1982 ) . " Prophenoloxidase activating system and melanization : a recognition mechanism of arthropods ? A review . " Dev . Comp . Immunol . 6 : 601 - 611 . Söderhäll , K. ( 1999 ) . " Invertebrate immunity . " Dev . Comp . Immunol . 23 ( 4 - 5 ) : 263 - 266 . Söderhäll , K. , J. Cerenius et M. W. Johansson ( 1996 ) . The prophenoloxidase activating system in invertebrates . In New directions in Invertebrate Immunology . K. Söderhäll , S. Iwanaga and G. R. Vasta . Fair Haven , SOS Publications : pp. 229 - 253 . Söderhäll , K. et L. Häll ( 1984 ) . " Lipopolysaccharide-induced activation of prophenoloxidase activating system in crayfish haemocyte lysate . " Biochim . Biophys . Acta 797 : 99 - 104 . Söderhäll , K. et V. J. Smith ( 1983 ) . " Separation of the haemocyte population of Carcinus maenas and other marine decapods and phenoloxidase distribution . " Dev . Comp . Immunol . 7 : 229 - 239 . Söderhäll , K. , V. J . Smith et M. W. Johansson ( 1986 ) . " Exocytosis and uptake of bacteria by isolated hemocyte populations of two crustaceans : evidence for cellular co-operation in the defense reactions of arthropods . " Cell Tissue Res . 245 : 43 - 49 . Söderhäll , K. , A . Wringen , M. W . Johansson et K. Bertheussen ( 1985 ) . " The cytotoxic reaction of hemocytes from the freshwater crayfish , Astacus astacus . " Cell Immunol . 94 : 326 332 . Somboonwiwat , K. , M. Marcos , A . Tassanakajon , S. Klinbunga , A . Aumelas , B . Romestand , Y. Gueguen , H. Boze , G. Moulin et E. Bachère ( 2005 ) . " Recombinant expression and anti-microbial activity of anti-lipolysaccharide factor ( ALF ) from the black tiger shrimp Penaeus monodon . " Dev . Comp . Immunol . Sous presse . Song , Y. L . et Y. T. Hsieh ( 1994 ) . " Immunostimulation of tiger shrimp ( Penaeus monodon ) hemocytes for generation of microbicidal substances : analysis of reactive oxygen species . " Dev . Comp . Immunol . 18 ( 3 ) : 201 - 209 . Sonnenberg , A . ( 1993 ) . " Integrins and their ligands . " Curr . Op . Microbiol . Immunol . 184 : 7 35 . Sotelo-Mundo , R. R . , M. A . Islas-Osuna , E . de-la-Re-Vega , J. Hernandez-Lopez , F . Vargas-Albore et G. Yepiz-Plascencia ( 2003 ) . " cDNA cloning of the lysozyme of the white shrimp Penaeus vannamei . " Fish . Shellfish Immunol . 15 : 325 - 331 . Sottrup-Jensen , L. ( 1989 ) . " Alpha-macroglobulins : structure , shape and mechanism of proteinase complex formation . " J. Biol . Chem . 264 : 11539 - 11542 . Spycher , S. E . , S. Arya , D. E . Isenman et R. H. Painter ( 1987 ) . " A functional , thioestercontaining alpha 2 -macroglobulin homologue isolated from the hemolymph of the american lobster ( Homarus americanus ) . " J. Biol . Chem . 262 : 14606 - 14611 . Sritunyalucksana , K. , L. Cerenius et K. Söderhäll ( 1999 ) . " Molecular cloning and characterization of prophenoloxidase in the black tiger shrimp , Penaeus monodon . " Dev . Comp . Immunol . 23 : 179 - 186 . Sritunyalucksana , K. , S. Y . Lee et K. Söderhäll ( 2002 ) . " A Beta- 1 , 3- glucan binding protein from the black tiger shrimp , Penaeus monodon . " Dev . Comp . Immunol . 26 : 237 - 245 . Sritunyalucksana , K. et K. Söderhäll ( 2000 ) . " The proPO and clotting system in crustaceans . " Aquaculture 191 : 53 - 69 . Steiner , H. , D . Hultmark , A . Engstrom , H. Bennich et H. G. Boman ( 1981 ) . " Sequence and specificity of two antibacterial proteins involved in insect immunity . " Nature 292 : 246 248 . Stewart , J. E . et B. M. Zwicker ( 1972 ) . " Natural and induced bactericidal activities in the hemolymph of the lobster , Homarus americanus : products of hemocyte-plasma interaction . " Can . J. Microbiol . 18 : 1499 - 1509 . Stöcker , W. , S. Breit , L. Sottrup-Jensen et R. Zwilling ( 1991 ) . " Alpha 2 -macroglobulin from the haemolymph of the freshwater crayfish Astacus astacus . " Comp . biochem . Physiol . [ B ] 98 : 501 - 509 . Stouthamer , R. ( 1997 ) . Wolbachia induced parthenogenesis . In Influential passengers : inherited microorganisms and arthropod reproduction . S. L . O'Neill , A. A . Hoffman and J . H. Werren . NY , Oxford University Press . Stouthamer , R. , J. A . Breeuwer , R. F . Luck et J. H. Werren ( 1993 ) . " Molecular identification of micro-organisms associated with parthenogenesis . " Nature 361 : 66 - 68 . Sugumaran , M. ( 1996 ) . Roles of the insect cuticule in host defense reactions . In New directions in Invertebrate Immunology . K. Söderhäll , S. Iwanaga and G.R. Vasta . Fair Haven , SOS Publications : 355 - 374 . Sugumaran , M. et M. R. Kanost ( 1993 ) . Regulation of insect hemolymph phenoloxidase . In Parasites and pathogens of insects . N.E . Beckage , S.N . Thompson and B.A. Federici . San Diego , California , Academic Press Inc . Sun , L . V . , J. M . Foster , G. Tzertzinis , M. Ono , C . Bandi , B. E . Slatko et S. ( 2001 ) . " Determination of Wolbachia genome size by pulse-field gel electrophoresis . " J. Bacteriol . 183 : 2219 - 2225 . Supungul , P. , S. Klinbunga , R. Pichyankura , S. Jitrapakdee , I. Hirono , T. Aoki et A. Tassanakajon ( 2002 ) . " Identification of immune related genes in hemocytes of black tiger shrimp ( Peneaus monodon ) . " Mar . Biotechnol . 4 : 487 - 494 . T Takaki , Y. , T. Muta et S. Iwanaga ( 1997 ) . " A peptidyl-propyl cis / trans-isomerase ( cyclophilin G ) in regulated secretory granules . " J. Biol . Chem . 272 ( 45 ) : 28615 - 28621 . Tasiemski , A . , M. Verger-Bocquet , M. Cadet , Y. Goumon , M. H . Metz-Boutigue , D . Aunis , G. B . Stefano et M. Salzet ( 2000 ) . " Proenkephaline A-derived peptides in invertebrates innate immune processes . " Brain Res . Mol . Brain Res . 76 ( 2 ) : 237 - 252 . Taylor , M. J . et A. Hoerauf ( 1999 ) . " Wolbachia bacteria of filarial nematodes . " Parasitol . Today 15 : 437 - 442 . Thörnqvist , P. O . , M. W . Johansson et K. Söderhäll ( 1994 ) . " Opsonic activity of cell adhesion proteins and beta- 1 , 3- glucan binding proteins from two crustaceans . " Dev . Comp . Immunol . 18 : 3 - 12 . Thörnqvist , P. O . et K. Söderhäll ( 1997 ) . " Crustacean immune reaction , a short review . " Dis . Asian Aquaculture III . Fish Health Section , Asian Fisheries Society , Manila . 203 - 218 . Turnbull , M. W . , S. B . Martin et B . A . Webb ( 2004 ) . " Quantitative analysis of hemocyte morphological abnormalities associated with Campoletis sonorensis parasitation . " J. Insect Sci . 11 : 1 - 15 . Tytler , E. M . , G. M . Anantharamaiah , D. E . Walker , V. K . Mishra , M. N . Palgunashari et J. P. Segrest ( 1995 ) . " Molecular basis for prokaryotic specificity of magainin induced lysis . " Biochem . 34 : 4393 - 4401 . V Vargas-Albores , F . , M. A . Guzman et J. L. Ochoa ( 1993 ) . " An anticoagulant solution for haemolymph collection and prophenoloxidase studies of the penaeid shrimp ( Penaeus californiensis ) . " Comp . Biochem . Physiol . 121 ( 2 ) : 299 - 303 . Vasta , G. R . et J . D . Lambris ( 2002 ) . " Innate immunity in the Aegean : ancient pathways for today's survival . " Dev . Comp . Immunol . 26 : 217 - 225 . Vazquez , L. , G. Maldonado , C . Agundis , A . Perez , E. L . Cooper et E. Zenteno ( 1997 ) . " Participation of a sialic specific lectin from freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii hemocytes in the recognition of non-self cells . " Exp . Zool . 279 ( 265 - 272 ) . Vazquez , L. , A . Perez , D . Millan , C . Agundis , G. G . Martin , E. L . Cooper , R. Lascurain et E. Zenteno ( 1997 ) . " Morphology of hemocytes from the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii . " J. Morphol . 234 : 147 - 153 . Vergote , D . , P. E . Sautière , F . Vandenbulcke , D . Vieau , G. Mitta , E. R . Macagno et M. Salzet ( 2004 ) . " Up-regulation of neurohemerythrin expression in the central nervous system of the medicinal leech , Hirudo medicinalis , following septic injury . " J. Biol . Chem . 279 ( 42 ) : 43828 - 43837 . Vodovar , N. , C . Acosta , B . Lemaitre et F. Boccard ( 2004 ) . " Drosophila : a polyvalent model to decipher host-pathogen interactions . " Trends Microbiol . 12 ( 5 ) : 235 - 242 . W Wang , R. , S. Y . Lee , L. Cerenius et K. Söderhäll ( 2001 ) . " Properties of the prophenoloxidase activating enzyme of the freshwater crayfish , Pacifastacus leniusculus . " Eur . J. Biochem . 268 : 895 - 902 . Werren , J. H . et S. L. O'Neill ( 1997 ) . The evolution of heritable symbionts . In Influential passengers : inherited microorganisms and arthropod reproduction . S. L . O'Neill , A. A . Hoffmann and J. H. Werren . Oxford , Oxford Univ . Press : 1 - 41 . Werren , J. H . , D. M . Windsor et L. R. Guo ( 1995 ) . " Distribution of Wolbachia among neotropical arthropods . " Proc . R. Soc . Lond . B . 262 : 197 - 204 . White , K. N . et N . A . Ratcliffe ( 1982 ) . " The segregation and elimination of radio and fluorescent-labelled marine bacteria from the haemolymph of the shore crab , Carcinus maenas . " J. Mar . Biol . Assoc . UK. 62 : 819 - 833 . White , K. N . , N. A . Ratcliffe et M. Rossa ( 1985 ) . " The antibacterial activity of haemocyte clumps in the gills of the shore crab , Carcinus maenas . " J. Mar . Biol . 65 : 857 - 870 . Willies , T. W . , A. T . Tu et C. W. Miller ( 1989 ) . " Thrombolysis with a snake venom protease in rat model of venous thrombosis . " Thromb . Res . 53 : 19 - 29 . Winans , K. A . , D. S . King , V. K . Rao et D. Mauzerall ( 1999 ) . " A chemically synthesized version of the insect antibacterial glycopeptide , diptericin , disrupts bacterial membranes . " Biochem . 38 : 11700 - 11710 . Wu , M. , E . Maier , R. Benz et R . E. W . Hancock ( 1999 ) . " Mechanisms of interaction of different classes of cationic antimicrobial peptides with planar bilayers and with the cytoplasmic membrane of Escherichia coli . " Biochem . 38 : 7235 - 7242 . Wu , M. , L . V . Sun , J. Vamathevan , M. Riegler , R. Deboy , J. C . Brownlie , M. E. A. , W. Martin , C . Esser , N. Ahmadinejad , C . Wiegand , R. Madupu , M. J . Beanan , L. M . Brinkac , S. C . Daugherty , A. S . Durkin , J. F . Kolonay , W. C . Nelson , Y. Mohamoud , P. Lee , K. Berry , M. B . Young , T. Utterback , J. Weidman , W. C . Nierman , I. T . Paulsen , K. E . Nelson , H. Tettelin , S. L . O'Neill et J . A . Eisen ( 2004 ) . " Phylogenomics of the reproductive parasite Wolbachia pipientis pipientis wMel : a streamlined genome overrun by mobile genetic elements . " PLoS Biol . 2 : 327 - 341 . Y Yang , H. , E . Nevo et R . E . Tashian ( 1998 ) . " Unexpected expression of carbonic anhydrase I and selenium-binding protein as the only major non heme proteins in erythrocytes of the subterranean mole rat ( Spalax ehrenbergi ) . " FEBS Lett . 430 : 343 - 347 . Yang , J. , M. Yamamoto , J. Ishibashi , K. Taniai et M. Yamakawa ( 1998 ) . " Isolation , cDNA cloning and gene expression of an antibacterial protein from larvae of the coconut rhinoceros beetle , Oryctes rhinoceros . " Eur . J. Biochem . 255 : 734 - 738 . Yeh , M. S . , Y. L . Chen et I. H. Tsai ( 1998 ) . " The hemolymphe clottable protein from tiger shrimp , Penaeus monodon , and related species . " Comp . Biochem . Physiol . [ B ] 121 ( 169 - 176 ) . Yeh , M. S . , K. Kinoshita et M. Ashida ( 1999 ) . " Molecular cloning and characterization of a hemolymph clottable protein from tiger shrimp . " Eur . J. Biochem . 266 : 624 - 633 . Yount , N. , J. Yuan , A . Tarver , T. Castro , G. Diamond , P. Tan , J. Levy , C . McCullough , J. Cullor , C . Bevins et M. Selsted ( 1999 ) . " Cloning and expression of bovin neutrophil betadefensins . Biosynthetic profile during neutrophilic maturation and localization of mature peptide to novel cytoplasmic dense granules . " J. Biol . Chem . 274 : 26249 - 26258 . Yu , K. H . , K. N . Kim , J. H . Lee , H. S . Lee , S. H . Kim , K. Y . Cho , M. H . Nam et I. H. Lee ( 2002 ) . " Comparative study on characteristics of lysozymes from the hemolymph of three lepidopteran larvea , Galleria mellonella mellonella , Bombyx mori , Agrius convolvuli convolvuli . " Dev . Comp . Immunol . 26 ( 8 ) : 707 - 713 . Z Zasloff , M. ( 2002 ) . " Antimicrobial peptides of multicellular organisms . " Nature 415 : 389 395 . Zdobnov , E. M . , C . von Mering , L. Letunic , D . Torrents , M. Suyama , R. R . Copley , G . K. Christophides , D . Thomasova , R. A . Holt , G. M . Subramanian , H. M . Mueller , G. Dimopoulos , J. H . Law , M. A . Wells , E . Birney , R. Chalab , A. L . Halpern , E . Kokova , C . L. Kraft , Z. Lai , S. Lewis , C . Louis , C . Barillas-Mury , D . Nusskern , G. M . Rubin , S. L . Salzberg , G. G . Sutton , P. Topalis , R. Wides , P. Wincker , M. Yandell , F. H . Collin , J. Riberra , W. M . Gelbart , F. C . Kafatos et P. Bork ( 2002 ) . " Comparative genome and proteome analysis of Anopheles gambia and Drosophila melanogaster . " Science 298 : 149 159 . Zhang , X. , C . Huang et Q. Qin ( 2004 ) . " Antiviral properties of hemocyanin isolated from the shrimp Penaeus monodon . " Antiviral Res . 61 : 93 - 99 . Zhang , Y. , A . Wisner , Y. Xiong et C. Bon ( 1995 ) . " A novel plasminogen activator from snake venom . Purification , characterization and molecular cloning . " J. Biol . Chem . 270 : 10246 - 10255 . Zlateva , T. , P. D . I. Muro , B . Salvato et M. Beltramini ( 1996 ) . " The o-diphenoloxidase activity of arthropod hemocyanin . " FEBS Lett . 384 : 251 - 254 . Annexes ANNEXE I Wolbachia chez les arthropodes et les nématodes Dans la nature , une grande partie des espèces animales ou végétales sont parasitées ou vivent en symbiose . Les associations telles que le parasitisme et le mutualisme sont aujourd'hui reconnues comme jouant un rôle clé dans l' écologie et l' évolution des espèces ( Combes , 2001 ) . Toutefois , la limite entre parasitisme et mutualisme est parfois difficile à déterminer et on assiste à des relations complexes entre l' hôte et l' organisme hébergé qui suscitent de multiples questions en terme d' immunité , de survie ou de tolérance ( 1 ) Qui bénéficie le plus de la relation ? ( 2 ) Pourquoi le parasite / symbiote n' est -il pas éliminé par l' hôte ( 3 ) Comment le parasite / symbiote évite -t-il le système immunitaire ? Est -il reconnu par l' hôte ? Modifie -t-il le fonctionnement cellulaire et/ou physiologique de son hôte ? Chez les arthropodes , de nombreuses espèces hébergent des microorganismes intracellulaires qui sont transmis verticalement ; leur survie dépend donc du succès reproducteur de leurs hôtes . Afin d' augmenter leur propre transmission , certains de ces micro-organismes , dits parasites de la reproduction , manipulent la reproduction de leurs hôtes . Les bactéries endocellulaires du genre Wolbachia en sont l' exemple typique . Les Wolbachia sont des bactéries intracytoplasmiques strictes , non cultivables , appartenant à la division des & 206;& 133;-protéobactéries . Ellespossèdent les caractéristiques générales des rickettsies ( Hertig et Wolbach , 1924 ) puisqu' elles appartiennent au groupe des rickettsia-like qui réunit des bactéries hébergées par des arthropodes vecteurs de maladie humaines , comme par exemple , Cowdria et Anaplasma ( O'Neill et al. , 1992 ; Stouthamer et al. , 1993 ) . Le genre Wolbachia a été décrit pour la première fois chez le moustique en 1924 ( Hertig et Wolbach , 1924 ) . Les effets physiologiques de ces bactéries endocellulaires , parasites du sexe ont été intensivement étudiés dans notre laboratoire chez différents isopodes . Ces bactéries , alors appelées bactéries F ( féminisantes ) , ont été mises en évidence dès le début des années 1970 ( Juchault , 1966 ; Legrand et Juchault , 1970 ; Martin et al. , 1973 ) . Avec le développement de la PCR , les Wolbachia ont été identifiées chez de nombreux arthropodes ( insectes , acariens , isopodes ... ) ( Werren et O'Neill , 1997 ; Breeuwer et Jacobs , 1996 ; Martin et al. , 1994 ; Bouchon et al. , 1998 ) mais également chez des nématodes ( Bandi et al. , 1998 ) , ce qui en fait probablement les parasites intracellulaires les plus ubiquistes du règne animal . Des études suggèrent qu' au moins 16 % des espèces d' insectes peuvent naturellement infectées par cette bactérie ( Werren et al. , 1995 ) . Chez les isopodes terrestres , 35 % des espèces sont infectées ( Bouchon et al. , 1998 ) et chez les filaires , 9 des 10 espèces répertoriées sont infectées ( Bandi et al. , 1998 ) . Toutes les études phylogénétiques menées sur le groupe des Wolbachia s' accordent sur la non-congruence de la phylogénie des bactéries à celles de leurs hôtes . La distribution actuelle des bactéries serait donc en partie le résultat de transferts horizontaux . Quel que soit le type de modification induite par Wolbachia sur la reproduction de ses hôtes , la conséquence théorique est toujours l' augmentation de la prévalence de Wolbachia dans les populations hôtes . Les altérations de la reproduction que Wolbachia entraînent chez les arthropodes sont désormais bien connues et sont les suivantes : ( a ) L' incompatibilité cytoplasmique ( IC ) : un croisement entre un mâle infecté et une femelle non infectée ou infectée par une souche différente de Wolbachia résulte en la mort des embryons . L' IC s' exprime chez deux espèces d' isopodes terrestres ( Legrand et al. , 1986 ; Moret et al. , 2001 ) et chez les insectes , c' est actuellement l' effet le plus répandu ( O'Neill et al. , 1997 ) . ( b ) La parthénogenèse thélytoque : les femelles vierges infectées ne produisent que des femelles . Cet effet se rencontre uniquement chez les hyménoptères haplo-diploïdes ( Stouthamer et al. , 1997 ; pour revue ) . ( c ) Le & 200;& 136;male killing& 200;& 136; ( Hurst et al. , 1999 ; Jiggins et al. , 2000 ) : les embryons mâles infectés ne sont pas viables tandis que les embryons femelles infectés se développent normalement . Cet effet est décrit chez deux espèces de lépidoptères et chez un coléoptère ( Hurst et al. , 1999 ) . ( d ) La réalisation de l' ovogenèse ( Dedeine et al. , 2001 ) : les femelles chez lesquelles la souche de Wolbachia a été éliminée par traitement antibiotique n' ont pas d' ovocytes matures dans leurs ovaires et ne peuvent donc pas se reproduire . ( e ) La féminisation : cet effet se rencontre principalement chez les crustacés isopodes terrestres et se traduit par la transformation des mâles génétiques en femelles fonctionnelles ( Martin et al. , 1973 ; Juchault et al. , 1994 ) . Chez les nématodes , Wolbachia est présente chez les filaires Onchocerca volvulus responsables de la cécité des rivières , Wuchereria bancrofti bancrofti et Brugia malayi responsables de l' éléphantiasis chez l' homme ( Taylor et Hoerauf , 1999 ; Bandi et al. , 1999 et 2001 ) . Chez ces hôtes , Wolbachia n' induit pas d' altération de la reproduction , mais il semble que sa présence soit nécessaire au développement de son hôte . Des traitements à la tétracycline montrent que la réduction de la charge en Wolbachia chez les nématodes inhibe l' embryogenèse , la production de microfilaires et le développement des larves en adultes , et interfère avec la durée de vie des adultes ( Bandi et al. , 2001 ; Langworthy et al. , 2000 ) . ANNEXE III Nombre d' hémocytes circulants par microlitre d' hémolymphe chez Armadillidium vulgare ( A.v. ) et chez Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia ( A.v . + W ) . 20 femelles de chaque type d' animaux ont été prélevées et les cellules ont été dénombrées 3 fois par animal . La ligne moyenne indique le nombre moyen d' hémocytes circulants par microlitre dans l' hémolymphe . ANNEXE III Comparaison des séquences protéiques d' hémocyanines et de prophénoloxidases chez différents de crustacés , par alignement multiple ( CLUSTAL W ) . H : hémocyanine , P : prophénoloxydase . Numéros d' accession : H Panulirus interruptus : BHLOA ; HB Panulirus interruptus : BHLOB ; H Pontastacus leptodactylus : P83180 ; H Pacifastacus leniusculus : AA047336 ; Armadillidium vulgare ; H Penaeus vannamei : CAA57880 ; H2 Pacifastacus leniusculus : AAM81357 ; P Pacifastacus leniusculus : CAA58471 ; P Homarus americanus : AAT73697 ; P Penaeus semisulcatus : AAM77690 ; P Penaeus monodon : AAM77689 ; P Penaeus japonicus : BAB83773 . Résumé Les cellules sanguines ( hémocytes ) sont le principal siège de l' immunité innée chez les crustacés . Cette immunité apparue très tôt dans le règne animal , diffère de l' immunité acquise ( vertébrés ) , elle comporte deux aspects ; l' un cellulaire ( phagocytose , encapsulation ) , l' autre humoral ( coagulation , mélanisation , synthèse et libération de molécules antimicrobiennes ) . Par un ensemble de techniques complémentaires cytologiques , biochimiques et moléculaires , nous avons appréhendé la réponse immunitaire de l' isopode terrestre Armadillidium vulgare sain et infecté par Wolbachia [ bactéries endocellulaires , Gram ( - ) ] . Outre la détermination de la spécificité des fonctions cellulaires des différents types d' hémocytes , notre étude a abouti à la purification et à la caractérisation d' un peptide antibactérien riche en glycines , l' armadillidine ( 5259 Da ) dont l' activité est dirigée contre les Gram ( + ) . Des isoformes de ce peptide sont retrouvées uniquement dans la famille des Armadillididae ( crustacés ) . De plus , nous avons montré que le clivage du C-terminal de l' hémocyanine ( protéine majoritaire du plasma à rôle oxyphorique ) libérait in vitro un peptide ( 2932 Da ) capable d' inhiber la croissance du champignon pathogène Botrytis cinerea ; L' approche protéomique a permis d' identifier dans notre modèle un certain nombre de protéines intervenant dans les deux aspects de la réponse immunitaire des arthropodes . Le rôle de Wolbachia sur le fonctionnement du système immunitaire n' est pas clairement apparu , nous avons toutefois noté son action sur le cytosquelette des hémocytes . Parmi les molécules ainsi caractérisées , certaines pourraient présenter potentiellement un intérêt économique . Mots clés : Armadillidium vulgare - Immunité innée & 226;& 128;& 147; Hémocytes & 226;& 128;& 147; Peptides antimicrobiens & 226;& 128;& 147; Hémocyanine & 226;& 128;& 147; RP-HPLC & 226;& 128;& 147; Electrophorèse bidimensionnelle & 226;& 128;& 147; Microscopie électronique . |
Arbres syntaxiques
1: N° attribué par la bibliothèque
2: \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|
3: T H È S E pour l' obtention du grade de
4: DOCTEUR DE L' UNIVERSITÉ DE POITIERS FACULTÉ DES SCIENCES FONDAMENTALES ET
5: APPLIQUÉES
6: ( Diplôme National & 226;& 128;& 147; Arrêté du 25 avril 2002 )
7: Ecole Doctorale :
8: Ingénierie Chimique , Biologique et Géologique Secteur de Recherche :
9: Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie
10: Présentée par
11: Juline HERBINIÈRE
12: CONTRIBUTION À LA MISE EN ÉVIDENCE DES EFFECTEURS IMPLIQUÉS DANS L' IMMUNITÉ INNÉE
13: D' Armadillidium vulgare , CRUSTACÉ ISOPODE TERRESTRE INFECTÉ PAR UNE BACTÉRIE DU GENRE
14: Wolbachia .
15: Soutenue le 28 juin 2005 devant la Commission d' Examen
16: JURY
17: C . HÉTRU Directeur de Recherche , CNRS UPR 9022 , Strasbourg Rapporteur
18: M. SALZET Professeur , Université de Lille Rapporteur
19: T. BERGES Professeur , Université de Poitiers Examinateur
20: C . BRAQUART-VARNIER Maître de Conférences , Université de Poitiers Codirecteur de thèse
21: Y. HÉCHARD Maître de Conférences , Université de Poitiers Examinateur
22: G. MARTIN Directeur de Recherche , CNRS UMR 6556 , Poitiers Directeur de thèse
23: Sommaire
24: SOMMAIRE
25: INTRODUCTION GENERALE .......
26: 1
27: RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES .......
28: 4
29: I. LA RÉPONSE IMMUNITAIRE CHEZ LES CRUSTACÉS .......
30: 4
31: I.1 . Les hémocytes :
32: hématopoïèse et fonction des hémocytes .......
33: 5
34: I.2 . Les phénomènes de reconnaissance .......
35: 6
36: I.3 . La réponse cellulaire .......
37: 8
38: 3.1 . La phagocytose .......
39: 8
40: 3.2 . La formation des nodules et l' encapsulation .......
41: 9
42: I.4 . La réponse humorale ......
43: 10
44: 4.1 . La coagulation ......
45: 10
46: 4.2 . Activité phénoloxydase et mélanisation ......
47: 14
48: 4.3 . Le rôle de l' hémocyanine ......
49: 15
50: 4.4 . Les mécanismes de communication et de régulation de la réponse immunitaire ..
51: 16
52: 4.5 . Les facteurs antimicrobiens .....
53: 18
54: II . LES PEPTIDES ANTIMICROBIENS CHEZ LES ARTHROPODES .....
55: 20
56: II.1 . Classification des peptides antimicrobiens .....
57: 21
58: II.2 . Protéines présentant une activité antimicrobienne annexe .....
59: 27
60: 2.1 . L' hémocyanine .....
61: 27
62: 2.2 . La proppA .....
63: 28
64: II.3 . Mode d' action des peptides antibactériens .....
65: 28
66: 3.1 . Le modèle par formation de pores :
67: « Barel stave » .....
68: 29
69: 3.2 . Le modèle détergent :
70: « Carpet » .....
71: 29
72: 3.3 . Autres mécanismes .....
73: 30
74: II.4 . Régulation de la synthèse des peptides antimicrobiens .....
75: 30
76: 4.1 . Chez les insectes .....
77: 30
78: 4.2 . Chez les chélicérates .....
79: 32
80: 4.3 . Chez les crustacés .....
81: 34
82: MATERIELS ET METHODES .....
83: 37
84: I. MODÈLE BIOLOGIQUE ET ÉLEVAGE .....
85: 38
86: II . PRÉLÈVEMENT DE L' HÉMOLYMPHE .....
87: 40
88: III INJECTIONS EXPÉRIMENTALES DES ANIMAUX .....
89: 40
90: IV . TESTS D' ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE .....
91: 41
92: IV.1 Tests d' activité antibactérienne .....
93: 41
94: IV.2 . Tests d' activité antifongique .....
95: 43
96: IV.3 . Concentration minimale d' inhibition ( MIC ) .....
97: 46
98: V. APPROCHE PROTÉOMIQUE .....
99: 46
100: V.1 . Extraction des protéines .....
101: 46
102: 1.1 Des hémocytes .....
103: 46
104: 1.2 . Du plasma .....
105: 47
106: 1.3 . Des organes hématopoïétiques .....
107: 47
108: 1.4 . Des cæcums digestifs .....
109: 47
110: V.2 . Purification et analyses des protéines .....
111: 48
112: 2 . 1 .Sep -Pak .....
113: 48
114: 2.2 . RP-HPLC .....
115: 49
116: 2.3 . MALDI-TOF .....
117: 49
118: 2.4 . Séquençage par dégradation d' Edman .....
119: 50
120: 2.5 . Electro-spray ( ES-MS ) .....
121: 51
122: 2.6 . Gels 1-D .....
123: 51
124: 2.7 . Gels 2-D ......
125: 52
126: 2.8 . Analyses des spots de 2-D ......
127: 59
128: VI . APPROCHE GÉNOMIQUE .....
129: 60
130: VI.1 . Extraction des ARNs totaux .....
131: 60
132: VI.2 . RT-PCR .....
133: 61
134: VI.3 . Northern Blotting .....
135: 62
136: VI.4 . Clonage de différents ADNc .....
137: 63
138: IIV .
139: 5 . Construction d' une banque d' ADNc d' hémocytes d' Armadillidium vulgare
140: ......
141: 65
142: VII . APPROCHE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE .....
143: 66
144: VII .1 . Microscopie photonique .....
145: 66
146: VII .2 . Microscopie électronique à transmission ( MET ) .....
147: 66
148: VII3 .
149: Microscopie électronique à balayage ( MEB ) .....
150: 68
151: CHAPITRE I :
152: APPROCHE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE .....
153: 70
154: I. OBSERVATION DES HEMOCYTES EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE .....
155: 73
156: II . OBSERVATION DES HEMOCYTES EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION .....
157: 73
158: III . « FRAGILITE » DES HEMOCYTES INFECTES PAR Wolbachia .....
159: 77
160: IV . ASSIGNEMENT DE LA FONCTION DE PHAGOCYTOSE .....
161: 79
162: V. ASSIGNEMENT DE LA FONCTION D' ENCAPSULATION .....
163: 81
164: VI . OBSERVATION DES ORGANES HEMATOPOÏETIQUES .....
165: 85
166: VII . EVOLUTION DU TAUX D' HEMOCYTES CIRCULANTS .....
167: 93
168: VIII . CONCLUSION PERSPECTIVES .....
169: 98
170: CHAPITRE II :
171: ISOLEMENT ET CARACTERISATION DE L' ARMADILLIDINE .....
172: 101
173: I. DETECTION D' UNE ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DANS L' HEMOLYMPHE d' Armadillidium vulgare ....
174: 102
175: II . ISOLEMENT D' UN PEPTIDE ANTIBACTERIEN A PARTIR DES HEMOCYTES d' Armadillidium vulgare ....
176: 104
177: II.1 . Purification de l' armadillidine ....
178: 104
179: II.2 . Détermination de la structure primaire de l' armadillidine ....
180: 104
181: II.3 . Clonage de l' ADNc de l' armadillidine ....
182: 112
183: II. 4 . Spécificité de l' expression de l' armadillidine ....
184: 116
185: 4.1 . Spécificité tissulaire de l' armadillidine ....
186: 116
187: 4.2 . Spécificité zoologique de l' armadillidine ....
188: 117
189: II.5 Libération de l' armadillidine ....
190: 123
191: III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES ....
192: 126
193: CHAPITRE III .
194: LIBÉRATION D' UN PEPTIDE ANTIFONGIQUE PAR CLIVAGE DE L' HÉMOCYANINE
195: ....
196: 127
197: I. CLONAGE DE L' ADNC DE L' HÉMOCYANINE ....
198: 129
199: II . CLIVAGE DE L' EXTREMITÉ C TERMINALE ....
200: 132 I
201: I.1 . Acidification du plasma par du TFA 0 , 1 % ....
202: 133
203: II.2 . Acidification du plasma par du HCl 0 , 1M ....
204: 133
205: III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES ....
206: 140
207: CHAPITRE IV :
208: PROTÉINES IMPLIQUÉES DANS LE SYSTÈME IMMUNITAIRE :
209: APPROCHES
210: PROTÉOMIQUES ....
211: 147
212: I. ÉLECTROPHORÈSE 1-D ....
213: 149
214: I.1 . Hémocytes ....
215: 149
216: I.2 . Plasma ....
217: 150
218: I.3 . Autres tissus :
219: Organes hématopoïétiques et caecums digestifs ....
220: 150
221: II . ÉLECTROPHORÈSE 2-D ....
222: 152
223: II.1 Hémocytes ...
224: 155
225: 1.1 . Identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare
226: . ....
227: 155
228: Les protéines enzymatiques : ....
229: 157
230: Les protéines du cytosquelette : ....
231: 157
232: Protéines de réponse au stress : ....
233: 162
234: Réponse immunitaire : ....
235: 163
236: 1.2 . Identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia .
237: ....
238: 169
239: 1.3 . Identification des protéines plasmatiques d' Armadillidium vulgare
240: ....
241: 175
242: III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES ....
243: 178
244: CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES ....
245: 180
246: REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ....
247: 182
248: ANNEXES ....
249: 207
250: Introduction Générale
251: INTRODUCTION GENERALE
252: Au commencement des travaux présentés dans ce mémoire , aucune étude n' avait été réalisée sur le système immunitaire des isopodes terrestres .
253: Cette étude se justifiait notamment par le fait que dans la nature coexistent des populations d' Armadillidium vulgare dont la plupart des individus hébergent une bactérie endocellulaire Gram ( - ) du genre Wolbachia et des populations dont les individus ne sont pas infectés .
254: Cette présence bactérienne intrigante , expliquée en partie par des transferts horizontaux , nous a amené à nous questionner sur les performances du système immunitaire de l' hôte .
255: Chez le crustacé isopode terrestre Armadillidium vulgare ( plus communément appelé cloporte ) , Wolbachia a la capacité d' inverser les mâles génétiques en femelles fonctionnelles ( néofemelles ) qui transmettent le symbiote à leur descendance ( Martin et al. , 1973 ) .
256: Ainsi , le sex-ratio de la descendance est fortement biaisé vers les femelles , assurant à la bactérie une large propagation au sein des populations .
257: Seuls quelques ovocytes ( 10 à 20 % ) échappent à l' infection et assurent , par ce biais , la présence de mâles et la pérennité de la population .
258: Des transferts interspécifiques de la bactérie ( par injection ) dans des espèces phylétiquement voisines d' Armadillidium vulgare ( du même genre ou d' un genre de la famille des Armadillididae ) entraînent une modification physiologique des mâles infectés et leur féminisation externe
259: ( Juchault et al. , 1974 ) .
260: Au cours de ces infestations , l' implantation de la bactérie dans tous les tissus ( y compris dans les hémocytes ) est observée .
261: La présence de la bactérie dans les hémocytes , cellules spécifiques de l' immunité chez les crustacés , amène à deux questions : ( i ) Comment la bactérie pénètre t -elle à l' intérieur de ces cellules et comment se maintient -elle ? ( ii ) Les hémocytes servent -ils de vecteurs pour la dissémination de la bactérie dans tous les tissus ?
262: La féminisation complète des individus génétiquement mâles porteurs de Wolbachia implique qu' il n' existe pas de gènes liés au sexe .
263: L' existence de quelques individus intersexués stériles , avec des glandes androgènes hypertrophiées , dans les populations est du plus grand intérêt pour comprendre le mécanisme d' action de Wolbachia en tant que parasite du sexe :
264: l' inhibition de l' expression du gène codant l' hormone androgène suffit pour induire une physiologie femelle .
265: Dans cette association , l' hôte ne semble donc pas bénéficier de cette relation , on peut alors se demander pourquoi il n' élimine pas la bactérie ?
266: Est ce que Wolbachia échappe totalement au système immunitaire d' Armadillidium vulgare ?
267: Est -t-elle furtive ou inhibe -t-elle la réponse immunitaire ?
268: Le système immunitaire est -il parfaitement adapté pour reconnaître tous les types de déterminants antigéniques ?
269: Certains types de LPS ne seraient -ils pas reconnus ?
270: Il existe cependant des mécanismes naturels d' élimination de la bactérie car lors de transferts expérimentaux de Wolbachia d' Armadillidium vulgare chez certaines autres espèces d' isopodes terrestres
271: [ Armadillo officinalis ( Armadillidae ) , par exemple ] , la bactérie est incapable de se maintenir et de proliférer .
272: Afin de caractériser le système immunitaire d' Armadillidium vulgare , plusieurs approches ont été mises en place pour étudier ce système au niveau cellulaire et au niveau moléculaire .
273: Des observations en microscopie électronique , nous ont permis de caractériser les différents types d' hémocytes présents dans l' hémolymphe mais également de décrire les organes hématopoïétiques .
274: Puis , l' étude des protéines hémocytaires et plasmatiques , par une approche en RP-HPLC nous a conduit à l' isolement et la caractérisation de deux peptides antibactériens , l' un issu des hémocytes et l' autre du plasma .
275: Enfin , par une approche en électrophorèse bidimensionnelle , différentes protéines impliquées dans l' immunité innée ont pu être identifiées .
276: Quelles que soient les approches utilisées , ces travaux ont toujours été réalisés chez Armadillidium vulgare porteur ou non de Wolbachia .
277: La comparaison des résultats obtenus chez les deux types d' animaux a été effectuée pour mettre en évidence des différences au niveau de la réponse immunitaire , différences qui pourraient être imputables à la présence de la bactérie féminisante .
278: Ce manuscrit est organisé de la manière suivante :
279: Introduction générale
280: Rappel des connaissance sur la réponse immunitaire des crustacés décapodes et sur les peptides antibactériens d' arthropodes
281: Description des matériels et méthodes
282: & 239;& 128;& 160;Exposition des résultats et discussions en quatre chapitres intitulés :
283: Chapitre I :
284: Cellules impliquées dans la réponse immunitaire :
285: Approche histologique et cytologique
286: Chapitre II :
287: Isolement et caractérisation de l' armadillidine , peptide antibactérien issu des hémocytes .
288: Chapitre III :
289: Libération d' un peptide antifongique par clivage de l' hémocyanine
290: Chapitre IV :
291: Recherche d' effecteurs impliqués dans le système immunitaire :
292: Approche protéomique
293: Conclusion générale
294: Références bibliographiques
295: & 239;& 128;& 160;Annexes
296: I. Wolbachia chez les arthropodes et les nématodes
297: II . Nombre d' hémocytes circulants chez Armadillidium vulgare porteurs ou non de Wolbachia
298: III . Comparaison des séquences protéiques d' hémocyanines et de prophénoloxydases chez différents crustacés .
299: Rappels bibliographiques
300: I. LA RÉPONSE IMMUNITAIRE CHEZ LES CRUSTACÉS
301: Pour lutter contre les agents pathogènes , tels que les bactéries , les champignons ou encore les virus , les êtres vivants ont mis en place deux grands types de réponse immunitaire :
302: une réponse immunitaire acquise et une réponse immunitaire innée ( Hoebe et al. , 2004 ) .
303: L' immunité innée est un mécanisme de défense phylogénétiquement plus ancien , qui se trouve chez tous les organismes pluricellulaires ( Hoffmann et al. , 1999 ; Salzet , 2001 ) , y compris chez les vertébrés .
304: Elle constitue un système de défense activable très rapidement ce qui explique qu' elle soit encore qualifiée de réponse immédiate .
305: Elle dépend de la présence de récepteurs , principalement présents dans les cellules immunitaires et capables de reconnaître les déterminants antigéniques des micro-organismes .
306: L' immunité acquise , ou réponse immunitaire adaptative et à mémoire , ne se manifeste que chez les vertébrés et met en jeu des mécanismes beaucoup plus complexes telle que la mémoire immunologique ( création d' un large répertoire de médiateurs de reconnaissance antigénique ) .
307: Bien que les invertébrés ne présentent pas d' immunité acquise , de nombreuses études sur leur immunité innée ont montré qu' elle est basée sur un système de défense complexe , qui met en jeu des réactions cellulaires et humorales coordonnées .
308: Chez les arthropodes , la cuticule constitue une première barrière physique contre les invasions de micro-organismes et les parasites potentiellement pathogènes présents dans le milieu aquatique ou terrestre .
309: Cependant , suite à une blessure ou lors de la mue , cette barrière n' est plus étanche et les micro-organismes envahissants entrent directement dans la circulation générale puisque le système circulatoire des arthropodes est ouvert .
310: Ainsi , les arthropodes ont développé une réponse immunitaire innée adaptée , capable de surmonter les infections , et qui implique les constituants de l' hémolymphe .
311: Les hémocytes sont les cellules circulantes engagées dans la réponse immunitaire des crustacés et de l' ensemble des arthropodes .
312: L' activation de ces cellules par des molécules de reconnaissances du non soi conduit à deux types de réponses intimement liées :
313: - d' une part , des réactions purement cellulaires , telles que la phagocytose , la formation de nodules et l' encapsulation des micro-organismes pathogènes ou des corps étrangers .
314: - d' autre part , une libération dans le plasma de molécules intervenant dans différentes réactions immunitaires telles que la mélanisation et la coagulation localisée .
315: I.1 . Les hémocytes :
316: hématopoïèse et fonction des hémocytes
317: Les hémocytes des crustacés , comme ceux des autres invertébrés , sont produits dans des tissus spécialisés :
318: les organes hématopoïétiques .
319: La localisation et la structure de ces organes sont très variables même au sein de groupes taxonomiques proches .
320: Ainsi , chez les homards , les crabes ou les écrevisses , ces organes prennent la forme d' une grappe de lobules couvrant l' estomac broyeur ou le coeur ( Ghiretti-Magaldi et al. , 1977 ; Johnson , 1980 ) .
321: Chez la crevette pénaeide , ils sont formés par une extension de l' artère ophtalmique ( Martin et al. , 1987 ) .
322: Quelle que soit la forme présentée , les organes hématopoïétiques produisent tous trois types d' hémocytes dont le lignage n' est pas clairement établi .
323: Les organes hématopoïétiques sont donc le siège de la prolifération et de la maturation des futurs hémocytes .
324: Une fois maturés , les hémocytes peuvent être libérés dans la circulation générale .
325: Cette libération a lieu principalement lors des mues et lors d' infections bactériennes , deux processus qui engendrent une diminution importante du taux d' hémocytes circulants ( Smith et Ratcliffe , 1980 ; Persson et al. , 1987 ; Smith et Johnston , 1992 ) .
326: Chez les crustacés , trois types d' hémocytes morphologiquement différents ont été identifiés dans la circulation générale ( Bauchau , 1980 ) .
327: Ces populations d' hémocytes ont été décrites chez les décapodes ( Söderhäll et Smith , 1983 ; Vazquez et al. , 1997 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) mais aussi chez l' isopode terrestre Porcellio dilatatus ( Coutant , 1977 ) .
328: Ainsi , la cytologie permet de distinguer les hémocytes hyalins , dépourvus de granules , les hémocytes semi-granulaires pourvus de petits granules en nombre variable , et les hémocytes granulaires pourvus de gros granules en grand nombre .
329: Concernant la fonction de ces hémocytes , chez les crevettes , la phagocytose est effectuée par les hémocytes granulaires et semi-granulaires , tandis que les cellules hyalines jouent un rôle dans la coagulation ( Hose et al. , 1990 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) .
330: En effet , les cellules hyalines comportent chez ces espèces moins de protéines que les 2 types granulaires et notamment moins de protéines lysosomales ( Hose et al. , 1990 ; Lanz et al. , 1993 ) .
331: Des études similaires faites chez le crabe et les écrevisses ont montré que les hémocytes hyalins présentent également moins de protéines que les deux autres types cellulaires ( Johansson , 1999 ) .
332: Mais contrairement aux crevettes , ce sont les hémocytes hyalins qui sont principalement impliqués dans la phagocytose , même si les hémocytes semi-granulaires peuvent également jouer ce rôle ( Thörnqvist et al. , 1994 ) .
333: De façon plus consécutive , le rôle exact des cellules hyalines n' est pas établi avec précisions pour toutes les espèces .
334: Les hémocytes granulaires et semi- granulaires , synthétisent puis stockent dans leurs granules les protéines du système immunitaire , comme les agglutinines , les péroxinectines , des enzymes cytolytiques , les enzymes du système prophénoloxydase , les peptides antibactériens ...
335: Ces protéines sont alors libérées de façon coordonnée dans l' hémolymphe ou sur le site de l' infection ou de la blessure ( Smith et Söderhäll , 1983 ; Söderhäll et al. , 1985 ; Söderhäll et al. , 1986 ; Kobayashi et al. , 1990 ; Johansson et al. , 2000 ; Munoz et al. , 2002 ) .
336: I.2 . Les phénomènes de reconnaissance
337: Quels que soient les organismes , l' activation de la réponse immunitaire nécessite une reconnaissance des pathogènes infectants .
338: Les crustacés sont dépourvus d' immunoglobulines , mais ils sont cependant capables de répondre à des pathogènes en reconnaissant les composants de leurs membranes ou de leurs parois cellulaires , tels que les lipopolysaccharides ( LPS ) des bactéries Gram ( - ) , les peptidoglycanes des bactéries Gram ( + ) ou les & 206;& 134; 1 , 3- glucanes des champignons .
339: Les molécules liant spécifiquement ces motifs ont été isolées chez de nombreux arthropodes .
340: Ces molécules , dont certaines ont été nommées molécules de reconnaissance de motif ( PRP : Pattern Recognition Protein ) , ont été décrites sous forme soluble dans la circulation ou associées aux membranes hémocytaires .
341: Elles possèdent d' une part des propriétés permettant l' activation du système prophénoloxydase ( ProPO ) qui conduit à la mélanisation
342: ( Sritunyalucksana et Söderhäll , 2000 ) et , d' autre part , elles jouent le rôle d' opsonine permettant l' augmentation du taux de phagocytose ( Duvic et Söderhäll , 1992 , 1993 ; Thörnqvist et al. , 1994 ) .
343: Ces molécules ont été isolées dans le plasma de nombreux crustacés et clonées soit à partir de l' hépatopancréas comme chez Penaeus stylorostris stylorostris ( Roux et al. , 2002 ) et Penaeus vannamei ( Romo-Figueroa et al. , 2004 ) , soit à partir des hémocytes comme chez Pacifastacus leniusculus ( Lee et al. , 2000 ) et Penaeus monodon
344: ( Sritunyalucksana et al. , 2002 ) .
345: Les & 206;& 134; GBP sont solubles et peuvent se fixer sur des motifs de la paroi des champignons , les complexes ainsi formés se lient à un récepteur des membranes hémocytaires pour activer la réponse immunitaire ( Duvic et Söderhäll , 1992 , 1993 ) .
346: De plus , une protéine masquerade-like , identifiée comme une PRP se liant spécifiquement aux LPS et aux & 206;& 134; GBP , a été caractérisée chez Pacifastacus leniusculus ( Lee et Söderhäll , 2001 ) .
347: Cette protéine est une opsonine qui possède un motif d' adhésion cellulaire .
348: Les lectines / agglutinines sont des glycoprotéines ne possédant généralement pas d' activité catalytique et qui ont la propriété de se lier aux sucres ( Marquez et Barracco , 2000 ) .
349: Elles peuvent donc se lier aux cellules et entraîner un phénomène d' agglutination .
350: Chez les crustacés , de nombreuses lectines sont capables de se lier à l' acide sialique .
351: Elles ont notamment été mises en évidence dans le plasma du homard Homarus americanus ( Abel et al. , 1984 ) , du crabe Cancer antennarius ( Ravindranath et al. , 1985 ) , des crevettes Penaeus monodon ( Ratanapo et Chulavatnatol , 1990 ) et Penaeus japonicus ( Rodriguez et al. , 1995 ) .
352: Chez la crevette d' eau douce Macrobrachium rosenbergii , une lectine a été localisée au niveau des membranes hémocytaires , contrairement aux autres lectines présentées
353: ( Vazquez et al. , 1997b ) .
354: Certaines de ces lectines circulantes se lient spécifiquement aux LPS , c' est le cas chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus ( Kopacek et al. , 1993a , b ) et chez la crevette Penaeus californiensis ( Vargas-Albores et al. , 1993 ) .
355: L' agglutination résulterait de la liaison des cellules reconnues par des sites de liaisons multiples présents dans les lectines ( Gillespie et al. , 1997 ; pour revue ) .
356: I.3 . La réponse cellulaire
357: 3.1 . La phagocytose
358: La phagocytose est un processus qui contribue à l' élimination de particules étrangères de petite taille comme les bactéries .
359: Elle comporte plusieurs étapes successives incluant la reconnaissance , l' attachement , la formation de pseudopodes , l' ingestion , l' assemblage des phagosomes et la fusion avec les lysosomes .
360: Cette dernière étape conduit à la lyse des organismes phagocytés sous l' action des multiples enzymes contenus dans les lysosomes ( Bayne , 1990 pour revue ) .
361: Les processus de phagocytose font également intervenir des mécanismes dépendant de l' oxygène qui génèrent des ions superoxydes et de l' oxyde nitrique .
362: L' étude du métabolisme oxydatif chez Carcinus maenas ( Bell et Smith , 1993 ) , Penaeus monodon ( Song et Hsieh , 1994 ) , Penaeus japonicus ( Bachère et al. , 1995 ) et Macrobrachium rosenbergii ( Sierra et al. , 2005 ) a montré que les hémocytes de toutes ces espèces produisaient des anions superoxydes in vitro .
363: Chez Carcinus maenas , seuls les hémocytes hyalins produisent des résidus oxydants .
364: Chez les vertébrés , les cellules phagocytaires produisent , lors du choc respiratoire , différents agents oxydants par l' intermédiaire de leur
365: NADPH-oxydase membranaire .
366: Les ions ainsi formés présentent un fort pouvoir microbicide et permettent la lyse des microorganismes envahissants ( Chanock et al. , 1994 ) .
367: Chez Macrobrachium rosenbergii , lors des phénomènes de phagocytose , qui requièrent des mécanismes de reconnaissance des sucres ( Vazquez et al. , 1997b ) , ce choc respiratoire est fortement activé par les lectines selon un mécanisme dépendant des NADPH .
368: Les radicaux libres ainsi générés agiraient comme des agents cytotoxiques ou microbicides ( Sierra et al. , 2005 ) .
369: Chez les crustacés , les types d' hémocytes impliqués dans ce processus dépendent des espèces considérées .
370: Chez le crabe Carcinus maenas et l' écrevisse Pacifastacus leniusculus , les hémocytes hyalins sont les principales cellules phagocytaires .
371: Néanmoins des observations chez l' écrevisse ont montré que les hémocytes semi-granulaires pouvaient présenter , d' une manière très limitée , la capacité à phagocyter ( Söderhäll et al. , 1986 ) .
372: Par contre , chez les crevettes
373: Sicyonia ingentis et Peneaus paulensis paulensis , la phagocytose serait principalement effectuée par les hémocytes semi-granulaires , et dans une moindre mesure par les hémocytes granulaires ( Hose et Martin , 1989 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) .
374: En effet , ces deux types cellulaires présentent des enzymes lysosomiales , alors que les hémocytes hyalins en sont dépourvus ( Gargioni et Barracco , 1998 ) .
375: 3.2 . La formation des nodules et l' encapsulation
376: Lorsque les bactéries sont trop nombreuses ou que le corps étranger est trop gros pour être phagocyté , l' organisme met en place une réaction adaptée qui se traduit par la formation de nodules ou par l' encapsulation .
377: Les nodules sont des agrégats pluricellulaires d' hémocytes capables de renfermer , malgré leur petite taille , un nombre important de bactéries .
378: De tels nodules peuvent adhérer aux tissus et les plus grands peuvent alors être encapsulés .
379: Chez les crustacés , la première description de la formation de nodules a été donnée chez les crabes
380: ( Smith et Ratcliffe , 1980 ; White et Ratcliffe , 1982 ) pour lesquels les nodules sont principalement localisés dans les branchies et les sinus de l' hépatopancréas .
381: Chez le crabe
382: Carcinus maenas , ce sont les hémocytes granulaires qui s' agrègent pour former le nodule , leur dégranulation a pu également être observée ( Smith et Ratcliffe , 1980 ) .
383: Chez le homard Homarus americanus et chez la crevette Sicyonia ingentis , les trois types d' hémocytes participent à la formation des nodules .
384: Toutefois , les hémocytes semi-granulaires semblent jouer un rôle prépondérant , ils sont situés au centre des nodules , présentent une diminution de leur contenu en granules et semblent jouer un rôle dans la phagocytose des bactéries emprisonnées .
385: Lorsqu' ils atteignent une taille suffisante , ces nodules sont alors retenus dans les vaisseaux des branchies par le système de filtration ( néphrocytes ) ( Martin et al. , 1998 ) .
386: La présence de corps étranger de taille plus importante qu' une bactérie conduit à la formation d' une capsule d' hémocytes formée de couches concentriques autour des intrus .
387: Les enzymes contenues dans les granules sont alors libérées à la surface des particules exogènes encapsulées et des zones de mélanisation sont observables au niveau des capsules .
388: Chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus ( Kobayashi et al. , 1990 ) et chez la crevette Sicyonia ingentis ( Hose et Martin , 1989 ) , les cellules engagées dans la formation des nodules et dans l' encapsulation sont principalement les hémocytes semi-granulaires qui peuvent stimuler les cascades de mélanisation .
389: Chez l' écrevisse , les péroxinectines ( protéines d' adhésion cellulaire ) , libérées par les deux types d' hémocytes granulaires , peuvent induire le processus d' encapsulation in vitro ( Kobayashi et al. , 1990 ) .
390: Le phénomène d' encapsulation a également été décrit chez l' isopode terrestre Porcellio dilatatus ( Coutant , 1977 ) .
391: I.4 . La réponse humorale
392: 4.1 . La coagulation
393: Chez les vertébrés comme chez les invertébrés , le système de coagulation est une réaction importante qui permet d' éviter les pertes de sang lors des blessures .
394: Figure 1 :
395: Schéma de la réaction de coagulation médiée par la transglutaminase chez l' écrevisse et du rôle potentiel de l' & 206;& 133; 2- macroglobuline .
396: Les protéines de coagulation sont présentes dans le plasma sous forme dimérique ( 2
397: X 210 kDa ) liées par un pont disulfure ( S- S ) .
398: Elles s' associent entre elles sous l' action d' une transglutaminase pour former des agrégats de coagulation ( d' après Söderhäll et Söderhäll. , 2001 ) .
399: Différentes protéines de coagulation ont été partiellement caractérisées chez les crustacés décapodes tels que Penaeus monodon ( Yeh et al. , 1998 ; Yeh et al. , 1999 ) , Homarus americanus
400: ( Fuller et Doolittle , 1971a ) , Panulirus interruptus ( Fuller et Doolittle , 1971b ; Doolittle et Riley , 1990 ) , Pacifastacus leniusculus
401: ( Kopacek et al. , 1993a , b ) et chez Ibacus ciliatus ( Komastu et Ando , 1998 ) .
402: Chez l' écrevisse , les protéines de coagulation sont des glycoprotéines de masse moléculaire élevée ( > 200 kDa ) qui sont présentes , dans le plasma , sous forme monomérique ou dimérique ( Hall et Söderhäll , 1994 ; Yeh et al. , 1999 ) .
403: Ces protéines sont produites dans l' hépatopancréas des animaux et sont libérées dans la circulation générale où leur concentration peut être élevée ( Hall et al. , 1999 ) .
404: Elles présentent des homologies avec les vitellogénines , protéines qui ne semblent pas impliquées dans les phénomènes de coagulation ( Sappington et Raikhel , 1997 ) mais qui contribuent à la maturation des ovocytes chez les femelles et les néofemelles .
405: Les protéines de coagulation sont elles présentes à la fois chez les mâles et les femelles .
406: Chez l' écrevisse où le mécanisme de coagulation est le mieux décrit ( Figure 1 ) , la coagulation dans le plasma se traduit par la polymérisation des homodimères de protéines de coagulation .
407: Cette réaction est catalysée par une transglutaminase dépendante du Ca 2 + .
408: Cette enzyme , principalement produite dans les hémocytes ( Wang et al. , 2001 ) , est libérée dans le plasma suite à une blessure ou une infection microbienne pour former de longues chaînes ou des agrégats de protéines de coagulation ( Kopacek et al. , 1993a ) .
409: Cette enzyme crée alors des liaisons covalentes entre les chaînes latérales d' une lysine et d' une glutamine portées par la protéine de coagulation ( Kopacek et al. , 1993a ; Hall et al. , 1999 ) .
410: Les & 206;& 133; 2- macroglobulines d' écrevisses présentent des résidus lysine et glutamine libres , qui sont probablement utilisés par les transglutaminases pour lier les & 206;& 133; 2- macroglobulines ( inhibiteur de protéases ) aux protéines de coagulation .
411: La présence des & 206;& 133; 2- macroglobulines dans les agrégats de coagulation permettrait alors d' inhiber l' action des protéases produites par les micro-organismes pathogènes ( Hall et Söderhäll , 1994 ) .
412: Figure 2 :
413: Schéma du système prophénoloxydase ( ProPO ) chez l' écrevisse .
414: Les signatures moléculaires ( en vert ) des microorganismes infectants sont reconnues et se lient aux PRP ( en orange ) .
415: Les complexes sont reconnus par des récepteurs membranaires situés sur la membrane des hémocytes , la cascade de signalisation est alors activée .
416: Les enzymes du système ProPO ( en rouge ) contenues dans les granules sont libérées dans l' hémolymphe et sont activées pour conduire à la formation de mélanine .
417: Lors de l' activation , d' autres protéines sont activées , notamment les facteurs d' adhésion cellulaire ( péroxynectine , masquerade , en jaune ) mais aussi les inhibiteurs des sérines protéases ( pacifastine et & 206;& 133; 2- macroglobuline en bleu ) qui régulent la cascade de mélanisation ( d' après
418: Söderhäll et Söderhäll , 2001 ) .
419: 4.2 . Activité phénoloxydase et mélanisation :
420: Le système Prophénoloxydase
421: ( ProPO )
422: Chez les crustacés , et plus largement chez les arthropodes , après des blessures ou des infections , une pigmentation sombre apparaît progressivement au niveau des lésions .
423: Ce phénomène est appelé mélanisation .
424: Chez les arthropodes , la voie de synthèse de la mélanine est impliquée aussi bien dans les processus de sclérose et de cicatrisation des blessures que dans les réactions de défense ( au niveau des nodules et des capsules en formation ) contre les microorganismes envahissant l' hémolymphe ( Söderhäll , 1982 ; Ratcliffe et al. , 1985 ; Sugumaran , 1996 ) .
425: La formation de mélanine est directement associée à l' activation du système prophénoloxydase ( ProPO ) qui met en jeu une oxydoréductase , nommée phénoloxidase ( PO ) ( Figure 2 ) .
426: Cette enzyme , liant le cuivre , catalyse à la fois l' o-hydroxylation des monophénols et l' oxydation des phénols en quinones
427: ( Sugumaran , 1996 ) .
428: La PO est la dernière enzyme du système ProPO et est présente chez les arthropodes et de nombreux invertébrés ( Ashida , 1990 ; Söderhäll et al. , 1996 ) .
429: L' activation de cette cascade ProPO est induite par de très faibles quantités de déterminants antigéniques microbiens ( Söderhäll , 1982 ; Sugumaran et Kanost , 1993 ) .
430: Ainsi , chez l' écrevisse , chez laquelle le système ProPO est le mieux caractérisé , la reconnaissance des & 206;& 134; 1 , 3- glucanes par les & 206;& 134;GBP conduit à la libération dans le plasma de toutes les enzymes du système ProPO stockées sous une forme inactive dans les granules des hémocytes granulaires ( Johansson et Söderhäll , 1985 ) et dans une moindre mesure dans les hémocytes semi- granulaires ( Cerenius et Söderhäll , 2004 ) .
431: La cascade de sérine protéases est activée et permet ensuite l' activation d' une autre sérine protéase , la prophénoloxidase activating activating protein ( ppA ) ( Wang et al. , 2001 ) qui va alors activer la dernière enzyme :
432: la PO .
433: Récemment , une sérine protéase du type masquerade-like a été isolée chez Pacifastacus leniusculus .
434: Cette protéine possède un domaine de liaison aux bactéries ( Lee et Söderhäll , 2001 ) , aux levures mais également aux hémocytes
435: ( Huang et al. , 2000 ) .
436: La catalyse des phénols en présence d' oxygène par la PO produit de nombreux intermédiaires toxiques ( quinones fortement réactives ) .
437: C' est pourquoi , ce système ProPO doit être contrôlé et régulé pour ne pas léser les cellules de l' animal .
438: Le premier niveau de contrôle a lieu dans le système ProPO lui-même qui nécessite un clivage enzymatique pour libérer des enzymes actives .
439: Afin d' éviter une activation prématurée ou excessive du système ProPO , la présence d' inhibiteurs de protéases constitue un deuxième niveau de contrôle .
440: Chez l' écrevisse , certaines de ces protéines ont été isolées et leurs mécanismes de régulation du système ProPO commencent à être mieux compris .
441: Par exemple , la pacifastine , inhibitrice de la ppA , est une protéine hétérodimérique ( 155 kDa ) qui possède trois lobes de type transferrine ( un lobe peut comporter plusieurs domaines ) et une chaîne légère ( 44 kDa ) qui est la sous-unité inhibitrice composée de 9 domaines inhibiteurs riches en cystéines ( Liang et al. , 1997 ) .
442: Ces domaines sont homologues de trois inhibiteurs de protéases ( de faibles masses moléculaires ) isolés chez Locusta migratoria ( Kellenberger et al. , 1995 ) .
443: Différents domaines pourraient être des inhibiteurs spécifiques de différentes protéases .
444: Il existe d' autres inhibiteurs de protéases dans le plasma des crustacés qui présentent des capacités à réduire l' activité ( 1 ) de la ppA tels que les & 206;& 133;- macroglobulines ( Spycher et al. , 1987 ; Hergennahn et al. , 1988 ; Stöcker et al. , 1991 ; Gollas-Galvan et al. , 2003 ; Rattanachai et al. , 2004 ) ou les serpines ( Liang et Söderhäll , 1995 ) , ( 2 ) des sérine protéases de manière non ciblée ( Johansson et al. , 1994 ; Liang et Söderhäll , 1995 ) .
445: 4.3 . Le rôle de l' hémocyanine
446: Chez les arthropodes et a fortiori chez les crustacés , l' hémocyanine est une grosse protéine multimérique qui possède deux sites de liaison au cuivre et qui a pour rôle principal de transporter l' oxygène dans l' hémolymphe .
447: L' hémocyanine est une protéine produite dans l' hépatopancréas et libérée dans le plasma pour assurer rôle de transporteur d' oxygène qui ne semble cependant pas être son unique fonction .
448: En effet des découvertes récentes suggèrent que l' hémocyanine serait impliquée dans la défense contre les parasites et dans la cicatrisation .
449: Chez les arthropodes , les hémocyanines sont très proches des PO ( d' un point de vue structural et fonctionnel ) puisqu' il a été montré qu' elles pouvaient produire une activité PO sur des substrats o-diphénoliques suite à différents traitement tels qu' une exposition aux détergents ou aux sels ( Zlateva et al. , 1996 ; Decker et al. , 2001 ; Pless et al. , 2003 ) .
450: Récemment , l' activité PO de l' hémocyanine d' une crevette a été produite in vitro par l' ajout de & 206;& 134; 1 , 3- glucanes et de lysats hémocytaires ( Adachi et al. , 2003 ) .
451: Ces premiers résultats semblent indiquer que l' hémocyanine pourrait participer à la mélanisation des microbes .
452: 4.4 . Les mécanismes de communication et de régulation de la réponse immunitaire
453: Les réactions cellulaires et par voie de fait la réponse humorale sont modulées par des molécules capables d' adhérer à la surface des cellules immunitaires .
454: Les travaux réalisés sur l' écrevisse Pacifastacus leniusculus par l' équipe de Söderhäll ont permis de relier les différents mécanismes observés .
455: Ainsi , des molécules de communication cellulaire impliquées dans l' activation et la coordination des différents éléments de la réponse immunitaire ont pu être identifiées .
456: Comme nous l' avons vu précédemment , lors d' infections microbiennes , les déterminants antigéniques polysaccharidiques sont reconnus par des protéines de reconnaissance , qui sont considérées comme des protéines de communication cellulaire ( Söderhäll et Häll , 1984 ) .
457: Chez Pacifastacus leniusculus , deux de ces protéines ont été caractérisées , une & 206;& 134; GBP ( Duvic et Söderhäll , 1990 ; Cerenius . et al. , 1994 ) et une péroxynectine ( Johansson et Söderhäll , 1988 ; Johansson et al. , 1995 ) .
458: La protéine de reconnaissance la mieux caractérisée est la & 206;& 134; GBP qui en présence de & 206;& 134;- glucanes vient s' adhérer à la membrane des hémocytes , pour stimuler les cellules hémocytaires ( Barracco et al. , 1991 ; Thörnqvist et al. , 1994 ) .
459: Chez l' écrevisse , la & 206;& 134; GBP contient un motif RGD , également caractéristique des molécules d' adhésion cellulaire des vertébrés permettant leur liaison aux intégrines ( Sonnenberg , 1993 ) .
460: La liaison du complexe ( & 206;& 134;
461: GBP / microbe ) au récepteur au niveau de ce motif n' a toutefois pas été démontrée .
462: La péroxynectine présente à la fois des propriétés d' adhésion cellulaire ( Johansson et Söderhäll , 1988 ) et une activité péroxydasique ( Johansson et al. , 1995 ) .
463: La péroxynectine possède un motif conservé KDG qui est connu pour lier les ligands du type « intégrine-like » .
464: Dans les hémocytes de Pacifastacus leniusculus , une intégrine & 206;& 134; a été caractérisée ( Holmblad et Söderhäll , 1997 ) .
465: Lors de tests préliminaires en ELISA , Johansson et collaborateurs ( 1999 ) ont montré que cette intégrine est capable de se lier à la péroxynectine .
466: Le complexe enzymatique NAPDH oxydase lié à la membrane plasmique des hémocytes produit à partir de l' oxygène moléculaire , des ions superoxydes O2- qui sont utilisés par la SOD extracellulaire pour produire du peroxyde d' hydrogène ( H2O2 . ) .
467: Ce peroxyde est réutilisé par la péroxinectine pour produire des composés , comme l' acide hypochloreux , qui sont toxiques pour les microorganismes envahisseurs ( Figure 3 ) .
468: Certains microbes ayant à leur surface une SOD ou une catalase
469: ( Thörnqvist et Söderhäll , 1997 ) peuvent réduire de façon efficace le système précédemment décrit .
470: Figure 3 :
471: Modèle d' interaction entre les péroxynectines , les superoxydes dismutases ( EC- SOD ) et les intégrines sur le site d' infection microbien chez l' écrevisse .
472: Les cellules hémocytaires sont attachées aux microorganismes par l' intermédiaire de leur recepteur intégrine et de la péroxynectine .
473: Le complexe enzymatique NADPH-oxydase produit des ions superoxyde O2- qui sont utilisés par la SOD extracellulaire pour produire du peroxyde d' hydrogène H2O2 ;
474: ce composé est utilisé par la péroxynectine pour produire de l' acide hypochloreux HOCl , qui est toxique pour les micro-organismes envahissants ( d' après Söderhäll et Söderhäll , 2001 ) .
475: 4.5 . Les facteurs antimicrobiens
476: Chez les crustacés , la contribution des peptides antibactériens dans les mécanismes de défense a été , pendant longtemps , uniquement suspectée .
477: En effet , des activités antibactériennes avaient été observées dans le plasma ( Stewart et Zwicker , 1972 ) et dans l' hépatopancréas ( Mori et Stewart , 1978 ) de Homarus americanus .
478: Par contre , l' absence d' activité dans le plasma du crabe Carcinus maenas , même après une infection bactérienne avait amené certains auteurs ( White et al. , 1985 ) à suggérer que chez les crustacés , l' élimination des organismes pathogènes du plasma était plus probablement réalisée par phagocytose que par l' action de facteurs antimicrobiens présents dans le plasma .
479: Cependant , Chisholm et Smith ( 1992 ) ont montré que les activités antimicrobiennes trouvées dans les lysats des hémocytes de Carcinus maenas n' étaient pas dues aux agglutinines ( facteurs de coagulation ) , ni associées au système de la prophénoloxydase ( ProPO ) , ce qui renforça l' idée de l' existence de facteurs antibactériens .
480: Des observations similaires ont été faites chez de nombreuses autres espèces de crustacés , et dans ces dernières années , différents peptides antibactériens ( dont l' un de 11 , 5 kDa ) ont été extraits des hémocytes des crabes Carcinus maenas ( Schnapp et al. , 1996 ) et Callinectes sapidus ( Khoo et al. , 1999 ) .
481: Toutefois , la caractérisation de ces peptides a été réalisée de façon partielle .
482: Par contre , une famille de peptides à activité antifongique et antibactérienne a été isolée dans les hémocytes de la crevette Penaeus vannamei , et nommée pénaeidine ( Destoumieux et al. , 1997 ) .
483: Ainsi en 2001 , au début de nos travaux , seules les pénaedines avaient été caractérisées .
484: Aujourd'hui , la recherche de peptide antibactériens chez les crustacés a conduit à l' isolement de différents peptides .
485: Les pénaeidines ont été retrouvées dans toutes les espèces de crevettes testées [ Litopenaeus setiferus ( Gross et al. , 2001 ) , Penaeus japonicus ( Rojtinnakorn et al. , 2002 ) , Peneaus monodon ( Supungul et al. , 2002 ) , Litopenaeus stylirostris ( Munoz et al. , 2004 ) , Fenneropenaeus chinensis ( Kang et al. , 2004 ) et Litopenaeus setiferus ( Cuthbertson et al. , 2004 ) ] , et différentes classes de cette famille de peptides antibactériens ont été caractérisées .
486: Des homologues du peptide de 11 , 5 kDa isolé précédemment chez Carcinus maenas ont également été caractérisés chez deux espèces de crevettes , Penaeus vannamei et Litopenaeus setiferus ( Barlett et al. , 2002 ) .
487: Récemment , un peptide antimicrobien nommé ALF ( anti-lipopolysaccharide factor ) a été caractérisé chez Penaeus modon ( Somboonwiwat et al. , 2005 ) .
488: Ce peptide , homologue de l' ALF caractérisé chez la limule ( Morita et al. , 1985 ) présente la particularité de se lier au LPS .
489: Chez la limule , la liaison de l' ALF au LPS inhibe la cascade de dégranulation des hémocytes .
490: Chez la crevette , l' ALF présente un spectre d' activité très large [ bactéries Gram ( - ) , bactéries Gram ( + ) et champignons ] .
491: Toutes ces études ont été principalement menées sur des espèces qui présentent un intérêt économique dans le domaine de l' aquaculture :
492: en effet , l' isolement de peptides antibactériens efficaces contre des pathogènes des crevettes pénaeides faciliterait la lutte contre les épidémies dans les élevages .
493: Tous les peptides antimicrobiens décrits précédemment ont été isolés dans les hémocytes de différentes espèces .
494: Toutefois , ces cellules ne sont pas l' unique source de peptides antimicrobiens chez les crustacés .
495: En effet , chez les crevettes Penaeus vannamei et Penaeus stylorostris stylorostris et chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus , des peptides antibactériens ont été isolés à partir du clivage de l' hémocyanine circulante ( Destoumieux-Garzon et al. , 2001 ; Lee et al. , 2003 ) .
496: Chez Pacifastacus lenisculus , il semble que la libération de ces peptides soit générée par l' action d' une cystéine protéase contenue dans les hémocytes et libérée dans le plasma suite à une induction de la réponse immunitaire ( Lee . et al. , 2003 ) .
497: Enfin , l' hémocyanine possède également des propriétés antivirales ( Zhang et al. , 2004 ) .
498: Chez les invertébrés , les lysozymes ont été décrits comme des composants du système immunitaire , fonctionnant comme des protéines antimicrobiennes ( Yu et al. , 2002 ; pour revue ) .
499: Chez les crustacés , l' activité de ces lysozymes a été montrée chez Artemia franciscina ( Hultmark , 1996 ) et Penaeus vannamei ( Sotelo-Mundo et al. , 2003 ) .
500: II . LES PEPTIDES ANTIMICROBIENS CHEZ LES ARTHROPODES
501: L' étude des peptides antibactériens a réellement débuté dans les années 1980 , quand l' équipe de Boman injecta de faibles doses de germes pathogènes à des pupes de Hyalophora cecropia ( Insecte , lépidoptère ) et observa , en retour , une synthèse rapide de plusieurs peptides ( Steiner et al. , 1981 ) .
502: Suite à ces travaux , de nombreux peptides furent isolés et caractérisés , notamment chez d' autre lépidoptères et chez la drosophile ( Insecte , diptère ) .
503: Par la suite , la recherche de peptides antibactériens s' est généralisée non seulement à l' ensemble des arthropodes , mais également chez d' autres invertébrés ( Hetru et al. , 1994 ) , les vertébrés ( Boman , 1995 ) et les plantes ( Broakaert et al. , 1995 ) .
504: Actuellement , plus de 880 peptides antimicrobiens ont été isolés dans divers tissus et types cellulaires de nombreux invertébrés , vertébrés , plantes et même chez des bactéries ( Zasloff , 2002 ; Ganz , 2003 ; Lehrer , 2004 ) .
505: II.1 . Classification des peptides antimicrobiens
506: La caractérisation de ces peptides chez ces nombreuses espèces d' invertébrés a permis de mettre en évidence des caractéristiques communes à l' ensemble de ces molécules .
507: Ce sont des peptides ou polypeptides à forte activité antibactérienne et à large spectre d' activité .
508: En général , les peptides antibactériens sont de petites molécules cationiques , souvent amphiphiles , qui peuvent interagir avec les phospholipides des membranes bactériennes .
509: Ces interactions leur permettent de perturber les équilibres membranaires qui peuvent conduire à la lyse des bactéries en formant des pores dans les membranes bactériennes .
510: D' autres peptides antibactériens peuvent entraîner une inhibition de la biosynthèse des membranes des micro-organismes ( Shai , 1999 ; pour revue ) .
511: Ces peptides peuvent ainsi tuer ou inhiber la croissance de la plupart des microorganismes testés , bactéries ou champignons .
512: Sur la base de leurs caractéristiques structurales , les peptides antibactériens ont été classés en deux grands groupes .
513: - Les peptides cycliques présentant des cystéines impliquées dans la formation de ponts disulfures .
514: - Les peptides linéaires , eux-mêmes divisés en trois groupes :
515: les peptides basiques formés d' hélices & 206;& 133; , les peptides riches en Proline et les peptides riches en
516: Glycine .
517: Les peptides cycliques
518: De nombreux peptides antimicrobiens contiennent des paires de résidus cystéines qui sont oxydés pour former des ponts disulfures , généralement de 1 à 4 .
519: Toutefois , un peptide antifongique contenant 12 résidus cystéines engagés dans 6 ponts disulfures a été isolé chez
520: Mytilus edulis ( mollusque ) ( Charlet et al. , 1996 ) .
521: Ces peptides forment , en solution , des structures en feuillets & 206;& 134; ( défensines de vertébrés ) ou en « & 206;& 134;-hairpin like » structure ( thanatine , androctonine , gomesine , tachyplésine ) ou encore en hélice & 206;& 133; / & 206;& 134;-sheet ( défensines d' invertébrés ) ( Bulet et al. , 1999 ; Bulet et al. , 2004 ; pour revues ) .
522: Les feuillets & 206;& 134; « hairpin -like » avec 1 pont disulfure
523: Chez les arthropodes , les thanatines , isolées dans le corps gras de l' insecte hémiptère Podisus maculiventris ( Fehlbaum , 1996 ) est le seul représentant de cette classe de peptides antimicrobiens .
524: Ce peptide ne présente pas d' homologie avec les autres peptides d' insectes , par contre il possède jusqu'à 40 % d' homologie avec certains peptides antibactériens isolés chez des grenouilles .
525: Ce peptide a l' un des plus grands spectres d' activité contre des pathogènes , couvrant les bactéries Gram ( - ) et Gram ( + ) , les champignons et les levures .
526: Les feuillets & 206;& 134; « hairpin -like » avec 2 ponts disulfures
527: Les premiers peptides , isolés chez les arthropodes et présentant deux ponts disulfures sont les tachyplésines et les polyphémusines , ils ont été isolés chez les limules ( chélicérates )
528: Tachypleus tridentatus et Limulus polyphemus polyphemus respectivement ( Kawabata et al. , 2003 ; pour revue ) .
529: Ces deux peptides présentent un spectre d' activité large contre les bactéries Gram ( - ) , Gram ( + ) , les levures et dans une moindre mesure contre les champignons filamenteux .
530: Deux autres peptides antimicrobiens contenant deux ponts disulfures ont été isolés chez deux autres espèces de chélicérates :
531: l' androctonine chez le scorpion Androctonus australis
532: ( Ehret- Sabatier et al. , 1996 ) et la gomésine chez l' araignée Acanthoscuria gomesina ( Silva et al. , 2000 ) .
533: Le spectre d' activité de ces deux peptides est très large , et s' étend de l' ensemble des bactéries aux levures .
534: Les androctonines ne présentent pas d' activité hémolytique sur les érythrocytes .
535: Par contre , les gomésines en présentent une très faible alors que les tachyplesines possèdent cette activité de façon très intense ( Bulet et al. , 2004 ; pour revue ) .
536: Les feuillets & 206;& 134; « hairpin-like avec trois / quatre ponts disulfures
537: Les peptides possédant trois ou quatre ponts disulfures constituent la famille des défensines .
538: Dans cette famille , probablement la plus représentée , plus de 70 défensines ont été isolées chez les arthropodes de différents groupes de taxons , comme les insectes , les tiques , la limule , les araignées et les scorpions ( Dimarcq et al. , 1998 ; Bulet et al. , 1999 ; Iwanaga , 2002 ) , et par extension certains crustacés décapodes ( Destoumieux et al. , 1997 ) .
539: La classification en sous familles des défensines d' invertébrés est basée sur leurs propriétés biologiques , antibactériennes et/ou antifongiques .
540: Les défensines d' invertébrés sont principalement actives contre les bactéries à Gram ( + ) , leur activité est nettement plus limitée contre les bactéries
541: Gram ( - ) et les champignons .
542: L' activité antifongique des défensines n' a été caractérisée que pour quatre peptides ( tous isolés dans la classe des insectes ) , la drosomycine chez Drosophila melanogaster , l' héliomicine chez Heliothis virescens , la termicine de Pseudacanthothermes spiniger et la gallerimycine chez Galleria mellonella mellonella .
543: Chez les invertébrés , deux types d' appariement des cystéines impliquées dans les ponts disulfures avaient été décrits , l' un d' entre eux est uniquement observé dans la séquence de la drosomycine .
544: Récemment , un troisième type d' appariement des cystéines a été mis en évidence chez le bivalve Mytilus galloprovincialis ( Bulet et al. , 2004 ; pour revue ) .
545: Les peptides antimicrobiens , isolés chez les différentes espèces de crevettes pénaeides , présentent six cystéines impliquées dans trois ponts disulfures , ce qui les classe dans la famille des défensines , cependant ces peptides possèdent également une région riche en proline à leur extrémité N-terminale ( Destoumieux et al. , 1997 ) .
546: La structure tridimensionnelle de plusieurs défensines a été déterminée , elle consiste en un domaine en hélice & 206;& 133; et deux feuillets & 206;& 134; antiparallèles ( & 206;& 133;& 206;& 134;& 206;& 134; ) , stabilisés par deux ponts disulfures sur les feuillets & 206;& 134;.
547: Les peptides linéaires
548: L' absence de ponts disulfures est la caractéristique des trois familles qui composent ce large groupe de peptides dits linéaires .
549: Les peptides à hélices amphipathiques
550: Cette famille est très diversifiée et inclus les peptides trouvés dans un grand nombre d' organismes éloignés d' un point de vue évolutif .
551: Chez les insectes , ces peptides sont produits dans le corps gras , les hémocytes et certains épithéliums .
552: Ils présentent un spectre d' activité très large qui n' est pas restreint aux pathogènes ( bactéries Gram ( - ) , bactéries
553: Gram ( + ) , champignons et protozoaires ) .
554: En effet , certains de ces peptides sont hémolytiques tandis que d' autres sont de bons insecticides ( Bulet et al. , 2004 ; pour revue ) .
555: Le premier membre de cette famille , qui est aussi le premier peptide découvert
556: ( Steiner et al. , 1981 ) est une cécropine , isolée chez Hyalophora cecropia .
557: Aujourd'hui , plus de 60 cécropines et peptides apparentés aux cécropines ont été caractérisés chez les diptères et les lépidoptères .
558: Ces peptides sont composés de 29 à 42 acides aminés et possèdent deux caractéristiques majeures
559: ( 1 ) la présence d' un résidu tryptophane en position 1 ou 2 ( 2 ) un résidu amidé en C-terminal .
560: L' absence de tryptophane , observé chez certaines cécropines ( Bombyx cécropine D ) et celles des moustiques semble entraîner une action préférentielle des peptides contre les bactéries à Gram ( + ) et contre les levures ( Bulet et al. , 2004 ; pour revue ) .
561: D' autres peptides à hélice & 206;& 133; ont été isolés dans les glandes à venins d' arthropodes .
562: Ainsi , les mélittines et les crabolines sont respectivement les composés majoritaires du venin d' abeille et du frelon européen ( Krishnakumari et Nagaraj , 1997 ) .
563: Dans les glandes à venin de la fourmi Pachycondylas gaeldii , une famille de 15 molécules , les ponéricines , a été caractérisée ( Orivel et al. , 2001 ) .
564: Ces peptides présentent 60 % d' homologie avec les cécropines mais ne sont pas amidés en
565: C-terminal .
566: Enfin , des peptides à hélices & 206;& 133; ont été isolés chez différentes espèces d' araignées , ils présentent des activités antimicrobiennes , hémolytiques et insecticides très élevées ( Mor et al. , 1991 ; Corzo et al. , 2002 ; Kuhn-Nentwig et al. , 2002 ) .
567: Certains peptides adoptant une hélice & 206;& 133; mais ne présentant pas d' homologies avec les cécropines ont été isolés chez un diptère et un isoptère .
568: La particularité de ces peptides est qu' ils sont synthétisés constitutivement dans l' intestin antérieur pour Stomoxys calcitrans calcitrans ( Boulanger et al. , 2002 ) et dans les hémocytes chez Pseudacanthotermes spiniger ( Lamberty et al. , 2001 ) .
569: Les peptides riches en résidus prolines
570: Ils sont caractérisés par un grand nombre de résidus proline et ont été principalement isolés chez les insectes .
571: Ils comptent de 15 à 39 résidus et sont essentiellement actifs contre les bactéries à Gram ( - ) .
572: Cette famille est divisée en deux sous-groupes , les peptides non substitués et les peptides o-glycosylés .
573: Les peptides antimicrobiens sans substitution sont représentés par la famille des apidaecines , isolée initialement chez l' abeille Apis mellifera ( Casteels et al. , 1989 ) .
574: Actuellement , différents peptides homologues des apidaecines ont été isolés chez des lépidoptères mais également chez les hémiptères , chez qui ces peptides ont été nommés métalnikowines ( Bulet et al. , 1999 ; pour revue ) .
575: Une autre famille de peptides , les abaecines , a été mise en évidence chez l' abeille .
576: Ces peptides d' hyménoptères présentent des similarités structurales avec deux autres classes de peptides antimicrobiens , les métalnikowines et les lébocines isolées chez la drosophile Drosophila melanogaster ( Levashina et al. , 1995 ) et le ver à soie Bombyx mori ( Hara et Yamakawa , 1995 ) , respectivement .
577: Il existe notamment une séquence consensus ( Pro-Phe-Asn-Pro ) dans la pertie C-terminale , entre les abaecidines et les metalnikowines .
578: Les peptides o -glycosylés sont représentés par la drosocine , isolée chez Drosophila melanogaster .
579: C' est un peptide de 19 acides aminés , contenant 6 prolines et 4 arginines impliquées dans un triplet ( Pro-Arg-Pro ) répété trois fois .
580: Ce peptide porte sur la thréonine 11 une o-glycosylation ( disaccharide ) .
581: Cette caractéristique a depuis été montrée chez d' autres insectes : ( 1 ) hémiptères [ pyrrhocoricine chez Pirrhocoris apterus ( Cociancich et al. , 1994 ) ] , ( 2 ) lépidoptères [ lebocines chez Bombyx mori ( Hara et Yamakawa , 1995 ) ] , ( 3 ) hyménoptères [ formaecines chez Myrmecia gulosa ( Mackintosh et al. , 1998 ) ] .
582: La nature des sucres impliqués dans la glycosylation est variable et ils peuvent être mono ou disaccharidiques .
583: Les peptides riches en proline , qui jusque là n' avaient été isolés uniquement que chez les insectes , ont été trouvés chez deux espèces de crustacés .
584: Le premier , isolé chez le crabe Carcinus maenas , présente le motif
585: Pro-Arg-Pro-Pro caractéristique des peptides riches en proline d' insectes , cependant ce peptide partage plus d' homologies avec la bacténécine 7 bovine ( Schnapp et al. , 1996 ) .
586: Chez les crevettes pénaeides , la famille des pénaeidines ( décrite précédemment ) est constituée de quatre classes de peptides qui sont riches en proline dans leur région N-terminale ( présence de cystéines en C-terminal ) ( Bachère et al. , 2004 ) .
587: Les peptides riches en résidus glycines
588: Les peptides riches en glycine ont d' abord été isolés chez différentes espèces d' insectes ( diptères , lépidoptères , hyménoptères , coléoptères et hémiptères ) .
589: Leur classification au sein de cette même famille est due à leur nombre élevé en résidus glycine .
590: Ces peptides , dont les tailles sont très variables , ne présentent pas d' homologies de séquence entre eux .
591: Ce regroupement rend donc cette famille de peptides très hétérogène .
592: Toutefois , ces peptides sont essentiellement actifs contre les bactéries Gram ( - ) et les champignons .
593: Les sarcotoxines
594: ( Ando et Natori , 1988 ) et les diptéricines ( Dimarcq et al. , 1988 ) possèdent à leur extrémité N-terminale un court domaine riche en prolines et à leur extrémité
595: C-terminale un long domaine riche en glycines .
596: Ce dernier domaine est également retrouvé chez les attacines ( Hultmark , 1993 ) .
597: Certaines de ces molécules sont modifiées post-traductionnellement ( 1 ) par une amidation à leur extrémité C- terminale ( 2 ) par une glycosylation ( Hetru et al. , 1998 ; pour revue ) .
598: Si des sites de glycosylation ont été observés dans les régions riches en prolines des sarcotoxines et des diptéricines , seules ces dernières se sont révélées o-glycosylées ( au niveau de deux domaines structuraux ) .
599: Ces peptides présentent un effet bactériostatique sur les bactéries Gram ( - ) .
600: D' autres peptides riches en glycines se caractérisent par leur activité bactériolytique , comme les hyménoptaecines d' Apis mellifera ( Casteels-Josson et al. , 1993 ) .
601: Enfin , récemment des peptides riches en glycine ont été isolés chez l' araignée Acanthoscurria gomesiana gomesiana ( Lorenzini et al. , 2003 ) et la crevette Penaeus monodon
602: ( Somboonwiwat et al. , 2005 ) .
603: Les séquences des acanthoscurrines présentent le taux connu le plus important de résidus glycine ( 73 % ) .
604: De plus , ces peptides sont constitués de trois répétitions du motif GGGGL et sont amidés à leur extrémité C- terminale .
605: Ces peptides sont actifs contre les bactérie Gram ( - ) et les champignons .
606: II.2 . Protéines présentant une activité antimicrobienne annexe
607: Récemment , des activités antibactériennes ont été mises en évidence pour des protéines qui initialement présentaient d' autres fonctions .
608: La production de peptides antimicrobiens , générés par clivage enzymatique ( hydrolyse ) à partir de grosses protéines , a été rapportée chez les invertébrés ( Tasiemski et al. , 2000 ; Destoumieux- Garzon et al. , 2001 ; Lee et al. , 2003 ) et les vertébrés
609: ( Bellamy et al. , 1992 ) .
610: 2.1 . L' hémocyanine
611: L' hémocyanine est la protéine majoritaire du plasma des crustacés et a pour fonction initiale de transporter l' oxygène dans l' organisme .
612: Chez les crevettes Penaeus vannamei et Penaeus stylorostris et l' écrevisse Pacifastacus leniusculus l' hémocyanine est clivée dans sa partie
613: C-terminale pour générer un peptide antimicrobien ( Destoumieux-Garzon et al. , 2001 ; Lee et al. , 2003 ) .
614: Ainsi , chez les crevettes , trois peptides antifongiques ont été isolés et caractérisés .
615: Ces peptides présentent des masses moléculaires de 2 , 7 kDa chez Penaeus vannamei tandis que les deux peptides générés chez Penaeus stylorostris présentent des masses de 7 , 9 et 8 , 3 kDa .
616: Ces peptides , contrairement à la majorité des peptides antimicrobiens connus , sont anioniques avec un pI calculé de 5 , 6 à 6 , 5 pour des pH physiologiques .
617: La production des ces peptides est stimulée par une infection microbienne ( Destoumieux-Garzon et al. , 2001 ) .
618: Leur apparition dans le plasma correspond à la libération massive des pénaedines résultant de la lyse des hémocytes ( Destoumieux et al. , 2000b ) .
619: Cependant , les mécanismes responsables du clivage de l' hémocyanine n' ont pas encore été décrits .
620: Chez Pacifastacus leniusculus , le peptide de 1945 Da , issu du clivage de l' hémocyanine , est un peptide cationique qui ne possède pas de cystéine .
621: L' activité antimicrobienne de ce peptide est dirigée contre les bactéries à Gram ( - ) et à
622: Gram ( + ) .
623: Le clivage de l' hémocyanine est induit lors d' infections par du LPS ou des & 206;& 134; 1 , 3 - glucanes .
624: Le clivage de ce peptide est probablement réalisé par une réaction enzymatique , attribuée chez l' écrevisse , à une cystéine protéase .
625: L' utilisation de protéines très abondantes et disponibles dans le plasma comme source de peptides antibactériens doit avoir lieu chez des animaux dont la réponse à l' infection est très rapide .
626: Ce mécanisme consomme probablement peu d' énergie et pourrait provenir d' un mécanisme plus ancien .
627: Produits dans les premières phases de la réponse immunitaire , ces peptides pourraient opérer comme des modulateurs de l' immunité ( Bachère et al. , 2004 ) .
628: 2.2 . La proppA
629: Chez Pacifastacus leniusculus , la proppA , sérine protéase du système
630: ProPO , présente dans son clip-domaine une activité antibactérienne dirigée contre les bactéries Gram ( + ) in vitro ( Wang et al. , 2001 ) .
631: Ce clip domaine présente une région homologue aux défensines et serait libéré sous l' action de la ppA .
632: II.3 . Mode d' action des peptides antibactériens
633: Les mécanismes d' action des peptides antimicrobiens cationiques constituent un sujet de recherche privilégié actuellement .
634: Les connaissances , acquises ces dernières années , sont parfois controversées mais toutes s' accordent sur le fait que tous les peptides antimicrobiens déstabilisent sélectivement les membranes mais également que l' arrangement structural amphipathique doit jouer un rôle important dans ce mécanisme .
635: Les peptides antimicrobiens ou de reconnaissance du soi , qui sont généralement fortement basiques , semblent reconnaître les phospholipides acides exposés à la surface des membranes bactériennes ( Tytler et al. , 1995 ) .
636: Les propriétés physico-chimiques et biophysiques des peptides antimicrobiens , comme la structure secondaire , la charge globale et l' hydrophobicité influencent leurs interactions avec les membranes microbiennes ( Reddy et al. , 2004 ; pour revue ) .
637: 3.1 . Le modèle par formation de pores :
638: « Barel stave »
639: Ce modèle décrit la formation de pores transmembranaires par des faisceaux d' hélices & 206;& 133; amphipathiques dont les surfaces hydrophobes interagissent avec la partie lipidique de la membrane alors que les surfaces hydrophiles se tournent vers l' intérieur pour former un pore aqueux .
640: Le recrutement progressif de monomères additionnels augmente la taille du pore .
641: Les canaux transmembranaires ainsi formés vont détruire les équilibres osmotiques et conduire à la lyse de la cellule ( Wu et al. , 1999 ) .
642: Chez les arthropodes , le mode d' action de certains peptides antimicrobiens a été établi , notamment pour les cécropines
643: ( Hong et al. , 2003 ) , les diptéricines ( Winans et al. , 1999 ) , les défensines ( Christensen et al. , 1990 ) les tachyplésines et les polyphémusines ( Katsu et al. , 1993 ) .
644: Ils présentent tous une activité membranolytique .
645: 3.2 . Le modèle détergent :
646: « Carpet » Dans ce modèle , les peptides à forte concentration sont en contact avec les phospholipides de la membrane externe et entraînent une perméabilité membranaire .
647: Les peptides se lient tout d' abord à la surface des membranes cibles , puis la recouvre à la manière d' un tapis .
648: Les peptides désintègrent alors la membrane en déstabilisant la bicouche phospholipidique .
649: 3.3 . Autres mécanismes
650: Certains peptides ne semblent pas agir sur les membranes mais sur des cibles cytoplasmiques .
651: Par des analyses de translocation , il a été montré que les peptides riches en arginine étaient capables à la fois d' être transportés à travers la membrane plasmique , mais également à travers l' enveloppe nucléaire ( Powers et Hancock , 2003 ; pour revue ) .
652: Une fois dans la cellule , les peptides peuvent alors interagir avec l' ADN , l' ARN et/ou les protéines cellulaires .
653: Les pyrrhocoricines , peptides riches en prolines d' insectes , sont capables de se lier aux heat shock protéines ( DnaK ) , inhibant alors leur rôle de chaperonnes moléculaires
654: ( Kragol et al. , 2001 ) .
655: Ce mécanisme est cependant plus long que celui concernant une action sur les membranes .
656: Les attacines , inhiberaient la synthèse des protéines de la membrane externe sans cependant entrer dans la cellule ( Hultmark et al. , 1983 ) .
657: II.4 . Régulation de la synthèse des peptides antimicrobiens
658: 4.1 . Chez les insectes
659: Chez les insectes , le corps gras ( équivalent fonctionnel du foie des vertébrés ) est le site principal de synthèse des peptides antimicrobiens ( Hoffman et Reichhart , 1997 ; Engström , 1998 ) , certains hémocytes étant cependant capables d' une telle synthèse .
660: Chez les insectes sains , les gènes codant les peptides antibactériens sont en général silencieux .
661: En réponse à une infection microbienne , une induction rapide de la transcription de ces gènes , conduisant à la synthèse et la libération simultanée de peptides antimicrobiens dans l' hémolymphe est observée ( Hoffman et Hetru , 1992 ) .
662: Chez la drosophile , les mécanismes d' activation des gènes codants les peptides sont aujourd'hui connus .
663: Lors d' une infection par des bactéries à Gram ( + ) ou des champignons , les déterminants antigéniques de ces pathogènes sont reconnus par la cellule .
664: Cette reconnaissance s' effectue pour les bactéries Gram ( + ) par l' intermédiaire d' une protéine de reconnaissance des glucanes , tandis que les molécules impliquées dans la reconnaissance des champignons ne sont , à ce jour , pas déterminées .
665: Quoiqu' il en soit cette reconnaissance va permettre l' activation de la voie Toll des cellules du corps gras mais également des hémocytes .
666: Brièvement , les récepteurs transmembranaires Toll sont activés et déclenchent une cascade d' activation dans la cellule qui conduit à l' entrée dans le noyau du facteur de transcription DIF ( Figure . 4 ) .
667: Les gènes codants les peptides antimicrobiens présentent dans leur région régulatrice des motifs semblables aux motifs NF-& 206;& 142;B des mammifères
668: ( Meister et al. , 1997 ) .
669: Les protéines DIF vont alors induire , par exemple , la transcription du gène de la drosomycine .
670: Lors d' une infection fongique naturelle plus de 350 gènes sont induits dont celui de la drosomycine ( Hetru et al. , 2003 ; Vodovar et al. , 2004 ) .
671: Lors d' une infection par des bactéries Gram ( - ) , le mécanisme d' activation de la transcription des gènes des peptides antibactériens est différent et implique une autre voie :
672: la voie Imd ( immune deficiency ) .
673: Bien que le récepteur des protéines de reconnaissance impliqué dans cette voie de signalisation ne soit pas clairement identifié , cette voie de signalisation aboutit , de la même manière que la voie Toll , à l' activation de la transcription des gènes codant les peptides antibactériens .
674: Le facteur de transcription impliqué ( relish ) est différent mais possède le même motif de liaison aux domaines NF& 206;& 142;B. Son entrée dans le noyau conduit à l' activation de la diptéricine mais également de nombreux autres gènes , dont les fonctions sont inconnues ( Hetru et al. , 2003 ; pour revue ) .
675: Les peptides ainsi produits et immédiatement maturés sont sécrétés dans la circulation générale , où ils vont pouvoir agir sur les pathogènes infectants .
676: Figure 4 :
677: Schéma des voies de signalisation Toll et IMD dans la réponse immunitaire innée chez la drosophile .
678: A .
679: La voie Toll :
680: les bactéries Gram ( + ) et les champignons sont reconnus par des PRP , processus qui est suivi par le clivage protéolytique de Spaetzel .
681: Spaetzel active le récepteur Toll , qui conduit à la dégradation de Cactus et la translocation nucléaire de la protéine DIF .
682: Ce facteur de transcription active de nombreux gènes dont celui de la drosomycine .
683: B . La voie IMD :
684: les bactéries Gram ( - ) activent cette voie de signalisation , toutefois le récepteur membranaire est inconnu .
685: Cette voie de signalisation fait intervenir des caspases et aboutit à la translocation nucléaire du facteur de transcription Relish , qui va activer de nombreux gènes dont celui de la diptéricine ( d' après Vodovar et al. , 2004 )
686: 4.2 . Chez les chélicérates
687: Chez les chélicérates , les hémocytes granulaires stockent les molécules de défense telles que les sérines protéases , une protéine de coagulation , les inhibiteurs de protéases , les peptides antibactériens et les lectines ( Iwanaga et Kawabata , 1998 ; Iwanaga , 2002 ; Kawabata et Tsuda , 2002 ) .
688: Lors d' une infection microbienne , les déterminants antigéniques des pathogènes sont reconnus , ce qui induit la libération par exocytose des protéines de défense
689: ( Figure . 5 ) ( Iwanaga et Kawabata , 1998 ) .
690: Les micro-organismes sont agglutinés par les lectines , immobilisés dans un gel insoluble produit par les facteurs de coagulation , et enfin tués par les substances antimicrobiennes .
691: Récemment , un récepteur homologue des récepteurs
692: Toll de drosophile ( dToll ) a été isolé chez la limule Tachypleus tridentatus tridentatus ( tToll ) ( Inamori et al. , 2004 ) .
693: Ce recepteur n' est pas exprimé spécifiquement dans les tissus , et ne fonctionnerait pas comme un récepteur des
694: PRP .
695: La protéine finale de coagulation ( coaguline ) présente des structures qui ressemble au ligand des dToll ( spaetzle ) .
696: Inamori et collaborateurs ( 2004 ) proposent que la coaguline induise la dimérisation ou l' oligomérisation de tToll , conduisant à l' activation des voies de signalisation intracellulaires .
697: Cette liaison au tToll permettrait alors l' expression des gènes des protéines de défense ( afin de restaurer le contenu des granules hémocytaires ) mais également l' expression des protéines impliquées dans la réparation des tissus et de l' exosquelette sur le site d' infection ( Figure . 5 ) .
698: Figure 5 :
699: Le système de défense des limules :
700: Découverte d' un récepteur
701: Toll-like .
702: Les hémocytes détectent les LPS ou les & 206;& 134;- 1 , 3- glucanes qui vont induire la dégranulation des hémocytes .
703: Les facteurs de coagulation libérés sont activés par le LPS ou les & 206;& 134;- 1 , 3- glucanes .
704: La coaguline ainsi produite pourrait induire la dimérisation des récepteurs tToll .
705: La cascade de signalisation intracellulaire serait alors activée ( modifié d' après Iwanaga et Kawabata , 1998 ) .
706: 4.3 . Chez les crustacés
707: Chez les crustacés décapodes , si la réponse immunitaire est relativement bien connue , principalement grâce aux études réalisées ( 1 ) sur l' écrevisse Pacifastacus leniusculus par l' équipe de Söderhäll ( 2 ) sur les crevettes pénaeides par l' équipe de Bachère .
708: La compilation de ces recherches indiquent que la majorité des protéines du système immunitaire , y compris les peptides antimicrobiens sont produits constitutivement et stockés dans les hémocytes , ce modèle ressemble donc à celui proposé chez les chélicérates .
709: Toutefois , le mode de libération du contenu des granules semble différent .
710: Les premières études d' expression des gènes , chez Penaeus vannamei , ont montré que suite à une infection microbienne , les nouveaux hémocytes libérés par les organes hématopoïétiques présentent un fort taux d' ARNm codant pour les pénaeidines ( Figure . 6 ) .
711: De plus , ces hémocytes s' infiltrent dans tous les tissus , témoignant d' une réaction systémique
712: ( Bachère et al. , 2004 ) .
713: Toutefois , actuellement , le mode de régulation de la synthèse des protéines de défense et a fortiori des peptides antimicrobiens demeure inconnu .
714: Le rôle du système nerveux dans la production de peptides antimicrobiens ( Lefebvre et al. , 2000 ; Vergotte et al. , 2004 ) ainsi que son rôle dans le contrôle de leur libération n' ont pas encore été étudié chez les crustacés .
715: Signalons cependant , que différentes études rapportent la présence de peptides opioïdes dans les système nerveux des crustacés isopodes et décapodes ( Martin et Dubois , 1981 ; Luschen et al. , 1991 ) mais le rôle de ces peptides n' est pas évoqué dans le cadre de l' immunité .
716: Figure 6 :
717: Modèle d' action des pénaeidines dans la réponse immunitaire chez les crevettes pénaeides .
718: A .
719: En conditions normales , les pénaeidines sont produites par les hémocytes , qui sont localisés à la fois dans la circulation générale et dans les tissus .
720: La réponse à une infection microbienne peut être divisée en deux phases .
721: B . Phase I .
722: Réaction locale :
723: elle est caractérisée par la migration des hémocytes vers le site d' infection et par la libération de grandes quantités de peptides antimicrobiens .
724: Les pénaeidines et les peptides dérivés de l' hémocyanine sont présents dans la circulation .
725: C .
726: Phase II .
727: Réaction systémique :
728: elle est caractérisée par une accumulation d' hémocytes produisant les peptides antimicrobiens avec une expression supérieure à la normale , issus de la libération par les organes hématopoïétiques activés .
729: Les pénaeidines sont liées aux surfaces cuticulaires ( d' après Bachère et al. , 2004 ) .
730: Tableau 1 :
731: Systématique des différentes espèces d' isopodes terrestres ( cloportes ) utilisées dans cette étude .
732: Matériels et Méthodes
733: I. MODÈLE BIOLOGIQUE ET ELEVAGE
734: Les travaux réalisés ont principalement porté sur une espèce d' isopode terrestre , Armadillidium vulgare ( A.vulgare ) ( Latreille ) .
735: Ce crustacé Malacostracé de la famille des Armadillidiidae ( Brandt ) est très commun dans les zones agricoles en France .
736: Deux lignées entretenues depuis de nombreuses années au laboratoire ont été utilisées :
737: - La lignée amphogène ( sex-ratio équilibré ) est originaire des collines de l' arrière pays niçois .
738: - La lignée thélygène ( sex-ratio biaisé & 198;& 190; 50 % ) , riche en intersexués et en femelles thelygènes porteuses de Wolbachia ( wVul ) , provient de Niort ( 79 ) .
739: Ces deux populations sont maintenues à 20 °C en photopériode naturelle dans des bacs de plastique ( 10 X 30 cm ) contenant du terreau humide , et reçoivent une nourriture ad libitum , constituée de carottes et de feuilles de tilleul .
740: D' autres espèces d' isopodes terrestres , également disponibles au sein des élevages du laboratoire , ont été utilisées lors de cette étude ( Tableau 1 ) : ( i ) Des espèces du genre Armadillidium appartenant à la même famille ( Armadillidiidae ) :
741: Armadillidium assimile , Armadillidium depressum , Armadillidium maculatum et Armadillidium nasatum . ( ii ) Des espèces de genres différents appartenant à des familles différentes :
742: -
743: Oniscus asellus ( Linné ) se rencontre en forêts sous les écorces de bois mort , cette espèce appartient à la famille des Oniscidae .
744: - Porcellionides pruinosus pruinosus ( Brandt ) est une petite espèce très rapide qui affectionne les composts , elle appartient à la famille des Porcelloinidae .
745: Ces deux espèces peuvent héberger d' autres souches de Wolbachia ( respectivement wAse et wPru ) , et certains mâles fonctionnels peuvent être porteurs de la bactérie .
746: - Armadillo officinalis ( europeus ) ( Dumeril ) , récolté dans les garrigues de la région de Narbonne , appartient à la famille des Armadillidae considérée comme la plus évoluée ( d& 200;& 135;un point de vue volvationnel ) du groupe des isopodes terrestres .
747: Les populations naturelles étudiées n& 200;& 135;hébergent pas de Wolbachia et , de façon inattendue , cette espèce est capable d' éliminer Wolbachia ( souche wVul ) après inoculation expérimentale .
748: Ces 7 populations sont également maintenues au laboratoire dans les mêmes conditions qu' Armadillidium vulgare .
749: II . PRELEVEMENT DE L' HEMOLYMPHE
750: A l' aide d' une fine aiguille , un trou est percé dans la membrane articulaire entre le dernier segment du péréion et le premier segment du pléon , au niveau du vaisseau dorsal médian
751: ( Figure 7 ) .
752: L' hémolymphe s& 200;& 135;écoulant par ce trou est prélevée rapidement à l' aide d' une pipette et est diluée de moitié dans une solution anticoagulante [ MAS :
753: EDTA 9 mM ;
754: glucose 115 mM ;
755: NaCl 336 mM ;
756: citrate de sodium 27 mM , pH 7 ;
757: ( Rodriguez et al. , 1995 ) ] maintenue sur glace et contenant un inhibiteur de serine-protéinases ( aprotinine 40 & 206;& 144;M , Sigma ) et un inhibiteur de mélanisation ( phénylthiocarbamate 200 & 206;& 144;M , Sigma ) .
758: Le plasma est séparé des hémocytes par centrifugation ( 800 X g , 15 min , 4 °C ) .
759: Le surnageant correspondant au plasma et le culot d' hémocytes sont ensuite stockés séparément à - 70 °C .
760: III . INJECTIONS EXPERIMENTALES DES ANIMAUX
761: Dans les expériences d' infection , différents composés mais également différentes souches bactériennes ont été injectés aux animaux :
762: - & 200;& 136;Ringer isopodes& 200;& 136; ( CaCl 2 1 , 4 mM ; HNaCO 3 2 , 4 mM
763: ; KCl 2 mM ;
764: NaCl 0 , 4 M ) - LPS ( Escherichia coli , Sigma ) injecté en solution dans du & 200;& 136;Ringer isopodes& 200;& 136; à raison de 0 , 1 mg / ml .
765: - Laminarine ( Laminaria digitata digitata , Sigma ) injectée en solution dans du
766: & 200;& 136;Ringer isopodes& 200;& 136; à raison de 1 mg / ml .
767: - Bacillus megaterium [ Gram ( + ) ]
768: ( 1 , 2.109 bactéries / ml ) , tués ou non par chauffage à 95 °C pendant 10 min .
769: - Escherichia coli [ Gram ( - ) ] ( 1 , 2.109 bactéries / ml ) , tués ou non par chauffage à 95 °C pendant 10 min .
770: - Wolbachia ( bactérie endocellulaire non cultivable ) :
771: l' inoculum est préparé à partir des ovaires et des chaînes nerveuses prélevées sur 5 femelles d' A.vulgare porteuses de Wolbachia .
772: Les organesdisséqués sont broyés , à 4 °C , à l' aide d' un piston Pellet stérile dans 500 & 206;& 144;l de & 200;& 136;Ringer isopodes& 200;& 136;. Le broyat obtenu est filtré à l& 200;& 135;aide d' une seringue munie d& 200;& 135;une cartouche filtrante ( Poly Labo ) dont la membrane présente des pores de 1 , 2 & 206;& 144;m perméables aux bactéries .
773: Toutes les injections sont réalisées en position latérale dans le 6ème segment du péréion de l' animal et consistent en l' injection d' un microlitre de solution à tester , à l' aide d' une seringue Hamilton munie d& 200;& 135;une micro-aiguille .
774: Après différents temps d' action ( de plusieurs minutes à plusieurs jours ) , l' hémolymphe des animaux est prélevée comme décrit dans le § II .
775: p 40 .
776: IV . TESTS D' ACTIVITE ANTIMICROBIENNE
777: IV.1 Tests d' activité antibactérienne
778: Au cours des tests d' activité antibactérienne , 6 souches de bactéries Gram ( + ) [ Bacillus megaterium * , Enterococcus faecalis * , Listeria ivanovii * , Micrococcus luteus * , Staphilococcus aureus , Vibrio alginolyticus * ] et 8 souches de bactéries Gram ( - ) [ ( Acinetobacter baumanii
779: , Citrobacter freundii *
780: , Enterobacter cloacae * , Enterobacter aerogines , Escherichia coli *
781: , Escherichia coli ( souche pathogène ) , Pseudomonas aeruginosa , Salmonella thyphimurium * ) ] ont été utilisées .
782: Tableau 2 :
783: Souches bactériennes utilisées et milieux de culture correspondants :
784: LB
785: Les tests d' activité antibactérienne ont été réalisés de deux manières différentes : ( a ) en milieu solide sur gélose pour les bactéries marquées d' une étoile ( * ) ;
786: ( b ) en milieu liquide pour les bactéries marquées d' un dièse ( ) . ( a ) Tests en milieu solide Une colonie de chaque souche bactérienne est mise en culture soit dans du milieu Luria-Bertani ( LB ) , soit dans du milieu Brain Heart Infusion ( BHI ) ( Tableau 2 ) , puis placée à 37 °C pendant 16h. Un aliquot ( 120 & 206;& 144;l ) de chaque culture bactérienne ainsi préparée est mélangé à
787: 12 ml d& 200;& 135;un milieu gélosé approprié ( LB / agar 10 % ou BHI / agar 10 % ) stabilisé à 50 °C et coulé dans des boîtes de Pétri .
788: Les échantillons à tester ( peptides et protéines plasmatiques ou hémocytaires ) sont resuspendus dans 10 & 206;& 144;l d' eau bidistillée stérile et déposés sur la gélose .
789: Après incubation pendant une nuit à 37 °C , l' activité antibactérienne est révélée par l' absence de croissance des bactéries dans la zone du dépôt . ( b ) Tests en milieu liquide Ces tests sont réalisés en microplaques 96 puits ;
790: 10 & 206;& 144;l d' une solution de protéines ( reprises dans de l' eau bidistillée ) sont dilués successivement de moitié dans les puits d' une même ligne .
791: Cent microlitres de bactéries , cultivées dans du milieu Poor Broth Nutrient ( PBN ) puis diluées à
792: 0 , 001 unité DO600 , sont ajoutés dans chaque puits .
793: Les microplaques sont placées à l' étuve à
794: 37 °C sous agitation constante pendant 18h. La croissance des bactéries est mesurée par spectrophotométrie , dans un lecteur de plaques à une longueur d' onde de 600 nm .
795: IV.2 . Tests d' activité antifongique 2.1 Champignons
796: Les champignons utilisés pour cette recherche sont Botrytis cinerea , Aspergillus niger , Phaeomoniella chlamydospora et Eutypa lata ( Tableau 3 ) .
797: Tableau 3 :
798: Souches de champignons utilisées et milieux de culture correspondants
799: Pour Aspergillus niger et Botrytis cinerea , l' activité antifongique de nos échantillons a été testée sur la germination des spores de ces champignons filamenteux .
800: Dix microlitres d& 200;& 135;une solution de 106 spores , stockée à 4 °C , sont dilués au 1 / 1000 éme dans un milieu & 194;& 189; Potato Dextrose
801: Broth ( & 194;& 189; PDB ) .
802: Vingt microlitres de protéines à tester sont déposés dans l' un des puits d' une microplaque et sont dilués successivement de la même manière que pour les tests antibactériens , puis 80 & 206;& 144;l de milieu contenant les spores diluées sont ajoutés dans chaque puits .
803: Les microplaques sont placées pendant 18 à 48h à 30 °C en chambre humide .
804: La croissance des hyphes est vérifiée par observation au microscope et la densité optique de la plaque est lue à une longueur d' onde de 595 nm .
805: Pour E. lata et P. chlamydospora , des plaques 12 puits sont utilisées afin de tester l' activité antifongique de nos échantillons sur la croissance des champignons .
806: Dans chaque puits , 1 , 5 ml de milieu de culture sont déposés ;
807: lorsque celui -ci commence à se solidifier , le plus petit volume possible de protéines , à la concentration souhaitée , est ajouté .
808: Le milieu solide est inoculé avec un disque de gélose de 4 mm , sur lequel s' est développé le champignon à tester .
809: Les expérimentations sont conduites en conditions contrôlées à l' obscurité à 20 °C. La croissance des champignons est suivie par une mesure quotidienne du diamètre de l' inoculum .
810: 2.2 . Levures Les tests d' activité sur les levures ( Candida glabrata , Pichia pastoris , Saccharomyces cerevisiae FL100 , Saccharomyces cerevisiae Erg 6 & 199;& 187; et Saccharomyces cerevisiae WT
811: Eurostarf ) ont été réalisés sur milieu solide .
812: Une suspension cellulaire de levures en croissance est étalée sur milieu complet ( ML , Tableau 3 ) et mise à pousser jusqu'à l' obtention d' un tapis .
813: Les échantillons sont déposés sur des disques de papier Whatman stériles ( 8 mm ) posés au préalable sur le tapis de levures .
814: Autour du disque , l' activité antifongique se manifeste par un halo d' inhibition de croissance dont le diamètre est proportionnel à l' effet .
815: IV.3 . Concentration minimale d' inhibition ( MIC )
816: La MIC correspond à un intervalle de concentrations du peptide antibactérien ( a-b ) , où ( a ) représente la plus forte concentration pour laquelle les bactéries peuvent encore pousser et où ( b ) correspond à la plus basse concentration qui provoque 100 % d' inhibition de la croissance bactérienne .
817: La connaissance de ces valeurs permet de déterminer l' activité du peptide antibactérien .
818: Ce test a été réalisé en culture liquide dans des microplaques à 96 puits dans un volume final de 200 & 206;& 144;l .
819: Une gamme étalon de dilution ( à base 10 ) du peptide est réalisée avec du milieu PBN .
820: Cent microlitres de chaque solution sont incubés avec 100 & 206;& 144;l d' une suspension de culture de Bacillus megaterium ( DO A 600 = 0 , 001 ) dans du milieu PBN .
821: La croissance des bactéries est estimée par mesure de la densité optique à 600 nm après 18h d' incubation à 30 °C sous agitation constante .
822: V. APPROCHE PROTÉOMIQUE
823: Pour l' analyse des protéines plasmatiques , que ce soit en gels 1-D , 2-D ou RP- HPLC , l' aprotinine n' a pas été utilisée lors du prélèvement de l& 200;& 135;hémolymphe et ce , afin de ne pas la retrouver comme une protéine contaminante .
824: V.1 . Extraction des
825: protéines 1.1 Des hémocytes
826: Après lavage par 500 & 206;& 144;l de la solution anticoagulante , le culot d' hémocytes , obtenu comme décrit dans le § II p 40 , est repris soit dans 150 & 206;& 144;l d' une solution d' acide acétique 0 , 2 N pour les pré-purifications Sep-Pak , soit dans 150 & 206;& 144;l d' une solution de PBS (
827: Buffered Saline :
828: NaCl 0 , 137 M ;
829: Na 2 HPO 4 , 12 H 2O 7 , 8 mM ;
830: KCl 2 , 7 mM ;
831: KH2PO4 1 , 47 mM ;
832: pH
833: 7 , 4 ) pour les analyses en 2-D .
834: La suspension est maintenue sur glace jusqu'à l' extraction protéique .
835: Les cellules hémocytaires sont broyées par sonication 3 X 30s ( 40 mA , Branson
836: Ultrasons , Annemasse , France ) .
837: L' homogénat est centrifugé 2 fois à 12 000 X g , pendant 10 min à 4 °C , ce qui permet d& 200;& 135;éliminer les débris cellulaires .
838: Les protéines contenues dans le surnageant acétique sont utilisées immédiatement pour un fractionnement à l' aide d' un Sep-Pak ( cf. § V . 2.1 . p 48 ) , celles solubles dans le PBS sont précipitées une nuit dans 6 volumes d' acétone à
839: - 20 °C. Après centrifugation ( 10 000 X g , 20 min , 4 °C ) , les culots de protéines précipitées sont rincés à l' acétone froid puis séchés à l' air libre .
840: 1.2 . Du plasma
841: Afin d' éliminer l' hémocyanine qui est la protéine majoritaire du plasma ( 95 % des protéines totales ) , deux méthodes par acidification ont été utilisées ;
842: la première utilise de l' acide trifluoroacétique ( TFA ) 0 , 1 % , la seconde de l' acide chlorhydrique ( HCl ) à 0 , 1 M final .
843: L' acidification du plasma permet de précipiter les grosses molécules , telle que l' hémocyanine , sans précipiter les plus petites .
844: Cette précipitation est réalisée sur glace sous agitation magnétique pendant 8h. L' hémocyanine précipitée est alors éliminée par 2 centrifugations à 8 000 X g pendant 20 min à 4 °C. Le surnageant contenant les petites protéines est conservé sur glace ou stocké à - 80 °C .
845: 1.3 . Des organes hématopoïétiques
846: Les organes hématopoïétiques ( 3 paires par animal ) sont , après dissection , immédiatement plongés dans l' azote liquide .
847: Environ 120 organes hématopoïétiques sont placés dans un milieu inhibiteur de protéases [ alcool 75 % ;
848: HCl fumant 0 , 2 M ;
849: ( Oyama et al. , 1978 ) ] puis soniqués 3 X 20s .
850: Les débris cellulaires sont éliminés par centrifugation ( 10 000 X g , 10 min , 4 °C ) et les protéines contenues dans le surnageant sont précipitées par 6 volumes d' acétone pendant une nuit à - 20 °C. Après centrifugation ( 15 000 X g , 20 min , 4 °C ) , le culot est conservé à - 20 °C jusqu& 200;& 135;à utilisation .
851: 1.4 . Des cæcums digestifs
852: Les cæcums digestifs de 2 animaux sont placés dans un milieu inhibiteur de protéases [ ( alcool 75 % ; HCl fumant 0 , 2 M ; ( Oyamaet al. , 1978 ) ] .
853: Après centrifugation ( 15 000 X g , 5 min , 4 °C ) , le culot est repris dans le même milieu et les cæcums digestifs sont broyés à l' aide d' un piston ( Pellet ) .
854: Les débris cellulaires sont éliminés par centrifugation ( 10 000 X g , 10 min , 4 °C ) .
855: Les protéines contenues dans le surnageant sont précipitées dans 6 volumes d' acétone à - 20 °C pendant plusieurs heures ou une nuit .
856: Les protéines ainsi précipitées sont récupérées comme décrit ci- dessus ( § V . 1.3 p 47 ) .
857: V.2 . Purification et analyses des protéines
858: 2 . 1 .Sep -Pak
859: Le fractionnement des protéines est réalisé en phase solide sur une cartouche 35 cc
860: La phase ( C18 ) est préalablement lavée avec 10 ml de méthanol et équilibrée par 10 ml d' eau bidistillée additionnée de TFA 0 , 05 % ( Cociancich , 1991 ) .
861: Les protéines hémocytaires ou plasmatiques ( quelque soit le type d' acidification utilisé ) sont diluées dans une solution d' eau TFA 0 , 1 % ( v / v ) .
862: Après vérification du pH , qui doit être compris entre 2 , 0 et 2 , 5 , l& 200;& 135;échantillon est déposé sur la cartouche Sep-Pak .
863: Celle -ci est ensuite lavée avec 5 ml d' eau TFA 0 , 1 % afin d' éliminer les sels contenus notamment dans la solution anticoagulante .
864: Les protéines hémocytaires ou plasmatiques sont ensuite éluées par une solution d' acétonitrile ( ACN ) de concentration variable selon l' utilisation désirée : ( i ) pour les tests d' activité antimicrobienne , l' ensemble des protéines est élué par une solution de 80 % d' ACN / TFA 0 , 1 % .
865: La fraction collectée est séchée au concentrateur sous vide réfrigéré ( Speed Vac , Savant& 194;& 174; ) ( ii ) pour l' isolement des peptides antimicrobiens , deux élutions successives à 40 % puis à 60 % d' ACN / TFA 0 , 1 % sont effectuées .
866: Les deux fractions sont collectées séparément et séchées au concentrateur sous vide réfrigéré ( Speed Vac , Savant& 194;& 174; ) .
867: 2.2 . RP-HPLC
868: Les protéines extraites des différents échantillons sont resuspendues dans 150 & 206;& 144;l d' acide acétique 0 , 02 N , puis l' échantillon est centrifugé ( 10 000 X g , 2 min , 4 °C ) et le surnageant est injecté dans la boucle d' injection ( 200 & 206;& 144;l ) de la chaîne de chromatographie ( Waters& 239;& 130;& 165; 600
869: Controller ) .
870: L' analyse par RP-HPLC permet de séparer les peptides / protéines contenus dans les échantillons selon leur polarité .
871: Pour cela , l' échantillon est adsorbé sur une phase solide constituée d' un support inerte composé de particules de silice de 10 & 206;& 144;m de diamètre
872: ( Lichrospher ODS2 ) sur lesquelles sont greffées des chaînes apolaires à 18 atomes de carbone
873: ( C18 ) .
874: Cette phase solide est contenue dans une colonne d' une longueur de 300 mm et d' un diamètre de 3 , 9 mm ( Microbondapack& 226;& 132;& 162; , Waters Associates ) .
875: Cette colonne est équilibrée par une solution d' ACN 4 % / TFA 0 , 1 % .
876: Les protéines sont éluées par un gradient linéaire de 4 à
877: 60 % d' ACN / TFA 0 , 1 % , avec un débit de 0 , 9 ml par min ( 0 , 72 % d' ACN par min ) pendant 80 min .
878: Les produits désorbés sont détectés par absorption à 214 nm ( Waters& 239;& 130;& 165; 486 Tunable absorbance detector ) et le profil de chromatographie ( absorbance > à 0 , 3 unités DO , en fonction du temps ) est enregistré sur papier .
879: A chaque augmentation de l' absorbance , l' éluat est collecté manuellement .
880: Chaque fraction est ensuite séchée au concentrateur sous vide et stockée à - 80 °C .
881: 2.3 . MALDI-TOF
882: Du fait de la faible concentration en peptides ou en protéines des fractions collectées après purification par RP-HPLC , la technique de MALDI-TOF est très adaptée puisqu' elle est applicable à partir de la femtomole et donne des informations sur la ou les masses des produits contenus dans la fraction collectée , sur sa pureté , ainsi que sur la présence éventuelle de glycosylations sur le produit analysé .
883: Ces analyses ont été réalisées au laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio- Organique ( Directeur A. Van Dorsselaer , UMR
884: CNRS-ULP Strasbourg ) , en collaboration avec le Dr J-M Strub , sur un appareil MALDI-TOF de type Bruker ( Bremen ) BIFLEX& 226;& 132;& 162;.
885: Les échantillons sont resuspendus dans 10 & 206;& 144;l d' eau / ACN ( 50 / 50 , v / v ) -TFA 0 , 1 % , et 0 , 7 & 206;& 144;l sont déposés sur une cible métallique et co-cristallisés avec 0 , 7 & 206;& 144;l de matrice solide d' acide & 206;& 133;-cyano- 4- hydroxycinnamique ( Sigma ) saturée par de l' eau / ACN ( 50 / 50 , v / v ) -TFA 0 , 1 % .
886: Cette matrice permet une séparation des molécules par absorption de l' énergie provenant des pulses de photons émis par un laser .
887: Ainsi , elle favorise l' ionisation par vaporisation en induisant des transferts de protons .
888: Les ions formés sont ensuite envoyés dans le sélecteur et accélérés par un potentiel ( V ) de 28 kV , dans un tube à champ libre de vol ( TOF ) en mode linéaire .
889: Le temps de vol ( t ) , nécessaire pour atteindre le détecteur placé à une distance ( d ) , est mesuré .
890: Ce temps est relié au rapport masse (
891: t& 194;& 178; = ( md& 194;& 178; ) / ( 2 zeV ) = m / z ( d& 194;& 178; / 2 eV ) Ainsi , la durée du temps de vol d' une molécule sera fonction du nombre de charges qu' elle porte .
892: L' enregistrement d' un spectre requiert la superposition de 50 tirs du laser sur la matrice .
893: Le calibrage des spectres est effectué par extrapolation à partir du temps de vol de 2 protéines de masses parfaitement connues :
894: l' insuline de boeuf ( 5 750 Da ) et la myoglobine ( 16 500 Da ) .
895: 2.4 . Séquençage par dégradation d' Edman
896: Les échantillons ( peptides ou protéines ) sont soumis à une dégradation d' Edman qui permet d' établir la séquence primaire en acides aminés .
897: Cette réaction de dégradation est effectuée de façon automatisée sur un séquenceur ( Applied Biosystems 471 A Protein Sequencer ) .
898: 2.5 . Electro-spray ( ES-MS )
899: Afin de déterminer la masse exacte des peptides , les échantillons ont été analysés par spectrométrie de masse ( ES-MS ) .
900: Cette ES-MS a été réalisée à l' aide d' un spectrométre de masse :
901: double quatrupole ( Quattro II , Micromass , Manchester Ltd. , UK ) en mode positif
902: ( Jaquinod et al. , 1993 ) .
903: Les protéines / peptides sont dissous ( à une concentration de 5 pmol / & 206;& 144;l ) dans de l' ACN 50 % contenant 1 % d' acide acétique .
904: 2.6 . Gels 1-D
905: 2.6.1 Gels d' acrylamide Les protéines , issues des hémocytes , du plasma , des organes hématopoïétiques et des cæcums digestifs ont été analysées sur des gels en plaque dont la concentration en acrylamide ( 10 % , 12 , 5 % ou 15 % ) était ajustée en fonction de la réticulation souhaitée .
906: La technique de SDS-PAGE en conditions dissociantes est dérivée de celle décrite par Laemmli ( 1970 ) .
907: Les culots protéiques , obtenus après extraction et précipitation , sont repris dans un tampon de solubilisation ( Tris base 62 , 5 mM , pH 6 , 8 ; SDS 2 % ; glycérol 10 % ; bleu de bromophénol 0 , 01 % ) .
908: Les protéines sont dosées selon la méthode de Bradford ( 1976 ) puis déposées sur gel ( 20 & 206;& 144;g par puits ) où leurs masses moléculaires apparentes sont comparées à celles des marqueurs ( 14 - 95 kDa , Biorad& 194;& 174; ) .
909: Ce gel est constitué d' un gel de séparation [ acrylamide / bisacrylamide 10 à
910: 15 % ;
911: SDS 0 , 1 % ;
912: Tris 375 mM , pH 6 , 8 ;
913: persulfate d' ammonium 0 , 35 & 226;& 128;& 176; ( p / v ) ;
914: TEMED 0 , 03 % ( v / v ) ] et d' un gel de concentration [ acrylamide / bisacrylamide 4 , 5 % ;
915: SDS 0 , 1 % ;
916: Tris 125 mM , pH 6 , 8 ;
917: persulfate d' ammonium 0 , 15 % ( p / v ) ;
918: TEMED 0 , 75 & 226;& 128;& 176; ( p / v ) ] .
919: La migration électrophorétique est réalisée à 100 V pendant 2h30 ( sortie du front de migration ) à température ambiante dans du tampon de migration ( glycine 192 mM ; TRIZMA& 194;& 174; base 25 mM ; SDS
920: 0 , 1 % ;
921: pH 8 , 5 ) .
922: Les gels sont alors fixés et colorés pendant une nuit dans une solution contenant du méthanol ( 50 % ) , de l' acide acétique glacial ( 7 , 5 % ) et du bleu de Coomassie
923: [ 0 , 1 % ( p / v ) ] .
924: Enfin , les gels sont déposés dans une solution de décoloration ( méthanol 40 % ; acide acétique 5 % ) sous agitation constante jusqu& 200;& 135;à l& 200;& 135;obtention de la coloration désirée .
925: 2.6.2 .
926: Gels d' acrylamide d' acrylamide Tris-tricine
927: Pour augmenter la résolution entre les produits de faibles masses moléculaires , l& 200;& 135;analyse des protéines hémocytaires et plasmatiques a été effectuée à l' aide de gel d' acrylamide
928: Tris-tricine .
929: Les échantillons sont préparés de la même manière que précédemment .
930: Le gel comporte également un gel de concentration [ acrylamide 4 % ;
931: Tris 0 , 75 M , pH 8 , 4 ;
932: SDS 0 , 1 % ;
933: persulfate d' ammonium 0 , 09 % ;
934: TEMED 0 , 1 % ( v / v ) ] et d' un gel de séparation [ acrylamide
935: 16 , 5 % ;
936: Tris 1 M , pH 6 , 8 ;
937: glycérol 13 % ( v / v ) ;
938: SDS 0 , 1 % ;
939: persulfate d' ammonium 0 , 75 & 226;& 128;& 176; ;
940: TEMED 83 & 226;& 128;& 176; ( v / v ) ] .
941: La migration a lieu dans du tampon de migration ( Tris 1M ; tricine 1M ; SDS 1 % ) pendant 4 à 6h à 80 V. Les gels sont ensuite colorés puis décolorés de la même façon que précédemment ( § V. 2.6.1 p 51 ) .
942: 2.7 . Gels 2-D
943: La mise au point des conditions optimales de migration des protéines en 2-D a été réalisée au laboratoire .
944: Pour cela , nous nous sommes inspirés des travaux rapportés dans la thèse de C. Félix ( 2004 ) , ce qui nous a notamment permis d' adapter le protocole de réhydratation et les conditions de focalisation isoélectrique ( IEF ) .
945: La réalisation de l' analyse protéomique des échantillons protéiques a été effectuée au cours de stages au sein du Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio-Organique de Strasbourg ( Directeur A. Van Dorsselaer , UMR
946: CNRS-ULP ) , avec l' assistance technique de Mme D. Thiersé .
947: L' analyse des spots d' intérêt ( §
948: V.2.8 p 59 ) a été effectuée au sein de ce même laboratoire par le Dr J-M Strub .
949: 2.7.1 .
950: Préparation des échantillons
951: Les protéines sont extraites des hémocytes par sonication dans du PBS ( § 5.1.1 p 46 ) .
952: Les protéines , précipitées par 6 volumes d' acétone froid pendant une nuit à - 20 °C , sont recueillies par une centrifugation ( 15 000 X g , 10 min , 4 °C ) .
953: Le culot est rincé avec 900 & 206;& 144;l d' acétone froid , puis une nouvelle centrifugation ( 15 000 X g , 10 min , 4 °C ) est réalisée .
954: Après avoir délicatement éliminé le surnageant , le culot protéique est séché soit à l' air libre quelques minutes pour une utilisation rapide , soit au concentrateur sous vide réfrigéré ( Speed Vac , Savant& 194;& 174; ) pendant quelques minutes pour un stockage à & 226;& 128;& 147; 20 °C. Le plasma est soumis à une précipitation partielle par de l& 200;& 135;HCl 0 , 1 M à 4 °C , qui permet l' élimination d' un grande partie de l' hémocyanine , puis est fractionné sur cartouche Sep-Pak C18 .
955: Les composants plasmatiques sont élués par une solution à 80 % d' ACN / TFA 0 , 05 % , puis sont concentrés jusqu'à dessiccation à l' évaporateur sous vide .
956: Les culots anhydres plasmatiques et hémocytaires sont dissous dans un tampon de lyse ( urée 7 M ; thiourée 2 M ; CHAPS 4 % ; IGEPAL CA- 630 0 , 75 % ; DTT 10 mM ) .
957: Le volume de tampon de lyse utilisé dépend de la taille du culot et peut varier de 20 à 300 & 206;& 144;l .
958: L' échantillon en cours de solubilisation est placé sur de la glace et homogénéisé régulièrement à l' aide d' une pipette jusqu'à solubilisation complète du culot ( de quelques min à 1h ) .
959: L& 200;& 135;échantillon est alors soumis à une sonication de 10 min puis est centrifugé à
960: 12 000 X g pendant 2 min .
961: Le surnageant recueilli est maintenu sur la glace jusqu& 200;& 135;au dosage des protéines .
962: 2.7.2 .
963: Dosage des protéines Les protéines sont dosées à l' aide du kit
964: RC DC Protein Assay ( Bio-Rad& 194;& 174; ) dont la méthode est basée sur celle de Bradford ( 1976 ) .
965: Ce kit a été choisi pour sa compatibilité avec les détergents et les agents réducteurs contenus dans le tampon de lyse .
966: Une gamme étalon , à partir d& 200;& 135;une protéine standard ( BSA ) solubilisée dans le tampon de lyse , est préparée à des concentrations allant de 0 à 0 , 8 mg / ml ( incrément de 0 , 2 mg / ml ) .
967: Cinq microlitres des différentes solutions de BSA préparées sont diluées individuellement dans 20 & 206;& 144;l d& 200;& 135;eau bidistillée stérile , puis les réactifs du kit sont ajoutés selon les instructions du fabriquant .
968: Après 5 min d' incubation , l' absorbance est mesurée à 595 nm à l' aide d' un spectrophotomètre .
969: Nos échantillons biologiques sont dosés selon les mêmes modalités à partir d& 200;& 135;un aliquot de 5 & 206;& 144;l .
970: 2.7.3 .
971: Isofocalisation Réhydratation
972: La réhydratation consiste à faire pénétrer les protéines de l' échantillon dans un gel d' acrylamide accolé à une fine languette de plastique :
973: une strip ( Readystrip IPG Strip , Bio-Rad& 194;& 174; ) .
974: Des strips , linéaires et non linéaires , couvrant la gamme de pH la plus étendue ( pH 3 à 10 ) , ont été utilisées .
975: Un volume d' échantillon correspondant à une quantité de 100 à 200 & 206;& 144;g de protéines est prélevé et le volume est ajusté avec du tampon de lyse additionné de 1 % de Bio-Lyte couvrant la gamme de pH 3 - 10 ( Bio-Lyte 3 / 10 Ampholyte , Bio-Rad& 194;& 174; ) .
976: Le volume final dépend de la taille de la strip utilisée , ici le volume peut varier de 300 à 600 & 206;& 144;l .
977: Le plateau à focalisation est placé dans un appareil PROTEAN IEF Cell ( Bio- Rad& 194;& 174; ) optimisé pour réaliser la focalisation isoélectrique .
978: Le volume d' échantillon approprié est placé dans une rigole du plateau à focalisation , et la strip est délicatement posée dans le réceptacle , le gel en contact avec la solution protéique , coté + à l' anode .
979: L' ensemble est recouvert d' huile minérale afin d' éviter tout phénomène d' évaporation .
980: La réhydratation est « active » , c& 200;& 135;est-à-dire qu' elle s' effectue à 50 V pendant 12 à 18 h.
981: Première étape :
982: Conditionnement ( faible voltage pour éliminer les excès de sels ) IPG Strip
983: Quatrième étape :
984: Focalisation finale ( définir un voltage constant et une quantité de Volts x heures )
985: Tableau 4 :
986: Conditions optimisées de focalisation des protéines hémocytaires et plasmatiques pour une strip de 17 cm .
987: Des papiers wicks ( Bio-Rad& 194;& 174; ) préalablement humidifiés avec de l' eau bidistillée stérile sont placés sur chacune des électrodes .
988: Ces papiers jouent le rôle de pièges à sels et autres composés non amphotèriques présents dans l' échantillon .
989: Ce mode de réhydratation améliore l' entrée dans le gel des protéines de masses moléculaires importantes .
990: Focalisation isoélectrique ( IEF ) Avant de lancer le programme d' isofocalisation , les papiers Wicks sont remplacés .
991: Les conditions d' isofocalisation sont détaillées dans le Tableau 4 .
992: Equilibration Avant de déposer la strip sur le gel de deuxième dimension , celui -ci doit être équilibré avec du tampon contenant du SDS .
993: Une première incubation de 20 min dans la solution I d' équilibration ( Tris-HCl 375 mM , pH 8 , 8 ; urée 6 M ; glycérol 20 % ; SDS 2 % ; DTT 130 mM ) permet de saturer le gel en SDS et en agent réducteur
994: ( DTT ) .
995: L' agent réducteur utilisé étant le DTT , il est nécessaire de procéder à une seconde incubation avec de l' iodoacétamide dans la solution II d' équilibration ( Tris-HCl 375 mM , pH
996: 8 , 8 ;
997: urée 6 M ;
998: glycérol 20 % ;
999: SDS 2 % ;
1000: iodoacétamide 135 mM ) pendant 20 min , afin de prévenir la ré-oxydation des résidus cystéine des protéines au cours de l' électrophorèse et d' alkyler le DTT résiduel , minimisant ainsi les traînées verticales sur le gel .
1001: Cette solution d' équilibration II contient également quelques gouttes de bleu de bromophénol qui permet de suivre le front de migration .
1002: Après cette étape , les strips peuvent être conservées à - 80 °C dans des portoirs prévus à cet effet pendant plusieurs semaines .
1003: 2.7.4 .
1004: Deuxième dimension :
1005: électrophorèse en gel de polyacrylamide
1006: Préparation des gels d' acrylamide ( SDS-PAGE )
1007: Après avoir focalisé les protéines selon leur pI , la séparation selon leur masse moléculaire s' effectue sur gel de polyacrylamide 12 % ( gel de séparation ) .
1008: Les protéines sont concentrées au cours de la traversée du gel de concentration , puis la migration selon la masse moléculaire s' effectue sur le gel de séparation .
1009: Les gels de séparation [ acrylamide / PDA ( Piperazine Di-Acrylamide ) 12 % ;
1010: Tris-HCl 375 mM , pH 8 , 8 ;
1011: SDS
1012: 0 , 1 % ;
1013: TEMED 0 , 05 % ;
1014: persulfate d' ammonium 0 , 05 % ] et de concentration ( acrylamide / PDA 3 , 7 %
1015: ; Tris-HCl 128 mM , pH 6 , 8 ;
1016: SDS 0 , 1 % ;
1017: TEMED 0 , 05 % ;
1018: persulfate d' ammonium 0 , 25 & 226;& 128;& 176; ) sont réalisés à partir d' acrylamide / PDA ( acrylamide 30 % / PDA 8 , 23 mM ) .
1019: La solution constituant le gel de séparation est tout d' abord coulée entre deux plaques de verre , une couche de butanol saturé en eau ( ou d' isopropanol ) est ensuite déposée au dessus de la solution d' acrylamide afin d' éviter les irrégularités dans le haut du gel et d' obtenir un front de migration horizontal .
1020: Après polymérisation , le butanol est éliminé et l' espace entre les plaques de verre est rincé plusieurs fois avec de l' eau bidistillée stérile .
1021: Le gel de concentration est alors coulé et , comme précédemment , du butanol saturé en eau est ajouté en surface .
1022: Après élimination du butanol , l' étape suivante consiste à placer la strip en contact étroit avec la surface du gel de concentration .
1023: ( Low Melting Point , SeaPlaque& 194;& 174; GTG& 194;& 174; agarose , Biocompare Inc . ) est coulée entre les deux plaques , au dessus du gel de concentration , empêchant la présence d' air entre la strip et le gel de concentration .
1024: Puis très rapidement , la strip est glissée à travers l' agarose de façon à ce que le contact de la strip se fasse sur toute l' épaisseur du gel de concentration .
1025: Migration
1026: La migration s' effectue dans du tampon Laemmli ( Tris 25 mM ; glycine 192 mM ; SDS 0 , 1 % ; pH 8 , 3 ) .
1027: Au début de l' électrophorèse de seconde dimension en SDS , l' application d' un faible voltage , 25 V pendant 1 h , permet l' élution ( par le SDS et l' urée ) des protéines contenues dans la strip .
1028: La migration s' effectue ensuite à 100 V , pendant 18 h environ , à une température optimale de 20 °C. L' arrêt de la migration s' effectue lorsque le front de migration sort du gel .
1029: Coloration des gels
1030: Deux types de colorations ont été réalisés :
1031: la coloration au nitrate d' argent et la coloration au bleu de Coomassie ou Colloïdal .
1032: D' une manière générale , la coloration au nitrate d' argent est plus sensible et plus résolutive , mais ne permet pas une analyse directe en spectrométrie de masse .
1033: Cette analyse est rendue possible par la coloration des gels au bleu de Colloïdal .
1034: Coloration au nitrate d' argent
1035: Cette méthode de coloration a été utilisée au laboratoire lors d' essais pilotes portant sur la préparation des échantillons et sur les conditions de migration , afin d' obtenir une meilleure résolution .
1036: Le protocole décrit ci-dessous correspond au « Protocole Bobigny » , adapté par T. Rabilloud .
1037: Dès la fin de la migration , les deux plaques de verre sont décollées libérant ainsi le gel d' acrylamide .
1038: Le gel est lavé 5 min dans de l' eau ultrapure désionisée ( MilliQ ) , puis incubé sous agitation 2 X 30 min dans la solution de fixation ( éthanol 30 % , acide acétique
1039: 5 % , eau MilliQ q .
1040: s . p 1l ) à température ambiante .
1041: Quatre lavages de 10 min en eau MilliQ sont ensuite réalisés puis le gel est incubé pendant 1 min dans une solution de thiosulfate de sodium à 0 , 02 % .
1042: Deux nouveaux lavages en eau MilliQ pendant 1 min ont lieu , puis le gel est placé dans la solution de coloration ( nitrate d' argent 11 , 8 mM ; formaldéhyde 0 , 01 % ) pendant 30 à 45 min .
1043: L' étape de révélation débute par le lavage du gel en eau MilliQ 2 X
1044: 30s , puis le gel est incubé dans la solution de révélation ( carbonate de sodium 226 , 4 mM ; thiosulfate de sodium 79 & 206;& 144;M ; formaldéhyde 0 , 01 % ) jusqu'à obtention de l' intensité désirée .
1045: La réaction est stoppée par incubation dans une solution d' arrêt ( Tris 330 mM ; acide acétique 1 % ; glycine 66 , 6 mM ) pendant 30 min à 1 h.
1046: Toutes ces solutions doivent être préparées le jour même et l' ajout de formaldéhyde doit se faire extemporanément .
1047: Le gel peut ensuite être conservé quelques semaines dans une solution de préservation [ glycérol 10 % ;
1048: PEG ( Polyéthylène Glycol 20 000 ) 2 % ] .
1049: Coloration au bleu de Colloïdal G 250 Cette méthode de coloration a été utilisée ( lors de mon stage à Strasbourg ) pour permettre une analyse directe des protéines .
1050: Les gels sont placés dans une solution de fixation ( éthanol 50 % ; acide phosphorique 3 % ) pendant 1 à 2 h. Ils sont ensuite rincés 3 fois dans de l' eau MilliQ pendant 20 à 30 min , puis sont placés dans la solution de coloration ( sulfate d' ammonium 10 % ; acide phosphorique 10 % ; bleu Colloïdal G 250 1 , 2 % ; méthanol 20 % ) pour une durée de 1 à 3 jours .
1051: La décoloration du fond s' effectue ensuite dans l' eau MilliQ jusqu'à obtention de l' intensité désirée .
1052: Les gels peuvent être conservés dans l' eau plusieurs semaines à température ambiante .
1053: 2.8 . Analyses des spots de 2-D Cette étude a été réalisée au laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio- Organique de Strasbourg , par le Dr .
1054: Jean-Marc
1055: Strub .
1056: Lorsque les gels sont suffisamment décolorés , ils sont scannés et comparés .
1057: Les spots contenant les protéines d' intérêt sont choisis et prélevés de manière automatisée par un robot .
1058: Les spots sont ensuite digérés à la trypsine , puis les analyses LC-MS et LC-MS / MS sont effectuées sur un Q / TOF II ( Micromass Ltd. , Manchester , UK ) , équipé d' une source
1059: Z-spray et d' une jonction liquide .
1060: L' instrument est équipé d' une source electrospray , d' un quadrupôle opérant comme un filtre de masse à bande passante variable , d' un hexapôle jouant le rôle de la cellule de collision et d' un analyseur en temps de vol ( TOF ) placé orthogonalement .
1061: L' analyseur de masse en temps de vol est utilisé pour acquérir les données
1062: MS et MS / MS .
1063: Les données de LC-MS / MS sont acquises en utilisant une énergie de collision propre à chaque ion précurseur doublement ou triplement chargé , détecté par l' analyseur à temps de vol puis isolé par le quadrupôle et fragmenté par l' hexapôle .
1064: Les données de MS / MS sont traitées automatiquement par le logiciel ProteinLynx ( Micromass Ldt. , Manchester , UK ) .
1065: Les données ainsi générées sont ensuite utilisées pour réaliser des recherches dans la banque
1066: NCBInr à l' aide de 2 moteurs de recherche Global Server ( Micromass , Ldt. , Manchester , UK ) et Mascot ( Matrix Science Ldt. , London , UK ) .
1067: Les microséquences issues d' un spot sont soumises pour identification sur le site :
1068: hhtp : / / dove .
1069: embl-heidelberg .
1070: de / Blast 2 / msblast .
1071: html .
1072: VI . APPROCHE GENOMIQUE
1073: VI.1 . Extraction des ARNs totaux
1074: Les ARNs totaux de divers tissus ( hémocytes , caecums digestifs , organes hématopoïétiques , coeurs , chaînes nerveuses , cerveaux , ovaires , tissu adipeux et tubes digestifs ) sont extraits ( i ) soit avec le kit « RNeasy minikit » ( Qiagen ) ( ii ) soit en utilisant la méthode d' extraction au LiCl / Urée ( Bothwell et al. , 1990 ) . ( i ) Brièvement , les tissus sont plongés dans un tampon de lyse ( composition non communiquée par le fournisseur ) additionné d' 1 & 206;& 144;l d' inhibiteur de RNAses ( Invitrogen , 40 U / & 206;& 144;l ) et déchiquetés par passages successifs dans une aiguille ( 0 , 8 X 40 mm , Terumo ) .
1075: Les broyats ainsi obtenus sont centrifugés 1 min à 13 000 X g afin d' éliminer les débris cellulaires et les amas adipeux .
1076: Les surnageants sont alors déposés sur une colonne d' affinité en gel de silice .
1077: Après différents lavages , les ARNs totaux sont élués par un volume de 25 à 100 & 206;& 144;l d' eau bidistillée . ( ii ) Les tissus congelés sont homogénéisés au sonicateur dans une solution de LiCl 3M / Urée 6M froid , puis placés une nuit à 4 °C. L' ADN est fragmenté par passages successifs dans une aiguille ( 0 , 8 X 40 mm , Terumo ) .
1078: L' échantillon est centrifugé à 4 °C pendant 30 min à 10 000 X g , puis le culot est lavé avec la solution de LiCl / Urée .
1079: Après reprise du culot dans un volume de tampon TE / SDS ( Tris 10 mM , pH 7 , 4 ; EDTA 1 mM , pH 8 , 0 ; SDS 0 , 5 % ) , un volume de phénol est ajouté .
1080: Les ARNs sont extraits par un traitement au phénol ( v / v ) suivi d' un traitement au chloroforme ( v / v ) .
1081: Les ARNs sont alors précipités dans de l' éthanol 100 % froid ( 2 , 5 v ) et de l' acétate de sodium 3 M pH 6 , 0 ( 1 / 10 v ) .
1082: Après centrifugation et séchage à l' air libre , les ARNs sont repris dans de l' eau bidistillée stérile et conservés à & 226;& 128;& 147; 80 °C. La concentration des ARNs totaux est déterminée par mesure de l' absorbance à 260 nm et leur intégrité est vérifiée par électrophorèse sur gel d' agarose 1 % dans du tampon MOPS 1X ( 3 [ N-morpholino ] propane sulfonicacid , pH 7 , 0 / MOPS 5X : MOPS 0 , 1 M ; acétate de sodium 40 mM ; EDTA 1 mM ) auquel sont ajoutés du formaldéhyde ( 17 % ) et 0 , 57 & 206;& 144;g / ml de bromure d' éthidium ( BET ) .
1083: Avant dépôt sur gel , les échantillons sont séchés sous vide , puis repris dans 10 & 206;& 144;l de tampon de charge ( formamide 48 % ; formalhéhyde 6 , 4 % ; bleu de bromophénol 0 , 25 % ; glycérol 6 , 6 % dans du tampon MOPS 1X ) .
1084: Après migration , les bandes du gel sont visualisées par illumination aux U.V ( Sambrook et al. , 1989 ) .
1085: VI.2 . RT-PCR
1086: Les ARNs totaux ( 1 & 206;& 144;g ) et 1 & 206;& 144;l d' amorces non spécifiques ( mélange d' hexanucléotides de séquence aléatoire , 30 unités de DO / & 206;& 144;l ) sont mélangés dans 6 & 206;& 144;l d' eau bidistillée , puis dénaturés à 65 °C pendant 5 min et placés immédiatement dans la glace .
1087: A cette solution , sont ajoutés 4 & 206;& 144;l de tampon RT 5X ( KCl 375 mM ; MgCl 2 15 mM ; Tris-HCl 250 mM , pH 8 , 3 ) , 2 & 206;& 144;l de DTT ( 100 mM ) , 5 & 206;& 144;l de dNTP ( 2 mM chacun ) et 1 & 206;& 144;l de Moloney-Murine Leukemia Reverse
1088: Transcriptase ( M-MLV M-MLV RT , 200 U / & 206;& 144;l , Gibco-BRL ) .
1089: Après 1 h d' incubation à 42 °C , la solution d' ADNc est stockée à - 20 °C .
1090: L' amplification est réalisée dans un volume de 25 & 206;& 144;l , contenant 0 , 5 & 206;& 144;l de solution d' ADNc , 25 pmol de chaque amorce ( sens et antisens ) , 2 , 5 & 206;& 144;l de tampon Taq 10X ( KCl 50 mM ; MgCl 2 1 , 5 mM ; Tris-HCl 10 mM , pH 9 , 0 ; 0 , 1 % de Triton X-100 ) , 0 , 5 & 206;& 144;l de dNTP ( 0 , 2 mM chacun ) et 0 , 125 & 206;& 144;l de Taq DNA polymérase ( 0 , 625U , Promega ) .
1091: L' amplification est effectuée par 35 cycles correspondant à une dénaturation de l' ADN à 95 °C pendant 1 min , une hybridation des amorces à différentes températures ( de 47 à 62 °C ) pendant 1 min , et une élongation à 72 °C pendant 2 min .
1092: Cette amplification est suivie d' une extension finale de 5 min à 72 °C. Les produits de PCR sont séparés sur gel d' agarose à 1 , 5 % et visionnés aux UV .
1093: VI.3 . Northern Blotting
1094: Les ARNs totaux des différents tissus ( 5 & 206;& 144;g ) sont séparés par électrophorèse en conditions dénaturantes sur un gel d' agarose 1 % ( § VI.1 p 60 ) Après migration , le gel est lavé par 2 bains successifs d' eau bidistillée afin d' éliminer le formaldéhyde qui est préjudiciable à la qualité du transfert .
1095: Le gel est équilibré pendant 15 min dans un tampon SSC 20X ( NaCl 3 M ; citrate de sodium 3 M ; pH 7 , 0 ) puis transféré sur une membrane de nylon ( Q-Biogene& 194;& 174; ) dans le même tampon .
1096: Deux sondes ont été utilisées pour cette étude .
1097: Une sonde correspondant au produit de PCR de 349 pb obtenu par amplification de l' ADNc de l' armadillidine en utilisant les amorces Arm 5 et Arm 6 , et une sonde correspondant à l' ADNc partiel codant l' actine d' Armadillidium vulgare .
1098: Chaque sonde à tester est marquée par la méthode d' amorçage aléatoire .
1099: Pour cela , les fragments d' ADNc ( 100 ng dans 22 & 206;& 144;l d' eau bidistillée stérile ) sont dénaturés ( 100 °C , 5 min ) , puis refroidis sur glace .
1100: La solution est mélangée à
1101: 5 & 206;& 144;l d' une solution d' hexadésoxyribonucléotides ( Pharmacia ) , 20 & 206;& 144;l de tampon de réaction
1102: ( N- [ 2- hydroxyéthyl ] pipérazine- [ 2 - éthanesulfonate ] ( HEPES ) 0 , 5 M , pH 6 , 6 ;
1103: MgCl 2 12 mM ;
1104: & 206;& 134;-mercaptoéthanol 25 mM ;
1105: Tris-HCl 12 mM , pH 8 , 0 ) , contenant les désoxyribonucléotides dATP , dTTP , dGTP ( 0 , 1 mM chacun ) , 2 & 206;& 144;l de la solution de nucléotides radioactifs [ & 206;& 133;- 32 P ] -dCTP ( 3 Ci / & 206;& 144;mol ; 10 & 206;& 144;Ci / & 206;& 144;l ; Amersham ) et 0 , 8 & 206;& 144;l d' une solution d' ADN polymérase ( fragment de Klenow , 6 U / & 206;& 144;l , Gibco-BRL ) ( Feinberg et al. , 1983 ) .
1106: Le mélange réactionnel est incubé pendant 2h à 37 °C , puis la réaction est stoppée par addition de 20 & 206;& 144;l d' une solution d' EDTA 0 , 5 M , pH 8 , 0 .
1107: Une fraction de 0 , 5 & 206;& 144;l , prélevée avant l' arrêt de la réaction , est précipitée dans 5 ml d' acide trichloracétique ( 10 % ) pour mesurer la radioactivité incorporée après filtration sur membrane Whatman GF / C .
1108: La membrane de nylon , sur laquelle les ARNs ont été transférés , est réhydratée dans une solution d' EDTA 2 mM pH 8 , 0 , SDS 0 , 1 % , puis préhybridée pendant 2 h à 42 °C dans le tampon d' hybridation [ formamide 40 % ;
1109: Dextran sulphate 10 % ;
1110: SSC 4X ;
1111: Denhardt's solution 1X ( Ficoll type 400 , 10 mg / ml ; BSA 10 mg / ml ; Polyvinylpyrrolidone 10 mg / ml ) ;
1112: Tris-HCl 20 mM , pH 7 , 4 , 0 , 3 mg / ml de sperme de saumon fraîchement dénaturé ] .
1113: L' hybridation dans le tampon d' hybridation contenant la sonde radioactive est réalisée pendant la nuit à 42 °C. La membrane est ensuite lavée 2 fois pendant 30 min avec une solution de SSC 2X , SDS 0 , 1 % à température ambiante , puis 2 fois 30 min à 52 °C avec une solution de SSC 0 , 1X , SDS 0 , 1 % .
1114: La membrane ainsi hybridée est révélée et analysée par un phosphorImager ( Storm& 226;& 132;& 162; system , Molecular
1115: Dynamics ) .
1116: VI.4 . Clonage de différents ADNc
1117: Afin d' obtenir la séquence complète codée par le cadre de lecture ouvert du gène de l' armadillidine et du gène de l' hémocyanine , 1 & 206;& 144;g d' ARNs totaux d' hémocytes et de caecums digestifs ( lieux de synthèse respectifs de ces 2 molécules ) ont été amplifiés en utilisant la technique SMART ( SMART& 226;& 132;& 162;PCR cDNA synthesis kit , Clontech ) selon les instructions du fabriquant .
1118: Les produits de PCR obtenus ( correspondant aux ADNc pleine taille ) ont ensuite été clonés dans le vecteur pGEM- T-easy ( Promega ) .
1119: La sélection des clones positifs a été effectuée par PCR sur les colonies obtenues en utilisant des amorces spécifiques de l' armadillidine ou de l' hémocyanine .
1120: Le programme de PCR comportait 35 cycles de 2 min à 94 °C , 1 min à 55 °C , 4 min à 72 °C et une étape finale à 72 °C pendant 5 min .
1121: Au moins 3 clones positifs , pour l' armadillidine et l' hémocyanine , ont été séquencés dans les 2 directions par un séquenceur d' ADN automatisé ( ABI Prism model 377 , Perkin- Elmer ) .
1122: Figure 8 :
1123: Schéma de la construction d' une banque d' ADNc à l' aide du kit
1124: Creator
1125: TM Smart
1126: TM cDNA Library Construction ( Clontech ) .
1127: Les séquences nucléotidiques et d' acides aminés déduites ont été comparées dans les bases de données disponibles sur le Biotechnology information du National Institut of Health ( NIH ) par le service BLAST .
1128: VI.5 . Construction d' une banque d' ADNc d' hémocytes d' Armadillidium vulgare
1129: Un microgramme d' ARNs totaux , issus des hémocytes , a été utilisé pour construire une banque d' ADNc .
1130: Cette banque a été réalisée à l' aide du kit Creator SMART cDNA Library Construction
1131: Kit ( Clontech ) , selon les recommandations du fabriquant .
1132: Brièvement , une amorce oligo ( dT ) modifiée ( CDS III / 3 ' ) amorce la synthèse du premier brin d' ADNc qui , lorsqu' elle se termine , permet la ligature d' un adaptateur ( oligo SMART IV ) à l' extrémité 5 ' de l' ADNc ( Figure 8 ) .
1133: L' utilisation d' amorces de séquences complémentaires aux séquences des adaptateurs CDS III et SMART IV permet d' amplifier l' ADNc par une PCR longue distance ( LD-PCR ) et ce , afin de générer des ADNc pleine taille .
1134: Avec ce kit , la fabrication des ADNc pleine taille selon la technologie SMART permet l' incorporation de sites de restriction asymétriques Sfi ( A et B ) contenus dans les adaptateurs CDS III et SMART IV respectivement localisés aux extrémités 3 ' et 5 ' ( Figure 9 ) .
1135: Figure 9 .
1136: Comparaison des séquences de reconnaissance Sfi I ( A et B )
1137: Après digestion Sfi I et fractionnement par taille , l' ADNc est ligaturé dans le vecteur pDNR-LIB prédigéré par Sfi I .
1138: Des bactéries ultracompétentes sont transformées par choc thermique ( 30s , 42 °C ) avec le plasmide recombinant et étalées sur un milieu LB ( Tableau 2 , p 42 ) gélosé supplémenté de 30 & 206;& 144;g / ml de chloramphénicol .
1139: La taille des inserts contenus dans 20 clones prélevés au hasard a été estimée par PCR , en utilisant des amorces spécifiques du vecetur pDNR-LIB , et en moyenne chaque recombinant contient un insert d' ADNc de 1 kb .
1140: VII . APPROCHE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE
1141: VII .1 . Microscopie photonique
1142: Les hémocytes d' Armadillidium vulgare ont été observés en microscopie photonique afin de les dénombrer .
1143: Pour ce faire , l' hémolymphe ( 15 & 206;& 144;l ) de 20 animaux est prélevée séparément dans une solution anticoagulante ( MAS , v / v ) , puis un aliquot de chaque prélèvement ( 5 & 206;& 144;l ) est dilué et coloré dans 15 & 206;& 144;l de bleu Trypan ( 0 , 4 % dans du
1144: MAS ) .
1145: La préparation colorée ( 20 & 206;& 144;l ) est étalée sur une cellule de Mallassez , observée à l' aide d' un microscope inversé , ce qui permet de compter les hémocytes .
1146: VII .2 . Microscopie électronique à transmission ( MET )
1147: Fixation des hémocytes L' hémolymphe de 10 à 30 animaux est prélevée , sur glace , dans une solution anticoagulante ( MAS , v / v ) .
1148: Les hémocytes sont séparés du plasma par centrifugation ( 800 X g , 4 °C , 15 min ) , puis lavés par une solution de MAS et centrifugés à nouveau dans les mêmes conditions .
1149: Pour cette étude de cytologie fine , la technique de double fixation adaptée aux isopodes terrestres ( Martin , 1981 ) a été mise en oeuvre avec quelques modifications .
1150: Le culot d' hémocytes lavé est plongé dans le premier fixateur refroidi ( glutaraldéhyde 9 % ; cacodylate de sodium 0 , 3 M , pH 7 , 3 - 7 , 4 ; NaCl 3 % ; v / v / v ) pendant 45 min à 4 °C. Après centrifugation ( 800 X g , 4 °C , 15 min ) , les cellules sont placées dans une solution de lavage ( cacodylate de sodium 0 , 3 M ; NaCl 3 % ; sucrose 0 , 8 M ; v / v / v ) pendant 15 min à 4 °C. Dans cette solution de lavage , le rôle du sucrose est de maintenir l' osmolarité à 750 mOsm .
1151: Après centrifugation ( 600 X g , 10 min , 4 °C ) , le culot d' hémocytes est inclus dans une solution de gélose à 2 % à la limite de la solidification ( environ 37 °C ) .
1152: Après la prise en masse de la gélose , des petits cubes d' un mm 3 sont découpés , sous loupe binoculaire , à l' endroit où la concentration en cellules parait importante .
1153: Ces cubes sont plongés dans la solution de lavage iso-osmotique pendant 2h à 4 °C. Ensuite , après élimination du liquide de lavage , les blocs de gélose sont incubés dans le post-fixateur au tetroxyde d' osmium ( cacodylate de sodium 0 , 3 M ; NaCl 5 , 5 % ; OsO 4 4 % ; v / v / v ) pendant 45 min .
1154: La déshydratation est réalisée dans des solutions d' acétone de concentration croissante ( de 35 % à 100 % ) .
1155: L' imprégnation est effectuée en 2 étapes :
1156: - la première dans un mélange ( v / v ) acétone 100 % -résine ( Spurr , Polyscience Inc . ) pendant
1157: 12 h à température ambiante .
1158: - la seconde dans la résine pure dans les mêmes conditions .
1159: L' inclusion est effectuée dans des « moules à plat » qui permettent une orientation des pièces ;
1160: la résine est mise à polymériser pendant 24h dans une étuve à 70 °C. Les coupes semifines et ultrafines sont réalisées sur un ultramicrotome ( Reichert OMU3 ) muni soit d' un couteau de verre , soit d' un couteau de diamant .
1161: Les coupes semifines d' 1 & 206;& 144;m d' épaisseur sont colorées au bleu de Toluidine à 1 % ( pH 8 , 8 ) .
1162: Les coupes ultrafines , récoltées sur des grilles en cuivre ( 300 mesh ) sont contrastées selon la méthode de Reynolds ( 1963 ) en 2 temps :
1163: - acétate d' uranyle 1 % dans de l' alcool 50 % , 1 min - citrate de plomb , 10 min ( à l' obscurité ) Les observations ont été effectuées sur le microscope électronique à transmission JEOL 100C du Service Interdisciplinaire de Microscopie et d' Imagerie Scientifique ( SIMIS , université de Poitiers ) .
1164: Fixation des organes hématopoïétiques
1165: Les organes hématopoïétiques des animaux sains subissent une double fixation classique .
1166: Par contre , les organes hématopoïétiques des animaux infectés par Wolbachia , subissent une post-fixation réduite en temps ( 5 min ) avec une concentration en OsO 4 amenée à 1 % final afin de préserver leur intégrité .
1167: Fixation en vue de l' étude des phénomènes d' encapsulation et de phagocytose
1168: Afin de mettre en évidence les phénomènes d' encapsulation , des petits cylindres de résine ont été coulés puis , après polymérisation , découpés en morceaux de 5 mm environ , et ont ensuite été introduits sous la cuticule des animaux .
1169: Après quelques jours d' implantation ( 8 et 16 jours ) , les animaux ont été disséqués et les morceaux de résine récupérés .
1170: Ces cylindres de résine ont été fixés de la même manière que les organes hématopoïétiques sains .
1171: Pour rendre compte du pouvoir de phagocytose de certains hémocytes , des particules d' encre de Chine ont été inoculées à des d' animaux .
1172: L' encre de Chine ( Pelikan , Günther Wagner ) contient du phénol qui est toxique pour nos animaux , il convient donc de l' éliminer .
1173: Pour ce faire , 200 & 206;& 144;l d' encre de Chine sont centrifugés ( 15 000 X g , 10 min ) et le surnageant contenant le phénol est éliminé .
1174: Le culot de particules est resuspendu dans 200 & 206;& 144;l d' eau bidistillée puis centrifugé ( 15 000 X g , 10 min ) .
1175: Le culot de particules est ainsi lavé 2 fois , puis est repris dans 50 & 206;& 144;l de Ringer .
1176: Cette suspension est injectée dans la cavité générale à raison de 1 & 206;& 144;l par animal et ce , sans trouble ( s ) apparent ( s ) .
1177: L' hémolymphe a été prélevée 2 et 3 jours après l' injection et les hémocytes ont subit une double fixation classique , comme précédemment décrit pour ces cellules ( § VII . 2 . p 66 ) .
1178: VII .3 . Microscopie électronique à balayage ( MEB )
1179: L' échantillon biologique doit être préparé afin de supporter au mieux le vide dans le microscope et l' impact du faisceau .
1180: S' agissant de cellules libres , il faut les fixer sur un support :
1181: nous avons utilisé des lamelles de verre .
1182: Des lamelles , lavées à l' acétone , sont plongées dans une solution de polylysine 0 , 1 % ( pH 8 , 5 ) pendant 5 min puis elles sont rincées à l' eau bidistillée et séchées à l' air libre .
1183: 3.1 . Application de la double fixation
1184: Nous avons utilisé les mêmes fixateurs et liquides de lavage que dans la technique de fixation appliquée pour le microscopie à transmission ( § VII . 2 . p 66 ) .
1185: En bref , sur les lamelles recouvertes de polylysine , disposées au fond d' une boîte de Pétri , nous déposons
1186: 200 & 206;& 144;l du premier fixateur ( glutaraldéhyde 9 % ; cacodylate de sodium 0 , 3 M pH 7 , 3 - 7 , 4 ; NaCl
1187: 3 % ;
1188: v / v / v ) puis 20 & 206;& 144;l d' hémolymphe instantanément prélevés ;
1189: la fixation a lieu à 4 °C pendant environ 1h30 .
1190: Les lamelles sont essorées sur le tranche et plongées délicatement dans une coupelle contenant le liquide de lavage pendant 1h. Après aspiration du liquide de lavage , le deuxième fixateur ( tetroxyde d' osmium ) est introduit dans la coupelle pendant 10 à 15 min , à température ambiante .
1191: Après aspiration du post fixateur , une déshydratation progressive par l' alcool est opérée ( 35 % à 100 % ) .
1192: 3.2 . Passage au point critique et métallisation
1193: Afin de limiter les déformations des cellules lors de la dessiccation un appareil ( type
1194: Balzers ) permet de substituer le CO2 liquide au solvant intermédiaire ( alcool 100 % ) .
1195: Le CO2 est utilisé pour les caractéristiques de son point critique :
1196: température 32 °C sous une pression de 73 atmosphères .
1197: La métallisation consiste à recouvrir l' échantillon parfaitement desséché d' une mince couche d' un métal conducteur ( Au ) ce qui permet d' accroître l' émission d' électrons secondaires .
1198: Cette opération est réalisée avec un pulvérisateur cathodique
1199: Balzers .
1200: La couche d' or est très homogène et atteint 20 nm d' épaisseur ( pour un temps de pulvérisation de 200s ) .
1201: Les observations ont été effectuées sur le microscope électronique à balayage ( JEOL 840A , scanning microscope ) du SIMIS ( Poitiers ) .
1202: Chapitre I
1203: Cellules impliquées dans la réponse immunitaire :
1204: Approche histologique et cytologique
1205: CELLULES IMPLIQUÉES DANS LA RÉPONSE IMMUNITAIRE :
1206: A PPROCHE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE
1207: Les animaux pluricellulaires se protègent des infections microbiennes par deux types de réponse immunitaire , la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire acquise .
1208: Ces deux types de réponse , encore appelées réponse immédiate et réponse adaptative respectivement , se manifestent uniquement chez les vertébrés .
1209: Chez les invertébrés , seule l' immunité innée existe .
1210: C' est un système de défense rapide et efficace qui fait intervenir deux types de réponses , une réponse humorale et une réponse cellulaire .
1211: Chez les arthropodes , les hémocytes ( cellules circulantes dans l' hémolymphe ) jouent un rôle primordial dans les deux aspects de la réponse immunitaire innée .
1212: Chez les insectes , il est maintenant généralement admis que trois types cellulaires composent la population d' hémocytes circulants dans la cavité générale , les plasmatocytes , les granulocytes et les oenocytes .
1213: Les plasmatocytes et les granulocytes sont des cellules qui possèdent des facteurs d' adhésion et qui sont impliquées dans la phagocytose et dans la formation de capsules et de nodules .
1214: Les oenocytes ne possèdent pas ces facteurs d' adhésion mais contiennent les précurseurs de la phénoloxydase , enzyme principale de la cascade de mélanisation ( Lavine et Strand , 2002 ; pour revue ) .
1215: Chez la drosophile , exceptés les plasmatocytes , les cellules hémocytaires ne portent pas les mêmes noms , les cellules à cristaux correspondent aux oenocytes et les lamellocytes aux cellules granulaires ( Meister , 2004 ) .
1216: Chez les crustacés , beaucoup moins d' informations sont disponibles sur la morphologie et la structure des hémocytes , mais également sur la représentation des différentes populations d' hémocytes .
1217: Les crustacés décapodes possèdent trois types d' hémocytes morphologiquement différents ( Bauchau , 1980 ) .
1218: Ces populations ont notamment été décrites chez les crevettes
1219: ( Vazquez et al. , 1997a ; Gargioni et Barracco , 1998 ) , chez l' écrevisse et chez le crabe ( Söderhäll et Smith , 1983 ) .
1220: On trouve ainsi ( 1 ) les hémocytes hyalins dépourvus de granules ;
1221: ( 2 ) les hémocytes semi-granulaires pourvus de petits granules en nombre variable ; ( 3 ) les hémocytes granulaires pourvus de gros granules en grand nombre .
1222: Concernant la fonction de ces hémocytes , l' ambiguïté porte sur les cellules douées de phagocytose .
1223: Des études réalisées chez les crevettes ont montré que les hémocytes granulaires et semi-granulaires sont les cellules phagocytaires ( Hose et al. , 1990 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) et que les cellules hyalines jouent un rôle dans la coagulation .
1224: En effet , les cellules hyalines comportent chez ces espèces moins de protéines que les deux types granulaires et notamment moins de protéines lysosomales ( Hose et al. , 1990 ; Lanz et al. , 1993 ) .
1225: Des études similaires faites chez les crabes et les écrevisses ont montré que les hémocytes hyalins présentent également moins de protéines que les deux autres types cellulaires ( Johansson , 1999 ) , mais qu' ils sont principalement impliqués dans la phagocytose , même si les hémocytes semi-granulaires peuvent également , dans une moindre mesure , jouer ce rôle .
1226: Les hémocytes granulaires et semi-granulaires , quant à eux , stockent dans leurs granules les protéines du système immunitaire , tels que les agglutinines , les péroxinectines , des enzymes cytolytiques , toutes les enzymes du système prophénoloxydase , les peptides antibactériens .
1227: Ces protéines sont libérées de façon coordonnée sur le site de l' infection ou de la blessure ( Smith et Söderhäll , 1983 ; Söderhäll et al. , 1985 ; Söderhäll et al. , 1986 ; Kobayashi et al. , 1990 ; Johansson et al. , 2000 ) .
1228: Chez les isopodes terrestres , les seules données disponibles concernant les différentes populations d' hémocytes sont consignées dans la thèse de M-F Coutant , ( 1977 ) .
1229: Ce travail sur l' étude cytologique et fonctionnelle des hémocytes et des organes hématopoïétiques est centré sur l' isopode terrestre
1230: Porcellio dilatatus .
1231: Chez cette espèce , assez proche phylogénétiquement de notre modèle Armadillidium vulgare , cinq types d' hémocytes ont été décrits .
1232: Ces cinq types peuvent être néanmoins regroupés au sein des trois types d' hémocytes décrits précédemment chez les décapodes .
1233: La première population est constituée de cellules dépourvues de granule et appelées cellules hyalines .
1234: Les deuxième et troisième populations correspondent respectivement aux hémocytes semi-granulaires et granulaires et sont spécialisées dans la production , le stockage et la sécrétion de protéines .
1235: En effet , l' appareil de golgi et le réticulum endoplasmique granulaire y sont très développés et les substances élaborées s' accumulent dans les granules .
1236: Figure 10 :
1237: Hémocytes observés au microscope électronique à balayage .
1238: A .
1239: Ensemble de la population hémocytaire , cellules de tailles et de formes différentes
1240: ( X 700 ) .
1241: B . Hémocytes lisses , cellules arrondies de petite taille ( X 2
1242: 300 ) .
1243: C . Hémocyte hérissé , cellule ovoïde de grande taille présentant de nombreuses aspérités favorisant l' adhésion ( X 3 300 ) .
1244: Avant d' entreprendre une étude moléculaire et d' identifier les protéines impliquées dans la réponse immunitaire innée , il convenait de caractériser par des caractères cytologiques les différents types d' hémocytes chez Armadillidium vulgare .
1245: I. OBSERVATION DES HÉMOCYTES EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE ÀBALAYAGE .
1246: Nous avons donc , dans un premier temps , observé les différentes populations d' hémocytes chez
1247: Armadilidium vulgare infectés ou non par Wolbachia en microscopie électronique à balayage ( MEB ) .
1248: Pour l' observation des hémocytes en MEB , l' hémolymphe a été placée directement sur des lamelles préalablement induites de polylysine , puis ont alors subi les traitements appropriés pour une bonne visualisation
1249: ( §VII . 3 . p 68 ) .
1250: La population d' hémocytes ( Figure 10 , A. ) semble très hétérogène , les cellules présentent des tailles différentes mais également des formes très variées , allant de cellules très aplaties à des cellules très rondes .
1251: Les figures 10 ,
1252: B . et C. montrent deux types de cellules :
1253: - Des hémocytes de petite taille ( 8 & 206;& 144;m environ )
1254: - Des hémocytes ovoïdes , d' aspect hérissé , plus gros que les précédents ( 12 & 206;& 144;m ) et qui présentent de nombreuses aspérités
1255: II . OBSERVATION DES HÉMOCYTES EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION
1256: Afin d' affiner la caractérisation morphologique de différents types d' hémocytes , nous avons eu recours à l' observation en microscopie électronique à transmission ( MET ) qui nous apportait des caractères cytologiques .
1257: Pour ce faire , un pool d' hémocytes ( 10 animaux ) a été fixé , inclus en gélose pour faciliter les manipulations , puis traité selon le protocole classique de préparation des échantillons pour l' observation en MET ( § VII . 2 . p 66 ) .
1258: L' observation de coupes ultrafines contrastées nous a permis de mettre en évidence la présence de trois types d' hémocytes chez Armadillidium vulgare ( Figure 11 ) .
1259: Les différents types d' hémocytes observés correspondent à ceux décrits chez Porcellio dilatatus ( Coutant , 1977 ) et ceux décrits chez les crustacés décapodes ( Bauchau , 1980 ) .
1260: Les hémocytes hyalins sont constitués d' un noyau volumineux avec des contours réguliers , ils ne présentent pas de granules .
1261: Les hémocytes semi-granulaires , qui constituent la population la plus importante , sont caractérisés par la présence plus ou moins abondante de petits granules , denses aux électrons , arrondis , d' un diamètre variant de 0 , 3 à 0 , 8 & 206;& 144;m .
1262: Le rapport noyau / cytoplasme dans ces cellules est beaucoup moins important que celui des hémocytes hyalins .
1263: Les hémocytes granulaires , quant à eux , présentent de nombreux gros granules , également denses aux électrons , piriformes , d' un diamètre de 0 , 6 à 1 , 6 & 206;& 144;m , mais également un noyau peu volumineux et ayant des contours irréguliers .
1264: Comme chez Porcellio dilatatus , il semble que la population la plus représentée soit celle des hémocytes semi-granulaires , population qui augmente avec l' âge de l' animal ( Coutant , 1977 ) , tandis que la moins fréquente est constituée des hémocytes hyalins .
1265: Le nombre d' hémocytes granulaires est intermédiaire entre les deux autres populations .
1266: Cette caractéristique se retrouve également chez Macrobrachium rosenbergii ou Macrobrachium acanthurus ( décapodes palaemonides ) , cependant ceci n' est pas une généralité chez les crustacés car chez Penaeus paulensis paulensis , par exemple , ce sont les hémocytes hyalins qui sont le plus représentés dans l' hémolymphe ( Gargioni et Barracco , 1998 ) .
1267: Mis à part leur variation numérique , les trois types d' hémocytes d' Armadillidium vulgare sont semblables cytologiquement à ceux décrits dans l' ensemble des crustacés .
1268: Nous pouvons donc supposer que leurs implications dans la réponse immunitaire seront proches de celles décrites chez les écapodes et principalement chez l' écrevisse ( Pacifastacus leniusculus ) pour laquelle la réponse immunitaire est la mieux décrite .
1269: A . Hémocyte hyalin :
1270: noyau volumineux , absence de granules .
1271: B . Hémocyte semi-granulaire :
1272: présence de petits granules peu nombreux , noyau peu volumineux .
1273: C . Hémocyte granulaire :
1274: noyau peu volumineux , présence de gros granules piriformes en grand nombre .
1275: Figure 11 :
1276: Les différents types cellulaires observés dans l' hémolymphe d' Armadillidium vulgare .
1277: A .
1278: Hémocyte hyalin .
1279: B . Hémocyte semi-granulaire .
1280: C . Hémocyte granulaire .
1281: Figure 12 :
1282: Hémocyte granulaire d' Armadillidium vulgare infecté par
1283: Wolbachia , observé au microscope électronique à transmission ( X 8 000 ) .
1284: La cellule contient de nombreux granules plus ou moins denses .
1285: Le noyau présente une forme très contournée .
1286: Si des agents pathogènes franchissent la première barrière physique , constituée par le tégument , les hémocytes vont détecter les microorganismes et déclencher la réponse immunitaire .
1287: Chez l' écrevisse , il a été montré que ce sont les cellules semi-granulaires qui sont les plus sensibles aux microorganismes et qui réagissent en premier .
1288: Elles vont activer , par l' intermédiaire de protéines telles que les péroxinectines , les cellules granulaires qui ainsi stimulées vont libérer dans le plasma les composants du système prophénoloxydase , mais aussi des peptides antibactériens et d' autres molécules impliquées dans la réponse immunitaire
1289: ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
1290: Les hémocytes semi-granulaires et les hémocytes granulaires sont impliqués dans les phénomènes d' encapsulement des particules étrangères de grande taille , cependant les cellules semi-granulaires semblent être plus actives .
1291: Bien que de façon limitée , les cellules semi-granulaires possèdent également la capacité de phagocyter les microorganismes , ce sont les cellules hyalines qui sont les principales cellules phagocytaires ( Thörnqvist et Söderhäll , 1997 ) .
1292: III . « FRAGILITÉ » DES HÉMOCYTES INFECTÉS PAR Wolbachia
1293: Des observations de cytologie structurale ont été réalisées de façon complémentaire chez Armadillidium vulgare infecté par Wolbachia .
1294: Les mêmes types hémocytaires ont été retrouvés , la seule différence cytologique visible étant la présence d' éléments bactériens dans les cellules hémocytaires .
1295: La Figure 11 présente un hémocyte granulaire contenant une bactérie .
1296: Cette bactérie est ici située à l' intérieur d' une vacuole à proximité du noyau .
1297: La bactérie semble ainsi être enfermée dans un endosome qui n' aurait pas fusionné avec les lysosomes , puisque normalement cette fusion devrait conduire à la destruction de la bactérie .
1298: La présence de la bactérie dans une vacuole laisse penser qu' elle entre dans les cellules par des phénomènes d' endocytose ou de phagocytose .
1299: Cependant , la bactérie est retrouvée préférentiellement dans les cellules granulaires , ce qui est en première analyse , contradictoire avec la capacité de ces cellules à phagocyter les corps étrangers , si on se réfère aux études réalisées sur l' écrevisse .
1300: En effet , chez l' écrevisse , les cellules hyalines et parfois les cellules semi-granulaires sont considérées comme les cellules phagocytaires les plus efficaces ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
1301: Même s' il ne semble pas exister de différences notables dans l' ultrastructure même de la cellule , les hémocytes d' Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia apparaissent , dès la réalisation des coupes semi-fines , sans contraste entre les parties nucléaires et cytoplasmiques .
1302: L' observation des coupes ultrafines confirme cette dégradation qui se manifeste par de nombreuses vacuoles , des figures myéliniques et une mauvaise préservation des membranes plasmiques et nucléaires .
1303: Ainsi , il semble que ces cellules soient particulièrement sensibles à l' action du tétroxyde d' osmium ;
1304: pour obtenir nos clichés , nous avons dû adapter la concentration et le temps d' action de ce composé lors de la post-fixation .
1305: Cette fragilité pourrait s' expliquer par la présence de la bactérie qui serait capable d' interagir avec les éléments du cytosquelette .
1306: Ce type d' interactions a été décrit chez les Ehrlichia , les Rickettsia ( Gouin et al. , 2005 ) mais également chez d' autres bactéries non endocellulaires comme les Listeria ( Loisel et al. , 1997 ) ou les Salmonella ( Brumell et Grinstein , 2003 ; pour revue ) .
1307: De même , il est couramment admis que lors de relations hôte / parasite , le cytosquelette des individus hôtes est déstabilisé soit par le parasite lui-même [ cas des Leishmania ( Lodge et Descoteaux , 2005 ) ] , soit par des virus mutualistes que portent certains parasitoïdes [ cas des endoparasites d' invertébrés ;
1308: ( Turnbull et al. , 2004 ) ] .
1309: Les altérations de la structure du cytosquelette peuvent concerner les fibres d' actine ou les microtubules mais également les protéines liant ces complexes fibrillaires ( Rikihisa et al. , 1994 ; Gouin et al. , 2005 ; Selbach et Backert , 2005 ) .
1310: Une étude sur l' inhibition de l' endocytose des Ehrlichia risticii risticii par les macrophages a montré que les clathrines , les microfilaments et les microtubules jouaient un rôle dans l' entrée des bactéries dans la cellule mais aussi sur leur prolifération ( Rikihisa et al. , 1994 ) .
1311: La confirmation de cette désorganisation suspectée du cytosquelette pourra être analysée en microscopie confocale par exemple , en marquant les fibres d' actine et les microtubules et en comparant les hémocytes infectés ou non par la bactérie .
1312: Pour marquer Wolbachia , l' utilisation d' anticorps anti-wsp couplés à un fluorochrome différent de ceux utilisés pour le cytosquelette permettrait de localiser les bactéries par rapport au cytosquelette .
1313: Wsp est une protéine membranaire du feuillet externe de la paroi de Wolbachia qui a été caractérisée initialement par Braig
1314: ( Braig et al. , 1998 ) chez une souche parasite de la drosophile , puis qui a été mise en évidence chez la plupart des souches de Wolbachia présentes chez de nombreux arthropodes ( Bouchon et al. , 1998 ; Jeyaprakash et Hoy , 2000 ) .
1315: En plus de cette atteinte probable sur le cytosquelette , il est à noter que lors de comptages des hémocytes , nous avons toujours enregistré une baisse significative du nombre des hémocytes chez les animaux infectés par la bactérie ( Annexe II ) .
1316: Cependant , Coutant ( 1977 ) a montré que le nombre d' hémocytes varie selon le cycle de mue et qu' il devient plus important juste avant la mue .
1317: Cette augmentation brutale ( X2 ) du nombre d' hémocytes pourrait être destinée à prévenir l' augmentation du volume hémolymphatique consécutive à l' absorption d' eau qui accompagne l' exuviation .
1318: De plus , cet auteur a démontré que le nombre d' hémocytes augmentait avec la masse des animaux .
1319: Ce dernier paramètre n' ayant pas été pris en considération lors de notre étude , il conviendrait de réitérer cette expérience en tenant compte de la masse , de l' âge et du stade de mue des animaux .
1320: De nos observations , il ressort que Wolbachia semble :
1321: - modifier le nombre d' hémocytes circulants ( diminution ) ;
1322: cette variation quantitative peut être liée à un ralentissement du fonctionnement des organes hématopoïétiques , ainsi qu' à une réduction de la durée de vie des hémocytes parasités .
1323: - les rendre plus fragiles et plus « sensibles » à la fixation , ce que nous avons interprété comme une possible déstabilisation du cytosquelette .
1324: IV . ASSIGNEMENT DE LA FONCTION DE PHAGOCYTOSE
1325: Notre modèle semblant s' écarter du modèle écrevisse , nous avons voulu savoir quels étaient les types cellulaires impliqués dans la phagocytose .
1326: Pour cela , nous avons injecté une suspension de particules d' encre de chine ( 30 - 40 nm ) à nos animaux et après 2 ou 3 jours d' incubation , nous avons collecté les hémocytes puis nous les avons traités en vue d' observations en MET .
1327: L' examen à l' échelle ultrastructurale nous a montré que les particules d' encre de chine ont été phagocytées principalement par les cellules hyalines ( Figure 13 ) .
1328: Dans ces cellules , de nombreux lysosomes contenant les particules d' encre de chine mais également des endosomes primaires sont observables .
1329: Des particules ont également été retrouvées dans des lysosomes d' hémocytes semi-granulaires , par contre nous n' avons jamais observé de cellules granulaires contenant de particules d' encre de chine .
1330: Il semblerait donc que chez Armadillidium vulgare , comme chez l' écrevisse , les cellules hyalines et semi-granulaires possèdent les propriétés de phagocytose , à l' opposé de ce qui a été décrit chez les crevettes chez lesquelles ce sont les cellules granulaires qui jouent principalement ce rôle .
1331: De ce fait , la présence de Wolbachia dans les cellules granulaires ne serait pas la conséquence d' une phagocytose mais plutôt d' une endocytose , probablement provoquée par la bactérie elle-même .
1332: Ce type d' endocytose provoquée par une bactérie a déjà été montré chez des bactéries endocellulaires comme Ehrlichia risticii risticii ( Rikihisa et al. , 1994 ) ou d' autres bactéries du genre Rickettsia mais également chez des bactéries telles que les Brucella ( Gorvel et Moreno , 2002 ) ou les Salmonella ( Brumell et Grinstein , 2004 ; pour revue ) .
1333: Figure 13 .
1334: A. :
1335: Cellules hyalines d' Armadillidium vulgare après injection de particules d' encre de chine ( 30 - 40 nm ) .
1336: Les particules d' encre de chine sont observées dans des lysosomes .
1337: La présence d' endosomes primaires témoigne de l' activité phagocytaire et lysosomale .
1338: Figure 13 .
1339: B :
1340: Hémocyte semi-granulaire d' Armadillidium vulgare après injection de particules d' encre de chine ( X 12 000 ) .
1341: Les particules sont visibles dans des vacuoles lysosomales .
1342: V. ASSIGNEMENT DE LA FONCTION D' ENCAPSULATION
1343: Un autre point intéressant était de savoir si Wolbachia inhibait les fonctions des hémocytes , notamment leur capacité à adhérer , à encapsuler , mais également leur capacité à produire des protéines conduisant à la mélanisation .
1344: Une première expérience d' encapsulation a été réalisée .
1345: Un bâtonnet de résine polymérisé a été introduit dans la cavité générale d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia .
1346: Les animaux ont été disséqués 8 et 16 jours après implantation et les capsules ( bâtonnets enrobés par les hémocytes ) ont été fixées pour des observations en microscopie électronique à transmission et à balayage .
1347: Quels que soient les animaux considérés , les capsules présentent le même état général .
1348: Les hémocytes ont adhéré à la résine , se sont allongés et ont créé une gangue constituée d' un empilement de plusieurs couches ( Figure 14 ) .
1349: Les premières couches de cellules déposées sont très aplaties , les organites et les noyaux ne sont plus visibles .
1350: Après 8 et 16 jours , les capsules sont bien formées et de nouveaux hémocytes sont toujours recrutés à la périphérie .
1351: Les cellules nouvellement arrivées adhèrent à la capsule mais ne sont pas encore étirées .
1352: Chez les deux types d' animaux , les cellules semi- granulaires semblent les plus impliquées dans ce phénomène d' encapsulation , ce qui est en accord avec la description de capsules obtenues chez Porcellio dilatatus ( Coutant , 1977 ) .
1353: Des phénomènes de mélanisation sont observables , témoignant de la libération locale des protéines contenues dans les granules hémocytaires ( système prophénoloxydase ) .
1354: Ces phénomènes de mélanisation sont détectés après plusieurs jours au niveau de l' empilement des hémocytes .
1355: Certaines cellules présentent les caractéristiques d' entrée en apoptose avec la formation de corps myéliniques et une dissociation particulière du noyau .
1356: Cette lyse cellulaire conduit ainsi à la libération du contenu des granules hémocytaires et notamment des enzymes de la cascade de mélanisation
1357: ( ProPO , ppA ... ) et des protéines d' agglutination ( Mitta et al. , 1999 ; Destoumieux et al. , 2000 ) .
1358: En microscopie à balayage , les capsules apparaissent entourées d' un réseau de lanières intriquées constituées par les hémocytes accolés et allongés ( Figure 15 p 84 ) .
1359: De nouvelles cellules continuent à venir adhérer sur la capsule au niveau de ces sangles adhésives .
1360: Chez Armadillidium vulgare , les hémocytes présentent de nombreuses villosités ( les cellules semblent hérissées ) contrairement aux hémocytes des animaux infectés par Wolbachia qui semblent rester beaucoup plus ronds et plus lisses .
1361: A . Hémocytes accolés et allongés ( X 6 000 ) Mélanisation Corps myélinique
1362: B . Hémocytes accolés et allongés ( X 8 000 )
1363: C . Hémocytes étirés Hémocytes semi- granulaires ( X 6 000 ) nouvellement fixés , pas encore étirés
1364: Figure 14 :
1365: Encapsulement d' un bâtonnet de résine , après 8 jours d' incubation dans la cavité générale , par les hémocytes d' Armadillidium vulgare infecté
1366: ( C. ) ou non ( A. et B. ) par Wolbachia .
1367: S' il ne semble donc pas y avoir de différences notables entre les animaux infectés ou non par Wolbachia quant à l' adhésion des cellules hémocytaires , la capacité des cellules à s' étirer et à produire des digitations semble amoindrie chez les animaux infectés par Wolbachia .
1368: Cette observation renforce l' hypothèse d' une déstabilisation du cytosquelette .
1369: Cette étude préliminaire nécessitera d' être confirmée et approfondie , d' une part pour observer si les hémocytes des animaux infectés par Wolbachia présentent toujours moins de digitations et , d' autre part , corréler cette perte de fonction à un éventuel retard dans la formation des capsules .
1370: Pour ce faire , le prélèvement des capsules devra être effectué à des temps plus courts , permettant d' observer la cinétique de l' évolution de la capsule dans les premiers jours .
1371: Capsule hémocytaire de 16 jours [ A.vulgare ( X 260 ) ] .
1372: Capsule hémocytaire de 16 jours .
1373: De nouvelles cellules ( présence de cellules hérissées ) adhèrent à la surface de la capsule [ A.vulgare ( X 780 ) ] .
1374: Capsule hémocytaire de 16 jours .
1375: De nouvelles cellules adhèrent ( les hémocytes sont moins nettement hérissés ) [ A.vulgare infecté par Wolbachia ( X 660 ) ] .
1376: Figure 15 :
1377: Encapsulement d' un bâtonnet de résine , après 16 jours d' incubation dans la cavité générale , par les hémocytes d' Armadillidium vulgare infecté ou non par Wolbachia .
1378: VI . OBSERVATION DES ORGANES HÉMATOPOÏETIQUES
1379: Les hémocytes des crustacés , comme ceux des autres invertébrés , sont produits dans des tissus spécialisés :
1380: les organes hématopoïétiques .
1381: La localisation et la structure de ces organes sont très variables même au sein de groupes taxonomiques proches .
1382: Chez les homards , les crabes ou les écrevisses , le tissu hématopoïétique se présente sous la forme d' une grappe de lobules , couvrant l' estomac broyeur ou le coeur .
1383: Les hémocytes sont maturés à l' intérieur des lobules qui présentent des tailles différentes ( Ghiretti-Magaldi et al. , 1977 ; Johnson , 1980 ) .
1384: Les cellules souches sont situées sur la bordure apicale de chaque lobule et les hémocytes matures migrent vers la région lacunaire puis sont libérés dans la circulation générale .
1385: Chez la crevette Sicyonia ingentis , les nodules hématopoïétiques apparaissent comme deux masses logées sur la face dorso-latérale de l' estomac .
1386: Chaque nodule comporte des vaisseaux reliés à l' artère hématopoïétique qui se branche à l' artère ophtalmique antérieurement au coeur .
1387: Les cellules souches et les hémocytes en voie de maturation sont logés dans la paroi épaisse des vaisseaux au sein d' une matrice de collagène extracellulaire .
1388: La libération des hémocytes dans la circulation ne peut avoir lieu qu' après dégradation de la matrice extracellulaire , ce qui exclut une libération directe et continue ( Martin et al. , 1987 ) .
1389: Chez les isopodes oniscoïdes , les organes hématopoïétiques sont au nombre de trois paires localisées dans le sixième et le septième segment du péréion et dans le premier segment du pléon ( Coutant , 1977 ) .
1390: Leur aspect a été décrit chez Porcellio dilatatus par l' auteur précité ( Figure 16 ) .
1391: Chez Armadillidium vulgare ( porteurs ou non de Wolbachia ) , les organes hématopoïétiques apparaissent sous forme de petits amas qui se présentent comme des aggrégats cellulaires de forme irrégulière , mesurant 50 à 60 & 206;& 144;m d' épaisseur , 150 & 206;& 144;m de long et 150 & 206;& 144;m de large et sont accolés à la face externe du septum péricardique .
1392: Chaque organe est constitué de cellules hémocytaires à différents stades de maturation qui semblent empaquetées et entourées par une couche de tissu connectif .
1393: Ce tissu semble limité par une membrane basale fibrillaire du côté du septum périphérique .
1394: Les cellules les moins matures sont présentes au milieu des amas , dans une zone qui a été décrite par
1395: Coutant ( 1977 ) comme la région centrale .
1396: Les cellules sont isolées et semblent baigner dans un conjonctif .
1397: Les cellules présentent un noyau de petite taille , pourvu de chromatine en mottes
1398: ( Figure 17 ) .
1399: Le cortex qui entoure la région centrale présente une forte densité cellulaire .
1400: Les cellules sont plus grosses et leur migration vers la lame basale semble s' accompagner d' une maturation et d' une différenciation .
1401: Le cortex peut être séparé en trois parties :
1402: le cortex interne , le cortex central et le cortex lacunaire ( Figure 18 , p 88 ) .
1403: Dans la partie interne du cortex , les cellules adhèrent les unes aux autres et s' organisent en travées .
1404: Les cellules sont peu différenciées et vont être maturées au cours de leur avancée vers le cortex central puis le cortex lacunaire .
1405: A partir du cortex central , deux grands types de cellules sont déjà identifiables dans un même amas , d' une part des cellules dépourvues de granules , probablement précurseurs des cellules hyalines et , d' autre part , des cellules possédant des granules qui seront à l' origine des deux types d' hémocytes granulaires et semi-granulaires .
1406: Quelque soit le type cellulaire , la structure des cellules est proche :
1407: le noyau est de taille importante , de nombreuses mitochondries sont présentes et le réticulum endoplasmique est bien développé au sein d' un cytoplasme relativement réduit .
1408: Figure 16 :
1409: Organe hématopoïétique de Porcellio dilatatus :
1410: un nodule observé en microscopie photonique ( Coutant , 1977 ) .
1411: Le nodule est placé sous le septum périphérique ( SP ) .
1412: Il est constitué d' une région centrale ( RC ) qui contient des cellules « souches » dans une matrice , d' un cortex ( Cor ) présentant plusieurs couches de cellules hémocytaires à des stades de maturation différents , d' une région lacunaire ( RL ) représentée par des cellules matures baignant dans une matrice lâche .
1413: Matrice de la région centrale
1414: Hémocyte immature , présentant des digitations
1415: Région du cortex
1416: A . Cortex interne ( X 3 000 ) :
1417: Les cellules commencent à se joindre les unes aux autres .
1418: Elles ne semblent pas dans le même état physiologique ( aspects clairs et sombres ) .
1419: B . Cortex central ( X 5 000 ) :
1420: Les cellules adhèrent les unes aux autres et débutent leur maturation .
1421: De petits granules plus ou moins sphériques sont en formation .
1422: C . Cortex latéral ( X 5 000 ) :
1423: Les cellules sont matures , les cellules granulaires sont bien identifiables par la présence de leurs nombreux granules polymorphes très denses .
1424: Figure 18 :
1425: Les trois régions du cortex des organes hématopoïétiques
1426: ( Armadillidium vulgare ) .
1427: A .
1428: Cortex interne .
1429: B . Cortex central .
1430: C .
1431: Cortex latéral .
1432: A . 500 nm
1433: B . Division cellulaire dans la région centrale de l' organe hématopoïétique .
1434: Les figures A. et B. montrent respectivement une cellule en métaphase ( X 5 000 ) et une cellule en anaphase ( X 8 000 ) .
1435: Ces cellules présentent très peu de granules .
1436: C . Apoptose d' une cellule hémocytaire ( X 5 000 ) peu différenciée dans le cortex interne de l' organe hématopoïétique .
1437: Figure 19 :
1438: Division ( A. et B. ) et apoptose ( C. ) des cellules hémocytaires dans l' organe hématopoïétique d' Armadillidium vulgare .
1439: Dans le cortex latéral , les cellules présentant des granules denses aux électrons sont beaucoup plus nombreuses que les cellules n' en présentant pas , cette proportion est par ailleurs conservée dans l' hémolymphe ou les hémocytes semi-granulaires et granulaires représentent la majorité des hémocytes circulants .
1440: De telles observations ont également été rapportées chez le homard Homarus americanus ( Martin et al. , 1993 ) chez lequel les cellules granulaires représentent plus de 90 % des cellules présentes dans les organes hématopoïétiques .
1441: Les deux types d' hémocytes granulaires ne sont pas toujours différenciables dans le cortex , principalement à cause des différents stades de maturation des hémocytes .
1442: Le cortex est lui aussi entouré d' une région dite lacunaire qui se prolonge par des ramifications de formes assez irrégulières étalées sur le septum péricardique ;
1443: cette dernière zone , à faible densité cellulaire , évoque un sinus périphérique .
1444: Comme nous l' avons vu , les organes hématopoïétiques sont les lieux de production des hémocytes , et de nombreuses cellules du cortex interne apparaissent en phase de division ( Figure 19 ) .
1445: Chez l' écrevisse , il existe une régulation de cette production d' hémocytes dans les organes hématopoïétiques , par des phénomènes d' apoptose ( 5 à 7 % ) ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
1446: Lorsque le taux d' hémocytes circulants subit une importante chute , lors de la mue , de blessures ou d' infections par exemple , les hémocytes matures sont libérés dans l' hémolymphe , comblant ainsi la perte des cellules impliquées dans les phénomènes de coagulation , de cicatrisation , d' encapsulement ...
1447: Les nouvelles cellules alors libérées dans l' hémolymphe vont pouvoir agir pour compléter la réponse immunitaire ou pour remplacer les hémocytes matures dans leur fonction préventive .
1448: Il a été récemment montré que lors d' une infection , le taux d' apoptose des hémocytes en formation dans les organes hématopoïétiques diminuait ( moins de 1 % ) , permettant ainsi une libération plus importante d' hémocytes et un renouvellement plus rapide ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
1449: Toutes nos observations relatives à la cytologie fine ont été effectuées sur des animaux infectés ou non par Wolbachia .
1450: Précisons que lors de la fixation des organes
1451: Figure 20 :
1452: Cellules hémocytaires ( Armadillidium vulgare ) en voie de maturation dans les organes hématopoïétiques infectés par Wolbachia .
1453: Des bactéries sont présentes dans le cytoplasme des cellules .
1454: hématopoïétiques des animaux infectés par Wolbachia , nous avons constaté la difficulté d' obtenir des tissus bien préservés .
1455: En effet , il semble que ces organes soient beaucoup plus fragiles que ceux des animaux non infectés .
1456: Cette remarque est en accord avec celle faite lors de la fixation des hémocytes infectés par Wolbachia .
1457: Ces bactéries endocellulaires ont été décrites dans tous les tissus étudiés jusqu'à maintenant chez Armadillidium vulgare , cependant nous montrons pour la première fois leur présence dans les organes hématopoïétiques .
1458: Cette fragilité cellulaire liée à la présence bactérienne conforte l' hypothèse suspectant une influence sur la structure du cytosquelette des cellules infectées ( Figure 20 ) .
1459: Cette étude préliminaire sur les tissus hématopoïétiques devra être poursuivie afin de déterminer leur fonctionnement , que ce soit au niveau de la prolifération ou de l' apoptose des cellules .
1460: Une étude du lignage cellulaire pourrait permettre de comprendre la différenciation des trois populations d' hémocytes ainsi que leur relargage dans l' hémolymphe .
1461: En effet , chez les crustacés , le lignage des cellules hémocytaires n' a pas été déterminé et actuellement deux hypothèses ont été proposées :
1462: - Chez l' écrevisse , il existerait deux lignées cellulaires , l' une conduisant aux hémocytes semi-granulaires et l' autre conduisant aux hémocytes granulaires .
1463: - Chez le homard et les crevettes , deux lignées cellulaires ont également été décrites , une évoluant en hémocytes hyalins et une autre évoluant en hémocytes granulaires ( Martin et al. , 1993 ; Gargioni et Barracco , 1998 ) .
1464: Une approche moléculaire pourra également être envisagée , afin de déterminer l' expression de différentes protéines , respectivement dans les organes hématopoïétiques et dans les hémocytes circulants .
1465: Récemment , chez l' écrevisse P. leniusculus , une étude de la transcription de certains gènes codant des protéines du système immunitaire a été réalisée sur les organes hématopoïétiques en comparaison avec les hémocytes circulants .
1466: Il a été montré que le gène codant la ProPO n' est pas transcrit dans ces organes mais le devient lorsque les hémocytes sont libérés dans l' hémolymphe .
1467: Par contre , d' autres protéines comme les péroxinectines , protéines d' adhésion cellulaire , sont produites par 80 à 90 % des cellules ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
1468: La présence de cette protéine expliquerait la structuration du cortex et les liaisons étroites des cellules hémocytaires dans cette région de l' organe hématopoïétique chez Armadillidium vulgare .
1469: Nous savons que le taux d' hémocytes circulants diminue fortement au moment de la mue , lors d' une blessure ou d' une infection par des pathogènes , puis retrouve un taux normal par libération de nouveaux hémocytes à partir des organes hématopoïétiques .
1470: Des analyses biochimiques des organes hématopoïétiques ou des expériences de fractionnement par tri cellulaire , suite à une blessure ou à une infection microbienne , permettrait de mieux comprendre les mécanismes de prolifération / apoptose , mais aussi les phénomènes de maturation des hémocytes au sein de ces tissus .
1471: En effet , la transcription des gènes homologues de Runt , qui codent pour des facteurs de différenciation chez la drosophile et les mammifères , a été mise en évidence dans les organes hématopoïétiques de Pacifastacus leniusculus ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
1472: L' injection de LPS ou de laminarine , mimant une infection bactérienne , conduit à l' augmentation de la transcription de ces gènes Runt , ce qui permet une différenciation des cellules hémocytaires afin de produire de nouvelles cellules qui seront libérées dans l' hémolymphe .
1473: Chez l' écrevisse , deux protéines Runt ont été mises en évidence ;
1474: il semble , par ailleurs , que chacune soit spécifique d' un type cellulaire ( une des cellules granulaires , l' autre des cellules semi-granulaires ) .
1475: Ces gènes constitueraient donc de bons marqueurs des différentes populations de cellules ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
1476: L' identification de telles protéines chez Armadillidium vulgare pourrait s' avérer très utile dans la détermination du lignage et de la maturation de ses différentes populations d' hémocytes .
1477: VII . EVOLUTION DU TAUX D' HEMOCYTES CIRCULANTS APRES INDUCTION DU SYSTEME
1478: IMMUNITAIRE
1479: Dans cette étude préliminaire , nous avons voulu essayer de déterminer l' évolution de la population hémocytaire au cours d' une infestation bactérienne expérimentale .
1480: Cette induction a été réalisée par des deux types d' infections ( 1 ) injections de bactéries pathogènes en phase de croissance ( Bacillus megaterium , Escherichia coli ; chauffés ou non à 100 °C ) chez des animaux sains et des animaux hébergeant Wolbachia .
1481: Le chauffage des bactéries permet de conserver les déterminants antigéniques tout en supprimant la virulence de la bactérie ( 2 ) injections de Wolbachia ( contenues dans des extraits tissulaires ) chez des animaux sains uniquement .
1482: Des lots de 4 animaux ont reçu une injection soit de B.megaterium chauffés ou non à 100 °C , soit d' Escherichia coli chauffés ou non à 100 °C , soit de Wolbachia ou soit d' une solution de Ringer ( témoin de l' expérience ) .
1483: Les hémocytes , prélevés après différents temps , ont été colorés au bleu Trypan pour une numération à l' aide d' une cellule de Mallassez .
1484: Le nombre d' individus testés n' étant pas suffisamment important , nous n' avons pas pu effectuer de tests statistiques , aussi il conviendra de compléter ces comptages sur une plus grande échelle pour obtenir une étude significative au niveau statistique .
1485: Toutefois , les premiers résultats obtenus au cours de nos expériences préliminaires se sont avérés reproductibles et nous ont fournis un certain nombre d' informations sur l' évolution de la population hémocytaire suite à une infection bactérienne provoquée .
1486: Ainsi , les cinétiques obtenues pour les animaux infectés par B. megaterium ( chauffés ou non ) et pour E. coli ( chauffés ) sont similaires ( Figure 21 , A / B / C ) .
1487: Les résultats obtenus après injections de Ringer ou après injections d' extraits tissulaires contenant Wolbachia semblent identiques ( Figure 21 , D / E ) .
1488: Seule l' injection d' E. coli non chauffés semble induire une réponse hémocytaire différente ( Figure 21 , F ) .
1489: Le graphe obtenu pour la réponse de nos témoins montre qu' une heure après l' injection de Ringer , une chute des hémocytes est observée , puis le taux hémocytaire remonte pour atteindre son niveau basal ( 20 000 cellules / & 206;& 144;l ) 6h après l' injection .
1490: Cette chute du taux hémocytaire est imputable en partie aux pertes liquidiennes provoquées lors du percement du trou nécessaire à l' injection .
1491: De plus , les hémocytes sont mobilisés sur le site de la blessure pour la colmater et assurer la cicatrisation .
1492: Cette chute des hémocytes devrait se retrouver dans tous les types d' infection par inoculation .
1493: Le taux d' hémocytes remonte progressivement
1494: 3h après l' injection , ce qui peut être corrélé à une libération , par les organes hématopoïétiques , de nouveaux hémocytes circulants .
1495: En ce qui concerne les animaux infectés par B. megaterium ( chauffés ou non ) et par E. coli ( chauffés ) , une chute rapide des hémocytes est observée dans la première heure suivant l' infection .
1496: Puis le nombre d' hémocytes augmente lentement entre la 3 éme et la 6 éme heure post-injection , pour atteindre un niveau plus faible que celui observé dans les témoins avant de diminuer une seconde fois entre la 6 éme et la 9 éme heure .
1497: Enfin , après 9h d' infection , le taux d' hémocytes augmente alors rapidement dans l' hémolymphe pour retrouver son taux basal entre 18 à 24 heures après l' inoculation .
1498: Comme pour les témoins « Ringer » , la première chute du nombre d' hémocytes suivie d' une lente remontée sont attribuables à la rupture du tégument .
1499: La deuxième diminution du taux hémocytaire , 6h après l' injection , pourrait correspondre à une lyse des hémocytes ayant participé activement , depuis l' infection , aux différents aspects de la réponse immunitaire ( dégranulation , phagocytose ... ) .
1500: L' infestation bactérienne étant d' emblée massive , la disparition des hémocytes ne serait plus comblée par les organes hématopoïétiques .
1501: Enfin , une seconde libération d' hémocytes par les organes hématopoïétiques aurait lieu environ
1502: 9h après l' injection et se poursuivrait jusqu'au rétablissement du taux basal .
1503: La quantité d' hémocytes circulant est probablement régulée par un contrôle de leur libération ;
1504: en cas de traumatismes importants , la forte diminution des hémocytes circulants ne peut être instantanément compensée .
1505: De nos observations , il semble ressortir que la première priorité est de rétablir l' intégrité et l' étanchéité du tégument , à partir de ce moment , la jugulation de l' infection concomitante nécessitera plusieurs heures et la libération de nouveaux hémocytes .
1506: En ce qui concerne les infections par E. coli ( non chauffés ) , les résultats sont plus difficilement interprétables .
1507: En effet , l' injection de cette bactérie Gram ( - ) conduit , après 3h , à 80 % de mortalité chez les animaux infectés et ce , même si des quantités moins importantes de bactéries ( dilution de 10 à 50 fois ) sont inoculées .
1508: Le suivi du nombre d' hémocytes en fonction du temps d' incubation des E. coli a montré que suite à la première chute du nombre d' hémocytes consécutive à la blessure , il ne semble pas y avoir de restauration du nombre d' hémocytes dans l' hémolymphe .
1509: Les quelques animaux qui survivent 24h après l' injection présentent un taux hémocytaire très bas ( 5000 cellules / & 206;& 144;l ) par rapport au niveau basal .
1510: De tels résultats nous portent à penser que chez Armadillidium vulgare , les hémocytes sont particulièrement sensibles à la présence d' E.coli infectieux .
1511: L' injection d' E.coli tués par la chaleur n' est pas létale mais induit une diminution marquée des hémocytes sur plus de 24h. Il semble donc que des facteurs de virulence sont capables de détruire les hémocytes et probablement de bloquer le fonctionnement des organes hématopoïétiques .
1512: Une question se pose :
1513: nos animaux ont -ils acquis un système leur permettant de détecter les bactéries Gram ( - ) ?
1514: Il conviendra d' identifier ce système qui est en place chez les décapodes où des protéines sont capables de reconnaître la signature LPS
1515: ( Lee et al. , 2000 ) Enfin , l' injection d' une suspension de tissus broyés contenant des Wolbachia montre que l' animal ne réagit pas du tout et la réponse obtenue est similaire à celle du témoin Ringer .
1516: Cette expérience devra être reproduite en considérant des temps plus longs car les bactéries injectées sont incluses dans des débris cellulaires
1517: ( Wolbachia n' est pas cultivable ) qui pourraient leurrer les hémocytes jusqu'à la phase d' infestation active des cellules du nouvel hôte .
1518: Toutefois , le fait que cette bactérie ne soit pas reconnue par les hémocytes n' est pas à exclure du fait de son incapacité à synthétiser des LPS ( Wu et al. , 2004 ) .
1519: Cette étude préliminaire a été effectuée dans le but d' estimer le temps nécessaire à l' organisme pour monter une réponse immunitaire efficace ;
1520: ces données sont donc importantes pour la recherche de protéines du système immunitaire dans le plasma , mais également pour quantifier l' expression de ces protéines .
1521: Ces indications devraient nous permettre de définir le moment où nous devons effectuer les prélèvements d' hémolymphe , en vue d' études protéiques ou génomiques .
1522: Ces données nous apportent également des informations sur la libération des jeunes hémocytes par les organes hématopoïétiques suite à une blessure provoquée .
1523: Ces résultats nécessiteront cependant d' être confirmés et complétés par une étude des organes hématopoïétiques , afin de déterminer ( i ) la quantité de cellules que ce tissu peut libérer en conditions normales et chroniques ( ii ) les taux de prolifération et d' apoptose .
1524: Il serait également intéressant de rechercher les mécanismes impliqués dans la communication cellulaire qui régulent la libération des jeunes hémocytes .
1525: Enfin , est -ce qu' il existe une reconnaissance des bactéries dans les organes hématopoïétiques ?
1526: Il a été montré chez la crevette Sicyonia ingentis que les organes hématopoïétiques intervenaient dans la « clearance » des bactéries d' une manière très efficace ( Martin et al. , 1996 ) .
1527: Cette étude a confirmé , par la même occasion , que les cellules granulaires contenues dans ces organes hématopoïétiques étaient maturées avant leur libération puisqu' elles étaient capables d' éliminer des bactéries dans l' organe qui les produit mais dont la structure est particulière .
1528: VIII . CONCLUSION-PERSPECTIVES
1529: Cette étude histologique ( organes hématopoïétiques ) et cytologique ( hémocytes ) , chez Armadillidium vulgare nous a permis de caractériser trois types d' hémocytes dans l' hémolymphe : ( i ) les hémocytes hyalins , dépourvus de granules ;
1530: ( ii ) les hémocytes semi-granulaires , pourvus de petits granules ;
1531: ( iii ) les hémocytes granulaires , pourvus de gros granules et présents en grand nombre .
1532: Ces trois populations d' hémocytes matures sont retrouvées dans le cortex lacunaire des organes hématopoïétiques .
1533: Il semblerait donc que les hémocytes soient déjà maturés lors de leur libération par les organes hématopoïétiques .
1534: En effet , lors de l' observation des organes hématopoïétiques , il semble que les hémocytes soient produits à partir de cellules souches situées dans la région centrale des organes et subissent leur maturation au cours de leur migration vers les régions lacunaires périphériques .
1535: A partir de ces observations , il n' est pas possible d' établir le lignage des cellules .
1536: Chez l' écrevisse signal , deux marqueurs spécifiques des hémocytes semigranulaires et des hémocytes granulaires ont été déterminés et devraient être utilisés pour une étude de lignage ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
1537: L' obtention de tels marqueurs nous permettrait de déterminer l' origine des différents types d' hémocytes circulants .
1538: Les expériences de phagocytose et d' encapsulation ont permis de mettre en évidence en partie la fonction des différents hémocytes .
1539: Ainsi , les cellules hyalines semblent impliquées dans la phagocytose , toutefois des expériences complémentaires pourront être réalisées notamment par une injection de bactéries marquées à la GFP pour une observation en microscopie confocale .
1540: Les cellules semi- granulaires semblent également intervenir dans ce processus mais avec une efficacité moindre .
1541: Les expériences d' encapsulement ont montré que les cellules granulaires et semi-granulaires possédaient la capacité à adhérer et à former des couches superposées afin d' emprisonner le corps étranger dans une capsule .
1542: La présence de mélanine dans les capsules suggèrent une libération des enzymes du système prophénoloxydase par les cellules granulaires .
1543: Nous avons également constaté que chez les animaux infectés , les cellules présentaient moins de digitations et par conséquent devenaient moins adhérantes .
1544: Toutefois , aux temps que nous avons choisis pour prélever les capsules , ces dernières étaient déjà complètement formées chez les deux types d' animaux .
1545: Cette expérience devra donc être renouvelée mais en choisissant des temps plus courts d' incubation des bâtonnets de résine , afin de déterminer si la formation des capsules chez les animaux infectés présente un décalage dans le temps .
1546: Les observations réalisées chez Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia montrent que les animaux présentent les mêmes types d' hémocytes , mais que certains ( principalement les hémocytes granulaires ) hébergent , dans leur cytoplasme , Wolbachia enfermées dans une vacuole .
1547: Toutefois la charge bactérienne semble relativement faible car tous les hémocytes ne présentent pas de bactéries et dans les hémocytes infectés , les bactéries sont souvent peu nombreuses .
1548: Chez ces animaux , une fragilité des hémocytes et des organes hématopoïétiques aux agents fixateurs ( modification des paramètres de fixation en microscopie électronique ) mais également un manque de plasticité membranaire des hémocytes ont été observés .
1549: Ainsi l' une des hypothèses plausibles est que Wolbachia interagirait avec le cytosquelette en le déstabilisant .
1550: Une observation en microscopie confocale des hémocytes d' Armadillidium vulgare porteurs et non porteurs de la bactérie , après marquage de l' actine et des microtubules nous permettrait de valider cette hypothèse , pour ensuite engager des études moléculaires .
1551: Nous avons également constaté , dans une étude préliminaire , que lors d' infections expérimentales par des bactéries exogènes , le nombre d' hémocytes variait au cours du temps et ceci d' une manière similaire , que les animaux soient sains ou porteurs de Wolbachia .
1552: Lors d' infection par des bactéries à Gram ( + ) , les différentes chutes observées du nombre d' hémocytes correspondraient à leur utilisation , dans un premier temps , pour cicatriser la blessure et dans un second temps pour lutter contre l' infection proprement dite .
1553: Les augmentations du nombre d' hémocytes correspondraient à la libération de nouveaux hémocytes par les organes hématopoïétiques .
1554: Toutefois lors d' infections par des bactéries Gram ( - ) , seule la première augmentation du nombre d' hémocytes est observable mais elle est très faible et bon nombre d' animaux meurent .
1555: Cette expérience préliminaire nécessite d' être confirmée sur des échantillons plus grands et avec des doses plus physiologiques , afin de faire une étude statistique .
1556: Enfin , il serait également intéressant d' observer le comportement des hémocytes au niveau du site de la blessure à la fois en MET et en MEB mais aussi en immunohistochimie , en utilisant un anticorps anti-armadillidine comme marqueur par exemple ( cf
1557: Chapitre II ) .
1558: Chapitre II
1559: Isolement et caractérisation de l' armadillidine , peptide antibactérien issu des hémocytes d' Armadillidium vulgare .
1560: Présence de ce peptide dans la famille des Armadillididae .
1561: Herbiniere J , Braquart-Varnier C , Greve P , Strub JM , Frere J , Van Dorsselaer A and Martin G .
1562: Armadillidin :
1563: a novel glycine - rich antibacterial peptide directed against gram - positive bacteria in the woodlouse Armadillidium vulgare ( Terrestrial Isopod , Crustacean ) .
1564: Dev Comp Immunol .
1565: 2005 ;
1566: 29 ( 6 ) :
1567: 489 - 99 . Epub 2004 Dec 21 .
1568: Tableau 5 :
1569: Activités antibactériennes détectées dans le plasma et dans les extraits des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia
1570: ( + / - Wolbachia )
1571: ISOLEMENT ET CARACTÉRISATION DE L' ARMADILLIDINE
1572: I. DETECTION D' UNE ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DANS L' HEMOLYMPHE d' Armadillidium vulgare
1573: Chez les crustacés , les peptides antibactériens sont synthétisés constitutivement dans les hémocytes et stockés dans les granules hémocytaires .
1574: Après une infection bactérienne , le contenu des granules est libéré dans l' hémolymphe , donc dans la circulation générale et souvent précisément au niveau du site d' infection / de blessure .
1575: Dans un premier temps , nous avons donc essayé de détecter une activité antibactérienne dans les composants de l' hémolymphe , c' est à dire le plasma et les hémocytes .
1576: Pour cela , les protéines plasmatiques ont été acidifiées au TFA afin d' éliminer en partie l' hémocyanine et de concentrer les protéines de plus faibles masses moléculaires .
1577: Les protéines hémocytaires ont ensuite été extraites par sonication dans de l' acide acétique 0 , 2 N , puis précipitées à l' acétone .
1578: Ces extraits protéiques ( plasmatiques et hémocytaires ) ont été testés sur la croissance de 6 souches de bactéries Gram ( + ) [ Bacillus megaterium , Enterococcus faecalis , Listeria ivanovii , Micrococcus luteus , Staphilococcus aureus , Vibrio alginplyticus ] et 8 souches de bactéries
1579: Gram ( - ) [ Acinetobacter baumanii baumanii , Citrobacter freundii , Enterobacter cloacae , Enterobacter aerogines , Escherichia coli , Escherichia coli ( souche pathogène ) , Pseudomonas aeruginosa , Salmonella thyphimurium ] ( Tableau 5 ) .
1580: Quels que soient les animaux , infectés ou non par Wolbachia , aucune activité antibactérienne n' a été trouvée dans le plasma .
1581: Par contre , la fraction hémocytaire extraite par de l' acide acétique 0 , 2 N présente une activité qui est dirigée contre 2 souches de bactéries Gram ( + ) ,
1582: B . megaterium et E. faecalis .
1583: Dans un second temps , nous avons donc entrepris la caractérisation de cette activité antibactérienne dans les hémocytes , notamment en recherchant la ou les molécules responsables de l' activité antibactérienne .
1584: Figure 22 :
1585: A :
1586: RP-HPLC des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare extraites en conditions acides .
1587: Les fractions fléchées 1 , 2 et 3 présentent une activité antibactérienne dirigée contre B. megaterium .
1588: B :
1589: Spectre MALDI-TOF de la fraction 2 , issue de la chromatographie ci-dessus .
1590: Ce spectre est caractérisé par un pic à 5259 Da en parfait accord avec la masse calculée du peptide .
1591: II . ISOLEMENT D' UN PEPTIDE ANTIBACTERIEN A PARTIR DES HEMOCYTES
1592: D' ARMADILLIDIUM VULGARE
1593: II.1 . Purification de l' armadillidine
1594: L' extrait acétique hémocytaire a été soumis à une partition en phase solide sur une cartouche Sep-Pak .
1595: La fraction , éluée par 40 % d' ACN / TFA 0 , 1 % a été séchée sous vide puis resolubilisée .
1596: Une fraction aliquot a ensuite été utilisée pour déterminer l' activité antibactérienne contre B. megaterium et E. faecalis .
1597: Pour cela , la fraction principale a été soumise à une purification par chromatographie RP-HPLC ( Figure 22 , A ) .
1598: Toutes les fractions , collectées manuellement , ont , après conditionnement pour éliminer l' ACN , été testées contre B. megaterium qui est la souche bactérienne la plus sensible à l' effet détecté .
1599: L' activité antibactérienne ainsi observée a pu être rapportée à 3 fractions issues d' un pic complexe éluant entre 31 % et 33 % d' ACN .
1600: Toutefois , l' activité antibactérienne était plus importante dans la fraction 2 ( médiane ) que dans les deux autres fractions ( latérales ) .
1601: II.2 . Détermination de la structure primaire de l' armadillidine
1602: Ces 3 fractions chromatographiées et actives ( Figure 22 , A ) ont ensuite été analysées en spectrométrie de masse de type MALDI-TOF pour une mesure de masse et pour une détermination de la pureté des fractions .
1603: Les 3 spectres obtenus ont montré que :
1604: - La fraction correspondant au pic 2 est homogène et contient un seul peptide d' une masse moléculaire de 5259 , 7 Da MH + ( Figure 22 , B ) .
1605: Ce peptide est donc responsable de l' activité antibactérienne observée .
1606: - Les fractions correspondant aux pics 1 et 3 sont hétérogènes et contiennent différents peptides .
1607: Pour ces deux fractions , une masse de 5259 Da a été retrouvée parmi les masses obtenues , révélant la présence du même peptide que dans la fraction 2 .
1608: La présence de ce peptide dans les fractions 1 et 3 explique donc l' activité antibactérienne observée .
1609: Le peptide actif issu du pic 2 étant suffisamment pur , il a été séquencé par dégradation d' EDMAN automatisée .
1610: La séquence obtenue est composée de 53 acides aminés et est présentée dans la Figure 23 ci-dessous .
1611: Figure 23 :
1612: Séquence complète , obtenue par dégradation d' Edman , du peptide antibactérien purifié par RP-HPLC .
1613: La masse calculée à partir de cette séquence est de 5259 , 65 Da , elle est donc en accord avec la masse moléculaire déterminée par MALDI-TOF-MS ( 5259 , 7 Da ) .
1614: Cette masse moléculaire a été confirmée par une analyse en Nanoelectrospray donnant une masse de 5258 , 7 Da , soit une masse avec un Dalton de différence .
1615: Cette différence pouvait correspondre à une amidation du peptide à son extrémité C-terminale , seule modification post-traductionnelle observée .
1616: Les interrogations de banques de données ( NCBI / EMBL / SWISSPROT ) n' ont pas permis d' établir d' homologies avec des peptides antibactériens connus , ce nouveau peptide a donc été nommé armadillidine , à partir du nom de genre d' Armadillidium vulgare .
1617: Dans le but de connaître la structure de la molécule peptidique obtenue , nous avons interrogé le site www.expasy.org le Network Protein Sequence analysis ( Biopôle de Lyon ) .
1618: Quelle que soit la méthode de calcul utilisée , basée sur les propriétés physico-chimiques des acides aminés constituant l' armadillidine , la structure de ce peptide apparaît aléatoire sans formation secondaire particulière , et ne comporterait ni hélice & 206;& 133; , ni feuillets & 206;& 134;.
1619: L' armadillidine est un peptide linéaire cationique avec une composition en acides aminés particulière car il n' est composé que de 10 acides aminés différents :
1620: Tableau 6 .
1621: Comparaison de la composition en acides aminés et de l' activité de l' armadillidine avec des peptides antimicrobiens riches en résidus glycine , issus :
1622: d' araignées :
1623: acanthoscurrines 1 et 2 ( Lorenzini et al. , 2003 ) ;
1624: d' insectes :
1625: AFP ( Iijima et al. , 1993 ) , holotricine 3 ( Lee et al. , 1995 ) et tenecine 3 ( Jung et al. , 1996 ) , ( Lee . et al. , 1999 ) et de plantes :
1626: shepherines 1 et 2 ( Park et al. , 2000 ) .
1627: Ce peptide , particulièrement riche en résidus glycine ( 47 % mol / mol ) , présente 5 motifs répétés GGGFH ( R / S ) et ne contient pas de résidu cystéine .
1628: Mis à part la présence d' un fort taux de résidus glycine , l' armadillidine montre un certain nombre de différences avec les autres peptides antimicrobiens riches en glycine caractérisés chez d' autres animaux ou chez des plantes .
1629: La comparaison de l' armadillidine avec certains de ces peptides est présentée dans le Tableau 6 .
1630: La première grande différence réside dans l' activité antibactérienne de ce peptide .
1631: En effet , l' armadillidine présente une activité antibactérienne atypique dirigée contre les bactéries Gram ( + ) et principalement contre B. megaterium ( MIC 0 , 5 -
1632: 1 , 25 & 206;& 144;M ) alors que jusqu'à présent la majorité des peptides antimicrobiens riches en glycine connus possèdent une activité antimicrobienne dirigée contre des bactéries Gram ( - ) et/ou contre des champignons ( Tableau 6 ) .
1633: Un seul autre peptide antibactérien riche en glycine ( 11 , 1 % ) , isolé chez la larve de l' insecte Oryctes rhinoceros , offre une activité antibactérienne dirigée principalement contre des bactéries Gram ( + ) ( Yang et al. , 1998 ) .
1634: Cependant , le taux de glycine est beaucoup plus faible que chez les autres peptides antimicrobiens riches en glycine .
1635: De plus , il est également riche en proline et ne présente pas de motifs répétés .
1636: La deuxième différence se trouve au niveau de sa composition :
1637: - Présence de 12 acides aminés basiques ( 6 arginines et 6 histidines ) .
1638: - Absence de résidus chargés négativement , ce qui confère à l' armadillidine une charge nette de + 6 et une valeur de point isoélectrique ( pI ) de 12 , 2 , c& 200;& 135;est-à-dire le pI le plus élevé par rapport aux autres molécules répertoriées .
1639: - Pourcentage de résidus hydrophobes dans la séquence de l' armadillidine significativement plus élevé que dans celle des autres peptides .
1640: & 239;& 130;& 149;& 239;& 128;& 160;Un autre point remarquable de l' armadillidine est la quintuple répétition du motif
1641: GGGFH ( R / S ) .
1642: Ces motifs répétés sont couramment retrouvés dans les peptides antimicrobiens riches en glycine .
1643: De telles séquences ont été décrites chez Sarcophaga peregrina ( Iijima et al. , 1993 ) , Holotrichia diomphalia ( Lee et al. , 1995 ) , Tenebrio molitor ( Jung et al. , 1996 ) , Acanthoscurria gomesiana gomesiana ( Lorenzini et al. , 2003 ) ou encore Bursa pastoris ( Park et al. , 2000 ) .
1644: Chezla plante Bursa pastoris , deux peptides antimicrobiens riches en glycine , de la même famille ( la famille des shepherines ) , ont été isolés ( Park et al. , 2000 ) .
1645: Ces peptides présentent une séquence comportant soit 6 , soit 7 répétitions du motif GGH et , il a été montré que la répétition de ce motif était responsable de l' activité antibactérienne .
1646: En effet , un peptide de synthèse formé uniquement de 6 répétitions du motif GGH a été produit et son activité testée .
1647: Ce peptide de synthèse est responsable d' une activité antibactérienne équivalente à celle obtenue par le peptide natif .
1648: Ainsi , la répétition de la séquence GGH a indubitablement une influence majeure sur la structure secondaire de ces peptides et sur leur mode d' action ( Park et al. , 2000 ) .
1649: En se basant sur les résultats de Park et al. ( 2000 ) , il est probable que la répétition du motif GGGFH ( R / S ) présent dans l' armadillidine joue un rôle dans l' activité de ce peptide .
1650: La réalisation de peptides de synthèse comportant un nombre croissant de motifs ( 2 à 5 ) devrait nous permettre de tester l' importance du nombre de répétitions dans l' activité antibactérienne de l' armadillidine .
1651: De même , nous pourrons tester l' importance du résidu phénylalanine dans ces motifs répétés .
1652: En effet , nous avons retenu une hypothèse , basée sur les propriétés des acides aminés impliqués dans le motif GGGFH ( R / S ) , qui pourrait expliquer le mode d' action de l' armadillidine ( qui ne semble pas posséder de structure secondaire , comme tous les peptides antimicrobiens riches en glycine ) .
1653: Cette hypothèse est renforcée notamment par le fait que la phénylalanine est un composé aromatique très hydrophobe , qui présente une structure encombrante dans la structure secondaire des protéines .
1654: Ainsi , les groupements aromatiques des phénylalanines , séparés par 3 glycines , pourraient se situer sur un côté de la molécule pour former une zone fortement hydrophobe .
1655: De même , les acides aminés arginine et histidine , chargés positivement se regrouperaient pour former une partie plus hydrophile , à l' opposé des groupements aromatiques .
1656: De plus , en conditions physiologiques , le peptide est fortement chargé positivement .
1657: Ces propriétés structurales permettraient de le rapprocher des peptides antibactériens présentant une hélice & 206;& 133; , sans qu' il n' y ait de torsion de la molécule .
1658: La partie de ce peptide chargée positivement pourrait alors se lier à la membrane des bactéries chargée négativement , puis le peptide s' inclurait dans le bicouche membranaire à l' aide notamment de sa partie hydrophobe .
1659: L' association de plusieurs molécules de peptide antibactérien permettrait alors la déstabilisation des membranes selon les deux modèles proposés par ( Shai , 1999 ) et ( Bulet et al. , 2002 ) ( Figure 24 ) :
1660: Figure 24 :
1661: Schéma des mécanismes de type « carpet » et de type « barrel-stave » suggérés lors de la perméabilisation membranaire des bactéries par des peptides antibactériens présentant une hélice & 206;& 133; ( Shai , 1999 ) .
1662: - Le mécanisme « carpet » , les peptides forment un tapis qui recouvre la membrane bactérienne
1663: - le mécanisme « barrel-stave » , les peptides s' intègrent dans la membrane bactérienne et se regroupent pour former un cylindre composite qui constitue alors un pore .
1664: Ces deux mécanismes conduisent à la lyse des cellules bactériennes , respectivement par fragmentation de la membrane ou par un efflux d' ions passant par les pores non sélectifs ainsi générés .
1665: Pour toutes les raisons évoquées précédemment , il apparaît donc important de déterminer la structure secondaire de l' armadillidine afin de lui attribuer un mode d' action , d' autant plus que la présence de résidus glycine en motifs répétés selon Lee et collaborateurs ( 1995 ) serait en faveur d' une activité antifongique .
1666: Des premiers essais pour mettre en évidence une activité antifongique ( champignons filamenteux et levures ) dans les extraits protéiques totaux d' hémocytes ( sains et infectés ) , se sont révélés positifs contre deux souches :
1667: Botrytis cinerea et Aspergillus niger ( Tableau 7 ) .
1668: Des tests utilisant de l' armadillidine purifiée ont montré que l' armadillidine pourrait avoir un effet sur la souche Aspergillus niger .
1669: Dans cette même série de tests , l' armadillidine purifiée n' a pas montré d' activité appréciable sur la croissance de Botrytis cinerea , aussi l' existence d' un autre peptide antifongique dans les hémocytes ne peut être formellement exclue .
1670: Pour confirmer , ou infirmer ces premiers résultats , ces tests doivent être poursuivis en utilisant des concentrations croissantes de peptide .
1671: Par la suite , ils pourront être étendus à d' autres souches de champignons .
1672: Toutefois , la disponibilité de quantités notables de peptides actifs demeure un préalable indispensable .
1673: Il apparaît donc nécessaire d' obtenir une quantité importante d' armadillidine , ce qui n' est pas aisément réalisable si l' on considère le faible volume d' hémolymphe prélevable par animal .
1674: malgré la collaboration des auteurs précités , nous ne sommes pas parvenus à produire ce peptide .
1675: Un nouvel essai de production est actuellement envisagé , en collaboration avec le Pr .
1676: T. Berges , dans le système d' expression « pMal& 226;& 132;& 162; Protein fusion » commercialisé par NEB .
1677: Tableau 7 :
1678: Activités antifongiques détectées dans les extraits des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia . ( + )
1679: II.3 . Clonage de l' ADNc de l' armadillidine
1680: A partir de la séquence peptidique , 2 oligonucléotides dégénérés ont été déterminés ( ArmF et ArmR , Figure 25 ) et utilisés en RT-PCR sur les ARNs hémocytaires d' Armadillidium vulgare , infectés ou non par Wolbachia .
1681: Un fragment d' une taille attendue de 154 pb a été obtenu , cloné et séquencé .
1682: La séquence déduite en acides aminés confirme la séquence peptidique obtenue précédemment par dégradation d' Edman .
1683: En utilisant la technologie SMART , l' ADNc pleine taille de l' armadillidine a été cloné dans le vecteur pGEM-T-easy .
1684: Au moins 3 clones positifs contenant un insert de 656 pb ont été séquencés dans les 2 directions .
1685: L' ADNc pleine taille est composé d' une région non transcrite en 5 ' de 79 pb suivie par le cadre de lecture de 219 pb et d' une région non transcrite en 3 ' de 342 pb .
1686: Le cadre de lecture code une séquence de 73 acides aminés incluant un peptide signal ( 19 residus ) riche en acides aminés hydrophobes .
1687: Le site de clivage pour la peptidase est situé après le résidu alanine ( position 19 ) précédent le premier résidu glycine du peptide ( Figure 25 ) .
1688: La séquence peptidique codante , déduite de la séquence d' ADNc , montre que le peptide avant modification post-traductionnelle présente 54 acides aminés et une masse calculée de 5317 , 7 Da , contre une masse de 5259 , 7 Da mesurée par
1689: MALDI-TOF sur le peptide mature .
1690: Cette différence de masse de 58 Da confirme que l' armadillidine doit être amidée à son extrémité C-terminale ( Arg-NH2 ) par élimination du résidu glycine .
1691: Cette amidation constitue la seule modification post-traductionnelle .
1692: ( Miyata et al. , 1989 ) ou les cécropines d' insectes ( Lowenberger et al. , 1999 ) .
1693: Cette modification a également été décrite dans les peptides antibactériens de vertébrés , tels que les magainines ( Chen et al. , 1988 ) pour lesquels il a été montré que l' amidation était fonctionnellement importante .
1694: En effet , la comparaison d' activité antimicrobienne entre les mêmes peptides présentant soit un groupe carboxyl libre , soit un groupe carboxyl amidé , a montré que cette modification post-traductionnelle augmentait l' activité des peptides .
1695: La perte partielle de l' activité antimicrobienne des peptides non amidés est probablement due
1696: Figure 25 .
1697: Séquence de l' ADNc de l' armadillidine et séquence en acides aminés déduite ( numéro d' accession AY644458 ) .
1698: Le peptide mature est indiqué en caractères gras .
1699: L' acide aminé en italique correspond au résidu glycine impliqué dans l' amidation du résidu arginine C-terminal et l' astérisque indique le codon stop .
1700: Le signal de polyadénylation est surligné deux fois .
1701: La double flèche verticale montre le site de clivage du peptide signal par une peptidase .
1702: Les flèches indiquent la position des amorces utilisées dans les réactions de RT-PCR .
1703: à la perte d' une charge positive à leur extrémité C-terminale entraînant des interactions plus faibles entre ces peptides et la membrane des bactéries .
1704: La présence d' un peptide signal suggère que l' armadillidine , une fois traduite dans les hémocytes , est transportée vers les granules hémocytaires dans lesquels elle serait stockée .
1705: Le stockage des peptides antibactériens dans les granules des hémocytes est un processus largement décrit chez les invertébrés étudiés tels que les moules ( Mitta et al. , 1999 ) , les limules ( Iwanaga et al. , 1998 ) , les araignées ( Lorenzini et al. , 2003 ) et les crustacés ( Silva et al. , 2000 ) .
1706: Ce phénomène a également été décrit chez les vertébrés , dans les phagocytes et les neutrophiles de mammifères ( Ganz et Lehrer , 1997 ; Yount et al. , 1999 ) mais aussi dans les cellules intestinales de Paneth ( Ouellette et Selsted , 1996 ) .
1707: La localisation de l' armadillidine dans les granules des hémocytes pourra être validée par immunomarquage , soit par hybridation avec un anticorps couplé à un fluorochrome pour une analyse en microscopie confocale , soit par une hybridation avec un anticorps primaire couplé à un deuxième anticorps lié à des particules d' or , pour une observation en microscopie électronique .
1708: 1 - Hémocytes ( - Wolbachia ) 2 - Hémocytes ( + Wolbachia ) 3 - Coeur 4 - Cerveau 5 -
1709: Chaîne nerveuse 6 - Ovaire 7 - Tissu adipeux 8 - Tube digestif
1710: Figure 26 :
1711: Analyse de l' expression de l' armadillidine par northern blot :
1712: Hybridation sur différents tissus d' Armadillidium vulgare des sondes ( A ) armadillidine et ( B ) actine .
1713: II. 4 . Spécificité de l' expression de l' armadillidine
1714: 4.1 . Spécificité tissulaire de l' armadillidine
1715: L' expression des ARNm de l' armadillidine dans différents tissus d& 200;& 135;Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia a été déterminée par northern blot , ce qui a permis de révéler un transcript d' environs 0 , 65 kb présent spécifiquement dans les hémocytes des deux types d' animaux ( Figure 26 ) .
1716: Chez
1717: Armadillidium vulgare , l' armadillidine n' est présente que sous une seule forme puisque nous ne détectons qu' un seul transcript .
1718: La très faible expression observée dans les ovaires ( Figure 26 ) peut être mise en relation avec la présence d' hémocytes infiltrant les tissus comme cela a été montré chez les moules ( Mitta et al. , 2000a , b ) , les crevettes ( Destoumieux et al. , 1999 ) et les araignées ( Lorenzini et al. , 2003 ) .
1719: En effet , les isopodes terrestres comme les décapodes possèdent un appareil circulatoire non clos et les hémocytes peuvent s' insinuer dans tous les tissus , ce qui explique cette contamination .
1720: Le même type de contamination a également été observé , pour tous les tissus testés , au cours de l' étude de l' expression de l' armadillidine effectuée par RT-PCR ( résultats non présentés ) .
1721: Des tests d' expression de l' armadillidine par RT- PCR ont également été réalisés sur les ARNs des organes hématopoïétiques .
1722: Un amplifiat de taille attendue est obtenu dans ce tissu producteur des cellules de l' hémolymphe , il n' est pas improbable que les hémocytes en cours de maturation et/ou les hémocytes matures avant leur libération expriment ce peptide antibactérien .
1723: Afin de valider ce dernier résultat relatif à l' expression précoce de l' armadillidine au sein des organes hématopoïétiques , deux types d' expériences complémentaires devront être mises en oeuvre :
1724: - l' analyse des ARNs par northern blot ( expression ) - l' immunomarquage par un anticorps polyclonal dirigé contre l' armadillidine ( synthèse et stockage ) .
1725: 4.2 . Spécificité du zoologique de l' armadillidine
1726: Depuis la caractérisation de trois membres d' une nouvelle famille de peptides antimicrobiens chez la crevette Peneaus vannamei ( Destoumieux et al. , 1997 ) , de nombreuses études ont été réalisées pour retrouver cette famille ( les pénaeidines ) chez d' autres crevettes d' intérêt économique .
1727: Ces peptides cationiques présentent une grande diversité au niveau de leur séquence primaire mais ils sont typiquement formés de deux domaines , l' un N-terminal riche en résidus proline et , l' autre côté C- terminal riche en résidus cystéine dont 6 sont engagés dans 3 ponts disulfures .
1728: Leur activité est dirigée contre les bactéries Gram ( + ) et les champignons .
1729: Actuellement , les pénaéidines ont été décrites chez 6 espèces de crevettes :
1730: Litopenaeus setiferus ( Gross et al. , 2001 ) , Penaeus japonicus ( Rojtinnakorn et al. , 2002 ) , Peneaus monodon ( Supungul et al. , 2002 ) , Litopenaeus stylirostris ( Munoz et al. , 2004 ) , Fenneropenaeus chinensis ( Kang et al. , 2004 ) et Litopenaeus setiferus
1731: ( Cuthbertson et al. , 2004 ) .
1732: Récemment l' isolement , chez Fenneropenaeus chinensis d' une 4ème isoforme de la classe 3 et d' une 4ème classe de pénaeidines chez Litopenaeus setiferus a ainsi confirmé la diversité de cette famille de peptides antimicrobiens spécifiques des crustacés décapodes du genre Penaeus .
1733: Les différentes classes sont distinguées par leurs régions variables , qui pour chaque classe présente des caractéristiques particulières .
1734: De plus , chacune de ces classes est composée de différentes isoformes , qui correspondent à des substitutions ponctuelles au niveau de la séquence peptidique .
1735: Le peptide de la classe 4 présente une très grande spécificité vis à vis de ses cibles , il n' est actif que sur des bactéries de même espèce .
1736: Les pénaeidines qui représentent un grand nombre de gènes exprimés au sein des hémocytes ne cibleraient pas ( suivant leur classe ) les mêmes espèces microbiennes ( Cuthbertson et al. , 2004 ) .
1737: A l' instar de ces travaux , nous avons voulu savoir si l' armadillidine était synthétisée chez tous les isopodes terrestres ou seulement au sein de la famille des
1738: Armadillididae ( Tableau 1 p 37 ) .
1739: L' expression de l' armadillidine a donc été recherchée chez des isopodes terrestres ( i ) de genres différents appartenant à des familles différentes ( ii ) d' espèces différentes appartenant au même genre ( famille des Armadillididae ) .
1740: Figure 27 :
1741: Analyse de l' expression de l' armadillidine chez différentes espèces
1742: d' isopodes terrestres ( 1 ) Armadillidium vulgare ( A.v. ) non infecté par
1743: Wolbachia , ( 2 ) Armadillidium vulgare infecté par Wolbachia , ( 3 ) Armadillo officinalis
1744: ( A.o . ) , ( 4 ) Oniscus asellus ( O.a . ) , ( 5 ) Porcellionides pruinosus pruinosus ( P.p. ) . ( A ) RT-PCR sur les ARNs des hémocytes de différents genres d' Isopodes terrestres en utilisant les amorces spécifiques armadillidine ( Arm 5 / Arm 6 ) .
1745: ( B ) .
1746: Hybridation de la sonde armadillidine sur les ARNs des hémocytes de différentes espèces d' Armadillididae . ( i ) Les ARNs hémocytaires d' isopodes terrestres , n' appartenant pas à la famille des
1747: Armadillididae ( Oniscus asellus , Porcellionides pruinosus pruinosus et Armadillo officinalis ) ont été prélevés et l' expression de l' armadillidine a été testée par RT-PCR , en utilisant les deux amorces spécifiques de l' armadillidine ( Arm 5 / Arm 6 ) .
1748: Ces analyses en RT-PCR se sont révélées négatives pour l' armadillidine tandis que les RT-PCR sur les mêmes matrices en utilisant des amorces spécifiques de l' actine sont positives ( Figure 27 , A. ) .
1749: Même en utilisant des conditions de PCR moins stringentes ( températures d' hybridation de 45 °C à 55 °C ) aucune amplification n' a été obtenue à l' exception du témoin positif ( ARNs d' Armadillidium vulgare ) , suggérant une expression spécifique de l' armadillidine restreinte au genre .
1750: Cette spécificité zoologique a été confirmée par des analyses en Northern blot ou seule une hybridation de la sonde sur les hémocytes d' Armadillidium vulgare est observée ( Figure 27 , B. ) .
1751: Figure 28 :
1752: Analyse de l' expression de l' armadillidine par RT-PCR
1753: ( Arm 5 / Arm 6 ) dans les hémocytes de différentes espèces d' Armadillididae .
1754: 1 -
1755: Armadillidium assimile ( A.a . ) ,
1756: 2 -
1757: Armadillidium depressum ( A.d . ) ,
1758: 3 -
1759: Armadillidium maculatum ( A.m . ) ,
1760: 4 -
1761: Armadillidium nasatum ( A.n . ) ,
1762: 5 -
1763: Armadillidium vulgare ( A.v. ) ,
1764: 6 -
1765: Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia
1766: [ A.v. ( + W ) ] .
1767: Figure 29 :
1768: Alignement multiple ( CLUSTAL W ) des séquences partielles de l' armadillidine obtenues , après RT-PCR ( Arm 3 / Arm 6 ) chez différentes espèces d' Armadillididae :
1769: Armadillidium vulgare ( A.v .
1770: ) Armadillidium assimile ( A.a . ) , Armadillidium depressum ( A.d . ) , Armadillidium maculatum ( A.m . ) , Armadillidium nasatum ( A.n . ) .
1771: ( ii ) Les ARNs hémocytaires d' isopodes terrestres appartenant à la famille des
1772: Armadillididae ainsi qu' au genre Armadillidium ( Armadillidium assimile , Armadillidium depressum , Armadillidium maculatum , Armadillidium nasatum ) , ont été prélevés et l' expression de l' armadillidine a été testée par RT-PCR comme précédemment .
1773: Les résultats obtenus présentés Figure 28 montrent qu' un fragment de taille attendue ( 210 pb en utilisant les amorces Arm 3 / Arm 6 ) est présent chez toutes les espèces testées .
1774: Ces produits de PCR ont ensuite été purifiés et séquencés .
1775: L' analyse des séquences en acides aminés déduites ( Figure
1776: 29 ) confirme qu' elles correspondent toutes à l' armadillidine , ce qui suggère que ce peptide pourrait être présent chez toutes les espèces d' Armadillididae .
1777: Les séquences sont très proches , puisque les 11 premiers acides aminés et la répétition du motif spécifique de l' armadillidine sont entièrement conservés .
1778: La composition de ce motif peut toutefois présenter une variation supplémentaire , elle devient alors :
1779: GGGF ( H / N ) ( R / S ) .
1780: La comparaison des séquences protéiques , en prenant celle d' Armadillidium vulgare comme référence , montre que la séquence obtenue pour Armadillidium assimile est totalement identique .
1781: Les trois autres espèces présentent quelques variations , notamment Armadillidium depressum qui présente un motif
1782: GGGFNR supplémentaire , un résidu glycine en moins en position 12 , et 6 changements de résidus ( positions : 26 , 27 , 33 , 38 , 50 , 57 ) .
1783: La séquence obtenue chez Armadillidium nasatum montre le remplacement de deux motifs FNR par les motifs IYG et FRT .
1784: La séquence identifiée chez Armadillidium maculatum est très proche ( une substitution en position 48 ) de celle d' Armadillidium depressum si on excepte le motif répété supplémentaire par rapport à Armadillidium vulgare .
1785: Ce peptide semble donc bien conservé au sein de la famille des
1786: Armadillididae et notamment en C-terminal ou le résidu glycine est présent chez toutes les espèces ( chez Armadillidium vulgare , ce résidu sert lors de l' amidation du peptide ) .
1787: Si une seule forme du peptide semble présente pour chaque espèce , il n' est cependant pas exclus qu' il existe d' autres isoformes au sein d' une même espèce .
1788: En effet si le transcrit isolé est le plus représenté , il peut masquer d' autres transcrits .
1789: La présence d' un transcrit majoritaire a déjà été montré pour la classe
1790: 3 des pénaeidines qui représente 90 % des transcrits de ce peptide antimicrobien
1791: ( Cuthbertson et al. , 2002 ) .
1792: Ces résultats obtenus pour les différentes espèces d' Armadillididae pourront être confirmés avec l' obtention des ADNc complets de chaque isoforme isolée .
1793: De plus , l' isolement de ce peptide devra être réalisé chez ces trois nouvelles espèces afin de tester l' activité antibactérienne de ces trois isoformes , notamment pour déterminer si la présence d' un motif supplémentaire chez Armadillidium depressum et l' altération de deux motifs chez Armadillidium nasatum entrainent une modification de l' activité antibactérienne .
1794: Ces études ultérieures devraient nous permettre de classer ces isoformes de l' armadillidine au sein d' une même famille de peptides antibactériens riches en glycine et présentant des motifs répétés GGGF ( H / N ) ( R / S ) .
1795: II.5 Libération de l' armadillidine
1796: Des observations en MET réalisées sur les hémocytes granulaires montrent qu' après une infection des animaux par B.megaterium ( chauffés ou non ) , les organites de stockage des composants du système immunitaire subissent une modification bien marquée .
1797: Dès la première heure suivant l' infestation , la plupart des grands granules des hémocytes granulaires prennent un aspect particulier et il est manifeste que la densité électronique d' une partie du granule est affectée ( Figure 30 , A ) .
1798: De plus , nous observons la formation de nombreuses digitations à la surface cellulaire de ces hémocytes .
1799: Ces deux modifications de l' aspect cytologique des cellules perdurent pendant plusieurs heures après l' infestation ( Figure 30 , B ) .
1800: La diminution de la densité électronique de la matrice granulaire évoque une libération d' un ou plusieurs produits .
1801: Il n' a pas été possible de déterminer le mécanisme de libération au travers de la membrane granulaire .
1802: Si la diffusion au sein du cytoplasme n' est pas exclue , reste à comprendre le transfert à la membrane plasmique .
1803: Selon certains auteurs ( Mitta et al. , 2000 ) , une libération intracellulaire du contenu granulaire semble possible :
1804: chez la moule , les granules hémocytaires contenant les peptides antibactériens peuvent fusionner avec les lysosomes , suggérant une coopération dans la destruction des bactéries phagocytées .
1805: Un phénomène analogue a également été observé au sein des neutrophiles humains ( Ganz et Lehrer , 1997 ) .
1806: Lors d' une infection bactérienne consécutive à une blessure , l' armadillidine est -elle libérée seulement sur le site de contamination et/ou dans la circulation générale ?
1807: Après injection de B.megaterium dans la cavité générale de nos animaux et récupération du plasma d' un seul individu sur une échelle de temps allant de 1h à 24h , nous avons , par une analyse en MALDI-TOF , recherché la présence d' un signal à 5259 Da correspondant à la masse de l' armadillidine ( Figure 31 ) .
1808: Notre analyse démontre clairement que suite à l' infection bactérienne , l' armadillidine est bien détectable dans le plasma .
1809: Il est vraisemblable que le taux de l' armadillidine circulante présente une évolution dans le temps qui pourrait être corrélée au nombre d' hémocytes circulants ( Chapitre I , § VII , p 95 ) .
1810: L' observation du témoin
1811: Ringer dont l' hémolymphe a été prélevée très rapidement après l' injection montre la présence d' un signal faible mais cependant détectable ;
1812: soit l' armadillidine est présente en permanence dans le plasma à un niveau très faible , soit suite à un traumatisme , elle est libérée immédiatement dans la circulation générale mais de façon graduée .
1813: Nos observations en
1814: MET sur la cytologie des granules ainsi que l' identification de l' armadillidine dans le plasma par la technique MALDI-TOF , apportent des indices sur le lieu de stockage , le mode et la cinétique de libération de ce peptide .
1815: Les variations de la charge en armadillidine présente dans le plasma suite à une infection microbienne ou une blessure devront être complétées par un dosage de l' armadilline ( test ELISA avec un anticorps anti-armadillidine ) .
1816: Figure 31 :
1817: Spectres MALDI-TOF ( réalisés sur des protéines plasmatiques totales d' un seul animal ) après différents temps d' infection ( 0h , 3h , 6h , 9h , 12h , 24h ) par
1818: B . megaterium
1819: :
1820: suivi de la présence de l' armadillidine ( 5259 Da ) .
1821: III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES
1822: Nous avons isolé chez Armadillidium vulgare , que les animaux soient infectés ou non par Wolbachia , un peptide antibactérien nommé armadillidine .
1823: Ce peptide ( 5259 Da ) , synthétisé constitutivement dans les hémocytes , est riche en glycine et offre une activité contre les bactéries Gram ( + ) .
1824: Ce peptide est spécifique du genre Armadillidium et ne présente pas d' homologie avec les peptides antibactériens décrits dans la littérature .
1825: Pour une caractérisation plus complète de ce peptide plusieurs études restent à réaliser .
1826: La possibilité d' obtenir un peptide recombinant , constituerait un atout pour les études structure-fonction en dichroïsme circulaire , mais aussi pour tester son activité antimicrobienne de façon plus exhaustive , notamment contre un plus grand nombre de souches de champignons .
1827: La détermination de sa structure secondaire nous permettra de suspecter son mode d' action vis-à-vis des bactéries .
1828: Une étude par immunomarquage apparaît nécessaire pour déterminer la répartition de l' armadillidine dans les granules de différents types hémocytaires .
1829: Ce même type d' approche pourra être utilisée pour essayer de répondre à plusieurs questions qui pourraient être ( i ) comment se fait la libération de l' armadillidine ?
1830: est -ce une libération extracellulaire et/ou intracellulaire ? ( ii ) est -ce que les granules sont tous identiques en terme de stockage ou existe t -il une ségrégation granulaire ? ( iii ) lors d' une infection , est -ce qu' il y a exocytose de quelques espèces moléculaires déterminées ou est -ce une diffusion non spécifique ?
1831: Chapitre III
1832: Libération d' un peptide antifongique par clivage de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare .
1833: LIBÉRATION D' UN PEPTIDE ANTIFONGIQUE PAR CLIVAGE DE L' HÉMOCYANINE
1834: L' hémocyanine , qui est la protéine majoritaire ( 95 % ) dans le plasma ( Sellos et al. 1997 ) , a pour fonction de transporter l' oxygène par fixation des molécules d' oxygène au niveau d' hèmes constitués de cuivre .
1835: L' hémocyanine possède deux sites de liaison au cuivre au niveau de deux régions comportant trois histidines chacune .
1836: Cependant , cette fixation de l' oxygène n' est pas l' unique propriété de cette molécule multifonctionnelle .
1837: Chez les arthropodes , l' hémocyanine peut également posséder des pouvoirs d' osmolytes ou tampon ( Paul et Pirow 1998 ) , servir de transporteur pour la 20- hydroxyecdysone ou l' ecdysone ( Jaenicke et al. 1999 ) ou encore être un constituant de la cuticule ( Paul et al. 1994 ) .
1838: Chez certaines espèces , il a récemment été montré que l' hémocyanine pouvait avoir des propriétés analogues à la phénoloxydase ( Nagai et Kawabata
1839: 2000 ;
1840: Nagai et al.
1841: 2001 ;
1842: Lee et al.
1843: 2004 ) .
1844: Un rôle encore plus inattendu vient d' être mis en évidence chez deux espèces de crustacés , la participation de l' hémocyanine à la libération de peptides antimicrobiens .
1845: En effet , suite à une induction par du LPS ou par acidification du plasma , cette molécule subit un clivage de son extrémité C-terminale et génère un ou plusieurs peptides antimicrobiens ( Destoumieux-Garzon et al. 2001 ; Lee et al. 2003 ) .
1846: Chez les crevettes pénaeides , les peptides libérés ( PvHCt , PsHCt ) par clivage de l' extrémité C-terminale de l' hémocyanine sont antifongiques ( Destoumieux-Garzon et al. 2001 ) tandis que celui libéré ( astacidine ) chez l' écrevisse Pacifastacus leniusculus est dirigé contre les bactéries Gram ( - ) et les bactéries Gram ( + ) ( Lee et al. 2003 ) .
1847: Il nous est donc apparu logique de vérifier si un tel processus engendrant des peptides actifs existait chez Armadillidium vulgare .
1848: Etant donné que les séquences protéiques et nucléotidiques n' étaient pas connues chez les isopodes terrestres , il nous a fallu isoler l' ADNc de l' hémocyanine , ce qui nous a ensuite permis de déduire sa séquence protéique .
1849: En parallèle , nous avons réalisé l' induction du clivage de l' hémocyanine par acidification du plasma ainsi que la caractérisation des peptides présents dans les fractions plasmatiques acidifiées .
1850: Tableau 8 :
1851: Séquences des amorces utilisées pour isoler l' ADNc partiel de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare .
1852: I. CLONAGE DE L' ADNC DE L' HÉMOCYANINE
1853: Chez les crustacés , l' hémocyanine est une protéine , de masse moléculaire comprise entre 70 et 90 kDa , qui est synthétisée dans l' hépatopancréas .
1854: Chez l' animal , on rencontre différentes sous-unités de l' hémocyanine , de séquences variables , qui vont s' associer dans le plasma pour former des structures quaternaires , principalement sous forme d' hexamères .
1855: Les séquences protéiques de 5 hémocyanines de crustacés décapodes , Pacifastacus leniusculus ( écrevisse ) , Penaeus vannamei ( crevette ) , Pontastacus leptodactylus ( écrevisse ) , Panulirus interruptus ( crabe de Californie ) , Penaeus monodon ( crevette ) ont été alignées et comparées .
1856: Des amorces dégénérées ( Hem 1 et Hem 2 ) ont ainsi été déterminées dans les régions conservées de ces 5 espèces .
1857: Le positionnement de ces amorces est présenté dans la Figure 32 et leur séquence respective est donnée dans le Tableau
1858: 8 . Les amorces Hem 1 / Hem 2 ont permis d' amplifier un fragment de 324 pb qui a été cloné et séquencé .
1859: La séquence nucléotidique obtenue présente une taille attendue et sa séquence protéique déduite est homologue aux autres hémocyanines de crustacés .
1860: Le clonage et le séquençage des régions 3 ' et 5 ' de l' ADNc de l' hémocyanine a été réalisé par RACE-PCR selon la technologie SMART en utilisant de nouvelles amorces spécifiques ( Hem 3 et Hem 4 , Tableau 8 ) déterminées à partir de la séquence nucléotidique préalablement obtenue .
1861: Le séquençage des différents clones obtenus , réalisé grâce à l' utilisation d' amorces plus internes ( Figure 33 p 130 - 131 ) , nous a permis d' obtenir la séquence complète de l' ADNc de cette hémocyanine et de déduire sa séquence protéique complète .
1862: L' ADNc pleine taille ( 2147 pb ) est constitué d' une région codante de 2064 pb flanquée d' une région 5 ' UTR de 36 pb et d' une région 3 ' UTR de 47 pb .
1863: Le cadre de lecture ouvert code pour une protéine de 684 acides aminés qui présente une masse calculée de 78 062 Da si on considère les acides aminés constituant la proprotéine .
1864: Figure 33 . :
1865: Séquence nucléotidique de l' ADNc de l' hémocyanine .
1866: La séquence protéique déduite est indiquée sous la séquence nucléique .
1867: Le codon stop est écrit en italique et souligné .
1868: Le site de polyadénylation est doublement souligné .
1869: Sont indiqués en rouge et soulignés , les résidus histidine supposés être impliqués dans la liaison au cuivre .
1870: Le site potentiel de clivage du peptide signal est signalé par une double flèche verticale .
1871: Les amorces utilisées pour le séquençage de l' hémocyanine sont indiquées , sous la séquence protéique , par des flèches oranges .
1872: Cette masse calculée est en accord avec celle des autres hémocyanines , comme par exemple , 75
1873: 320 Da pour Pacifastacus leniusculus ( Lee et al.
1874: 2003 ) ou 74 980 Da pour Peneaus vannamei ( Sellos et al. 1997 ) .
1875: La séquence protéique de l' hémocyanine a été analysée par le logiciel PSORT
1876: II ( http ) , ce qui nous a permis de mettre en évidence la présence d' un peptide signal dont le site de clivage serait localisé entre les résidus 16 ( alanine ) et 17 ( tryptophane ) pour libérer la molécule fonctionnelle ( 76 437 Da ) .
1877: Les interrogations des banques de données ( NCBI / EMBL / SWISSPROT ) ont montré que cette protéine appartenait bien à la famille des hémocyanines .
1878: Comme les autres hémocyanines séquencées , elle présente deux sites de liaison au cuivre qui impliquent des résidus histidines ( soulignées et notées en rouge dans la Figure 33 , p 130 - 131 ) .
1879: Cette liaison à deux atomes de cuivre lui permet de jouer son rôle premier de transporteur de l' oxygène .
1880: Conformément aux hémocyanines connues , elle possède également un domaine potentiel phénoloxidase conservé dans la partie N- terminale tandis que sa partie C-terminale est variable .
1881: Ce travail préalable nous a permis de rechercher la présence du ou des peptides antimicrobiens potentiellement libérés par un ou plusieurs clivages de l' extrémité C-terminale de cette molécule multipotente .
1882: II . CLIVAGE DE L' EXTRÉMITÉ C-TERMINALE
1883: Deux études antérieures , chez Penaeusvannamei ( Destoumieux-Garzonetal . 2001 ) d' une part et , chez Pacifastacusleniusculus ( Leeetal . 2003 ) d' autre part ont rapporté l' isolement de peptides antibactériens issus du clivage de l' hémocyanine .
1884: Les deux techniques utilisées sont très similaires , il s' agit d' une acidification du plasma , respectivement par HCl 0 , 1 M ou par du
1885: TFA 0 , 1 % .
1886: Cette acidification permet d' induire le clivage de l' hémocyanine mais aussi la précipitation des grosses molécules y compris celles oxyphoriques qui sont alors éliminées par centrifugation .
1887: II.1 . Acidification du plasma par du TFA 0 , 1 %
1888: Après acidification du plasma par du TFA ( 0 , 1 % final ) , nous avons réalisé une cinétique de clivage de l' hémocyanine en fonction du temps ( 0h à 24h ) ;
1889: en fin d' expérience , après centrifugation , les protéines solubles ont été analysées en gels d' électrophorèse .
1890: Deux types de gels ont été utilisés , les gels classiques ( 12 , 5 % et 15 % d' acrylamide ) pour vérifier l' élimination de l' hémocyanine et , des gels comportant de la tricine , plus résolutifs , permettant de visualiser les peptides et les protéines de faible masses moléculaires éventuellement libérés suite au traitement avec le TFA .
1891: Quel que soit le type de gel utilisé , il s' est avéré que l' élimination de l' hémocyanine n' était pas optimale , ce qui posait un problème pour l' analyse des résultats électrophorétiques et surtout compromettait gravement nos futures analyses en RP-HPLC .
1892: Nous avons donc introduit une étape supplémentaire dans la précipitation des protéines solubles plasmatiques .
1893: En fin de cinétique , les protéines ont été fractionnées sur cartouches Sep Pak C 18 et éluées par élutions successives d' ACN / 0 , 1 % TFA à
1894: 20 % , 50 % et 80 % .
1895: Après concentration sous vide , les différents éluats solubilisés dans du tampon échantillon ont été déposés uniquement sur un gel de tricine .
1896: Bien que plusieurs bandes de masses moléculaires estimées entre 5 et 2 kDa soient visibles dans le bas des gels , il n' a pas été possible d' établir une variation quantitative de l' intensité de ces bandes en fonction du temps de coupure .
1897: De plus , des traces en tête de gel suggéraient également que l' hémocyanine était encore notablement présente .
1898: Ces résultats préliminaires , nous ont conduit à opter pour la technique de précipitation de l' hémocyanine par HCl ( 0 , 1 M final ) proposée par Destoumieux- Garzon et collaborateurs
1899: ( 2001 ) .
1900: II.2 . Acidification du plasma par du HCl 0 , 1M
1901: Le plasma a été acidifié par HCl 0 , 1 M , pendant des temps variables ( 4 à 8h ) , sous agitation constante et à une température de 4 °C. Les protéines plasmatiques solubles ont été fractionnées sur cartouche Sep-Pak C18 .
1902: Comme dans les expériences précédentes , les différents éluats ont été analysés sur gels de tricine .
1903: Il est alors apparu que si l' intensité des bandes de faibles masses moléculaires étaient équivalentes ( pour des volumes initiaux de plasma identiques ) à celles observées lors de la précipitation par le TFA , par contre l' hémocyanine était réduite à l' état de traces .
1904: Ces résultats nous autorisaient à utiliser les éluats plasmatiques après Sep-Pak C18 pour effectuer des chromatographies du type RP-HPLC .
1905: Une analyse des plasmas d' animaux sains ( non infectés par Wolbachia ) et d' animaux infectés par Wolbachia a été conduite
1906: ( Figures 34 et 35 , p 136 - 137 ) .
1907: Le chromatogramme du plasma d' animaux sains comporte six pics majeurs ( Figure 34 ) dont les caractéristiques ( temps d' élution , pourcentage d' ACN , masses ) sont consignées dans le Tableau 9 .
1908: Le chromatogramme du plasma d' animaux infectés par Wolbachia comporte seulement 4 pics majeurs ( Figure 35 et Tableau 9 ) .
1909: Dans ces deux chromatogrammes deux pics offrent des masses respectives en MALDI-TOF de 1539
1910: Da et 2932 Da .
1911: Ces masses mesurées correspondent aux masses calculées de deux peptides composés respectivement des 12 et 24 derniers acides aminés de l' hémocyanine d' Armadilldium vulgare ( Figure 36 ci-dessous ) .
1912: Figure 36 :
1913: Séquence protéique de l' extrémité C-terminale de l' hémocyanine .
1914: Les doubles flèches indiquent les sites de clivage qui conduisent à la libération de 2 peptides d' une masse respective de 1539 et 2932 Da .
1915: Figure 34 :
1916: A . RP-HPLC des protéines plasmatiques d' Armadillidium vulgare extraites en conditions acides ( HCl 0 , 1 M ; 6 h ) .
1917: Les fractions numérotées de 1 à 6 ont été analysées en spectrométrie de masse
1918: MALDI-TOF .
1919: Les spectres MALDI-TOF obtenus pour les fraction 1 et 4 sont présentés en B. et C .
1920: Figure 35 :
1921: RP-HPLC des protéines plasmatiques d' Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia extraites en conditions acides ( HCl 0 , 1 M ; 6 h ) .
1922: Les fractions numérotées 1 , 4 , 5 et 6 ont été analysées en spectrométrie de masse
1923: MALDI-TOF .
1924: Figure 37 :
1925: Alignement des séquences obtenues par dégradation d' Edman des deux peptides C-terminaux ( contenus dans les pics 1 et 4 ) sur la séquence déduite de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare .
1926: Afin de confirmer nos données relatives à ces peptides , nous avons déterminé la séquence
1927: N-terminale de ces peptides par dégradation d' Edman .
1928: Les résultats obtenus ( Figure 37 ) ont confirmé notre attente .
1929: Le premier peptide composé de 12 acides aminés ( pic 1 ) présente 42 % de résidus histidine , 33 % d' acide aspartique et 8 , 3 % de phénylalanine et de valine .
1930: Ce peptide est chargé négativement ( - 5 ) à pH physiologique et présente un pI de 5 , 08 .
1931: Le second peptide composé de 24 acides aminés ( pic 4 ) présente 25 % de résidus histidine , 16 , 7 % d' acide aspartique , 12 , 5 % de valine , 8 , 3 % de d' acide glutamique , de lysine et de phénylalanine et 4 , 2 % d' asparagine , de proline , de sérine , d' isoleucine et de leucine .
1932: Ce peptide est aussi chargé négativement et présente un pI de 5 , 73 .
1933: Ces deux peptides ont donc des propriétés physico-chimiques assez proches .
1934: Après interrogation de la banque de données SwissProt , aucune homologie significative avec d' autres peptides n' a pu être obtenue .
1935: Chez la crevette
1936: Penaeus vannamei , le clivage de l' hémocyanine à son extrémité
1937: C-terminale conduit à la libération d' un peptide antifongique , qui ne présente aucune activité antibactérienne .
1938: Par contre , le peptide issu du clivage de l' hémocyanine chez l' écrevisse Pacifastacus leptodactylus présente une activité antibactérienne dirigée contre les 2 types de bactéries .
1939: Nous avons donc voulu savoir si les deux peptides de 12 et 24 acides aminés libérés après clivage de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare ont une activité antimicrobienne .
1940: La faible quantité de ces peptides obtenue après clivage de l' hémocyanine ne nous permettait pas de réaliser des tests d' activité antimicrobienne sur toutes les souches de champignons et de bactéries dont nous disposions .
1941: Nous avons donc , dans un premier temps , tester l' effet des protéines plasmatiques traitées par HCl sur 9 souches de champignons
1942: [ Aspergillus niger , Botrytis cinerea , Eutypa lata , Phaeomoniella chlamydospora , Saccharomyces cerevisiae ( FL100 , Erg 6
1943: & 204;& 135; , WT Euroscarf ) , Pichia pastoris , Candida glabrata ] , 2 souches de bactéries Gram ( - ) ( Escherichia coli et Enterobacter cloacae ) et 2 souches de bactéries Gram ( + ) ( Bacillus megaterium et Micrococcus luteus ) .
1944: Une activité antifongique , dirigée contre Botrytis cinerea a été observée , par contre aucune activité n' a été détectée contre les autres champignons , ni contre les bactéries Gram ( - ) ou Gram ( + ) testées .
1945: Afin de déterminer si cette activité antifongique était due à l' un des deux peptides purifiés de 12 et 24 acides aminés , nous les avons testés contre la souche de champignon sensible , Botrytis cinerea .
1946: Pour ces premiers essais , la quantité de peptide testée n' a pas pu être dosée par des méthodes classiques .
1947: Une quantification basée sur la surface des pics ( correspondant à chacun des peptides ) obtenus par RP-HPLC nous permet toutefois d' estimer que la même quantité de peptide a été utilisée .
1948: Les premiers résultats indiquent que le peptide issu du pic 4 est actif contre Botrytis cinerea , confirmant l' action observée des protéines plasmatiques solubles après acidification par HCl contre cette même souche .
1949: Par contre , le peptide issu du pic 1 ne montre pas d' activité .
1950: Il convient toutefois d' être prudent avec ce résultat négatif qui devra être confirmé en utilisant notamment des quantités déterminées du peptide de 12 acides aminés .
1951: De même , l' activité dirigée contre Botrytis cinerea imputable au peptide de 2932 Da devra être précisée notamment en déterminant la MIC .
1952: Les peptides isolés chez les crevettes P. vannamei et P. stylorostris ( PvHCt et PsHCt ) présentent une charge négative , un pI de 5 , 5 et offrent une activité antifongique .
1953: Aux vues des premiers résultats , il semblerait que le peptide de 2932 Da se rapprocherait par ces fonctions physico-chimiques et fonctionnelles des peptides isolés chez Penaeus vannamei .
1954: Par contre , il est très différent du peptide ( astacidine ) isolé chez l' écrevisse , qui lui présente des propriétés classiques de peptide antibactérien , puisqu' il est cationique et est dirigé contre les bactéries à Gram ( - ) et à Gram ( + ) .
1955: III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES
1956: Dans cette étude , nous avons cloné l' ADNc de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare , déterminé sa séquence nucléotidique et déduit la séquence protéique .
1957: Nous avons également montré que l' hémocyanine pouvait être clivée en conditions acides et libérer deux peptides chargés négativement , un premier composé de 12 acides aminés d' une masse moléculaire de 1539 Da et un second constitué de 24 acides aminés d' une masse moléculaire de 2932 Da , ce dernier présentant une activité antifongique dirigée contre Botrytis cinerea .
1958: Ces premiers résultats devront être confirmés et notamment , il conviendra de s' assurer que le peptide de 12 acides aminés ne présente réellement pas d' activité antimicrobienne .
1959: Pour cela , il faudrait disposer d' une grande quantité de peptide car , comme pour l' armadillidine , la quantité de produit purifié obtenue à partir des animaux est très faible .
1960: De plus , à la différence de l' armadillidine , ces peptides de 12 et 24 résidus sont trop petits pour être exprimés dans un système d' expression / production , il faudrait donc les faire synthétiser chimiquement pour tester leur activité .
1961: Le clivage de l' hémocyanine , libérant un peptide antifongique ou antibactérien , est un mécanisme décrit chez d' autres espèces de crustacés .
1962: Deux isoformes d' un peptide antifongique ont été décrites chez Penaeus stylirostris , alors qu' un seul peptide a été jusqu'à maintenant caractérisé chez Penaeus vannamei ( Destoumieux-Garzon et al. 2001 ) .
1963: Chez Pacifastacus leniusculus , un seul peptide antibactérien a pour l' instant été identifié ( Lee et al. 2003 ) .
1964: Dans les deux cas , des expériences de clivage de l' hémocyanine ont été réalisées par une stimulation microbienne .
1965: Chez les crevettes , les auteurs ont induit la réponse immunitaire par l' ajout d' un mélange de champignons , de bactéries Gram ( + ) et de bactéries Gram ( - ) préalablement tuées ( Destoumieux-Garzon et al. 2001 ) .
1966: Chez l' écrevisse , la réponse immunitaire a été induite par des injections de LPS ou de & 206;& 134; 1 , 3- glucan ( Lee et al. 2003 ) .
1967: Dans les deux cas , une augmentation des peptides antimicrobiens issus du clivage de l' hémocyanine a été observée .
1968: Lee et collaborateurs ( 2003 ) ont également montré que le clivage de l' hémocyanine est réalisé par une protéinase cystéine-like ou une aspartyl protéase , probablement issues des lysosomes .
1969: Le mécanisme de clivage de l' hémocyanine n' est pas connu avec certitude , mais il est suspecté que les enzymes responsables de ce clivage pourraient être induites , libérées et activées lors de la réponse immunitaire .
1970: Ces enzymes proviendraient des hémocytes , qui lors des infections libèreraient le contenu de leur granules par exocytose ( ou par lyse des hémocytes ) dans l' hémolymphe .
1971: Chez Armadillidium vulgare , le clivage de l' hémocyanine libère un peptide dont nous avons montré l' activité antifongique .
1972: L' analyse quantitative , par immunoprécipitation ou
1973: ELISA , de la libération de ce peptide de l' hémocyanine pourra également être développée après induction par des déterminants antigéniques ( LPS ou & 206;& 134; 1 , 3- glucanes ) déjà utilisés chez les décapodes .
1974: Le mécanisme de clivage de l' hémocyanine chez Armadillidiumvulgare pourrait , comme chez l' écrevisse , également faire intervenir une aspartyl protéase .
1975: En effet , à partir de protéines hémocytaires analysées en électrophorèse bidimensionnelle ( cf Chapitre IV ) , une cathepsine D-like lysosomale a été trouvée ;
1976: cette cathepsine est une aspartyl protéase et pourrait donc être une des enzymes potentiellement capables de cliver l' hémocyanine .
1977: L' action de la ou des enzymes qui clivent l' hémocyanine [ cystéine-like protéase , aspartyl protéases
1978: ( Lee et al. , 2003 ) ] serait facilitée par la position structurale de l' extrémité C-terminale au sein de l' hémocyanine .
1979: En effet , Decker et Jaenicke ( Decker et Jaenicke 2004 ) , proposent , par analogie , une analyse structurale de l' hémocyanine et de la position relative des peptides antibactériens potentiels situés à l' extrémité C-terminale de la molécule .
1980: Cette modélisation , présentée Figure 38 , a été réalisée à partir de la structure cristallographique de l' hémocyanine de Panulirus interruptus qui présente une forte homologie avec les sous-unités des hémocyanines dont sont issus les peptides antimicrobiens trouvés chez P. vannamei , P. stylirostris et P. leniusculus .
1981: Elle montre que tous les peptides sont localisés à la surface des sous-unités et sont très facilement accessibles aux pathogènes ( même dans les hexamères ) et semblent faire partie du domaine III qui présente une structure en feuillets & 206;& 134;. Après libération dans l' hémolymphe , la structure de ces peptides doit être modifiée , malheureusement l' étude structurale de PvHCt , PsHCt 1 et PsHCt 2 n' a pas été réalisée .
1982: Par contre , un spectre de dichroïsme circulaire a été obtenu pour l' astacidine , il suggère une structure en feuillets & 206;& 134; pour des valeurs de pH comprises entre 4 et 8 et à différentes températures .
1983: Une étude structurale du peptide , issu du clivage de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare , actif contre Botrytiscinerea pourra être réalisée afin de comprendre son mécanisme d' action .
1984: Cependant , il est probable que sa structure soit aléatoire , comme le prédit la modélisation virtuelle dans ExPasy ( Swissprot ) .
1985: Il est à noter que cette expérience du clivage de l' hémocyanine a été réalisée sur des animaux infectés ou non par Wolbachia , et il ne semble pas y avoir de différences qualitatives quant aux peptides générés .
1986: Il serait donc intéressant de voir ultérieurement , si
1987: Wolbachia peut affecter l' activité de l' enzyme qui clive l' hémocyanine ou si cette bactérie endocellulaire affecte la synthèse de l' hémocyanine au sein des cellules de l' hépatopancréas .
1988: Les nombreuse propriétés de l' hémocyanine déjà décrites chez différents arthropodes , n' interdisent pas d' envisager des approches complémentaires pour préciser les rôles de cette protéine chez Armadillidium vulgare .
1989: En effet , une étude sur l' activité phénoloxydase potentielle ainsi que son activité catécholoxydase suspectée seraient intéressantes à appréhender , notamment pour savoir si l' activité phénoloxydase de l' hémocyanine activée complète celle produite par le système ProPO ( spécifique de la réponse immunitaire des arthropodes sauf des chélicérates ) ou bien si cette activité est un vestige d' un système plus ancestral .
1990: En effet , chez les chélicérates , le système ProPO n' existe pas et l' hémocyanine assure l' activité phénoloxydasique .
1991: Le système ProPO est un système de reconnaissance du non-soi qui est constitué d' une série d' enzymes du type sérine protéase qui agissent en cascade .
1992: Lors de leur libération , par exocytose régulée ( Cerenius et Söderhäll
1993: 2004 ;
1994: pour revue ) , toutes ces enzymes contenues dans les granules des hémocytes sont activées .
1995: Le précurseur de la phénoloxydase ( ProPO ) est clivé par une sérine protéase ( ppA ) qui libère la forme active ( PO ) .
1996: La PO va alors oxyder les phénols en quinones , qui vont se polymériser par une réaction non-catalytique et produire la mélanine .
1997: Chez les arthropodes , la partie N-terminale de l' hémocyanine présente de fortes homologies avec la phénoloxydase mais également des ressemblances avec les tyrosinases d' autres phylums et des hémocyanines de mollusques .
1998: Toutefois , si les hémocyanines de mollusques et celles d' arthropodes ne présentent pas de réelles homologies de séquence , elles peuvent cependant être toutes activées et acquérir alors une activité phénoloxydase sur des substrats o-diphénoliques ( Cerenius et Söderhäll 2004 ; pour revue ) La comparaison de notre séquence de l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare avec d' autres hémocyanines et prophénoloxydases de crustacés montre que les domaines de liaison au cuivre entre les différentes hémocyanines et les différentes prophénoloxydases présentent de fortes homologies ( voir annexe III ) .
1999: Cependant , ces 2 types de protéines possèdent des propriétés physico-chimiques très différentes , telles que leur charge et leur hydrophobicité .
2000: Les hémocyanines sont fortement chargées négativement ( afin de minimiser les interactions avec les autres protéines de l' hémolymphe ou avec les tissus ) , alors que les phénoloxydases sont neutres ce qui diminue leur solubilité dans l' hémolymphe et favorise leur interaction avec la surface des tissus ( Jaenicke et Decker 2003 ) .
2001: Il serait donc intéressant d' étudier la capacité de l' hémocyanine à acquérir cette activité phénoloxydase chez Armadillidium vulgare et d' établir :
2002: - Si comme chez les autres crustacés étudiés , cette activité est induite par un clivage de l' hémocyanine et d' identifier ce site spécifique d' une sérine protéase qui est libérée par les hémocytes lorsqu' ils sont eux-mêmes stimulés par une infection microbienne .
2003: Ce clivage permet ainsi l' accessibilité du site catalytique phénoloxydase aux groupements phénol des molécules circulant dans l' hémolymphe ( Adachi et al. 2003 ; Lee et al. 2004 ) .
2004: - Ou , si comme chez les chélicérates , qui sont dépourvus de système prophénoloxydase , ce sont les peptides antibactériens , libérés par les hémocytes lors d' une infection bactérienne , qui en se liant à l' hémocyanine modifient sa conformation , permettant l' accessibilité au site catalytique phénoloxydase ( Nagai et Kawabata 2000 ; Nagai et al. 2001 ) .
2005: L' utilisation de molécules oxyphoriques ( hémoglobine , hémocyanine , hemerythrine ... ) comme matrice pour générer des peptides actifs dans différents registres est un phénomène qui existe chez les invertébrés comme chez les vertébrés .
2006: Ainsi , il a été montré que ces molécules peuvent engendrer des peptides présentant des activités antimicrobiennes ( Ivanov et al. , 1997
2007: ; Fogoca et al. , 1999 ;
2008: Destoumieux- Garzon et al. , 2001 ;
2009: Lee et al. , 2003 ;
2010: Vergote et al. , 2004 ) ou neuropeptidiques ( Salzet et al. , 1996 ; Salzet et Deloffre , 2000 ) .
2011: Récemment , le panel d' activités de l' hémocyanine vient d' être complété par l' attribution d' une activité nouvelle antivirale chez la crevette Peneaus monodon ( Zhang et al. 2004 ) , confirmant ainsi son rôle très important dans la réponse immunitaire innée .
2012: Chapitre IV
2013: Recherche d' effecteurs impliqués dans le système immunitaire :
2014: Approche protéomique
2015: RECHERCHE D' EFFECTEURS IMPLIQUÉS DANS LE SYSTÈME IMMUNITAIRE :
2016: APPROCHE PROTÉOMIQUE
2017: Comme nous l' avons vu précédemment , la majorité des effecteurs de l' immunité innée chez les crustacés est produite et stockée dans les hémocytes .
2018: Cependant , d' autres organes participent à l' édification de cette réponse immunitaire .
2019: C' est notamment le cas des organes hématopoïétiques qui sont à l' origine des hémocytes matures .
2020: Récemment , il a été montré que les pré-hémocytes encore contenus dans les organes hématopoïétiques synthétisent précocement certaines protéines du système immunitaire , comme les péroxynectines ou des peptides antimicrobiens ( Destoumieux et al. , 2000b ; Destoumieux-Garzon et al. , 2001 ; Lee . et al. , 2003 ; Somboonwiwat et al. , 2005 ) ;
2021: par contre , d' autres n' y sont pas encore exprimées comme par exemple la prophénoloxydase
2022: ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
2023: Les caecums digestifs contribuent également à la réponse immunitaire en produisant diverses protéines , dont l' hémocyanine ( cf Chapitre II ) , les & 206;& 134; 1 , 3- glucan binding protéines ( Lee et al. , 2000 ; Cheng et al. , 2005 ) ou les facteurs de coagulation ( Hall et al. , 1999 ) , qui sont ensuite sécrétées dans l' hémolymphe .
2024: Dans un système circulatoire ouvert , le plasma sert de transporteur et baigne tous les tissus .
2025: Wolbachia est présente dans tous les tissus des animaux infectés , toutefois les charges bactériennes sont très variables selon les tissus considérés et les ovaires sont le tissu de choix pour ces bactéries qui se transmettent verticalement .
2026: Les facteurs de virulence et les toxines libérées par la Wolbachia pourraient être transportés par le plasma et provoquer une dérégulation du fonctionnement des tissus participant à la réponse immunitaire .
2027: Aussi , l' analyse de l' hémolymphe ( hémocytes et plasma ) , des organes hématopoïètiques et des caecums digestifs a été effectuée chez des Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia .
2028: L' analyse protéomique des tissus constituant les trois principales sources de la réponse immune innée , relatée dans cette étude a un double but :
2029: - Identifier et caractériser les protéines du système immunitaire d' Armadillidium vulgare .
2030: - Comparer les profils d' expression protéique d' Armadillidium vulgare infecté ou non par Wolbachia , afin de déterminer si cette bactérie endocellulaire est capable de modifier l' expression de certaines protéines de son hôte ou de produire une ou des protéines qui interféreraient avec le système immunitaire et permettrait ainsi son maintien dans la cellule hôte .
2031: Pour ce faire , nous avons utilisé différentes approches .
2032: Afin d' observer des différences d' expression des protéines entre les différents animaux au niveau de l' hémolymphe ( hémocytes et plasma ) , des organes hématopoïétiques et des caecums digestifs , une analyse en électrophorèse 1- dimension a été réalisée en première approche .
2033: Ensuite , nous avons mis en place l' analyse des protéines par électrophorèse bidimensionnelle .
2034: C' est une méthode très utilisée parce qu' elle est résolutive , sensible , fiable et reproductible si l' on s' adresse à des protéines dont la masse moléculaire est & 199;& 131; à 10 kDa .
2035: Nous avons appliqué cette technique essentiellement à l' analyse des hémocytes et du plasma .
2036: Figure 39 :
2037: Protéines d' Armadillidium vulgare ( A.v. ) infectés ou non par
2038: Wolbachia ( + W ) . ( A ) Protéines plasmatiques . ( B ) Protéines totales de 8 caecums digestifs .
2039: ( C ) .
2040: Protéines totales de 120 organes hématopoïétiques . ( D ) Protéines hémocytaires .
2041: La flèche blanche indique la bande qui pourrait inclure l' armadillidine .
2042: La tête de flèche orange indique la zone de migration des sous-unités de l' hémocyanine ( masses apparentes
2043: 67 à 73 kDa ) .
2044: La tête de flèche jaune indique une bande différentielle de 32 kDa .
2045: I. ÉLECTROPHORÈSE 1-D
2046: I.1 . Hémocytes
2047: Les protéines issues des hémocytes d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia ont été extraites puis séparées sur gels d' acrylamide .
2048: L' observation des gels colorés nous a permis de comparer les profils des protéines de masses moléculaires comprises entre 6 kDa et 200 kDa ( Figure 39 , D. ) .
2049: Cette comparaison n' a pas mis en évidence de différences notables entre les profils protéiques qui présentent un grand nombre de protéines matérialisées par des bandes de tailles et d' intensités comparables .
2050: Dans le bas du gel , près du front de migration , une bande mieux résolue en gel tricine pourrait correspondre à l' emplacement de l' armadillidine ( Figure 39 , D. ) .
2051: I.2 . Plasma
2052: Le plasma est un milieu complexe qui véhicule les produits libérés par les hémocytes mais également ceux d' autres tissus tels que les caecums digestifs , le tissu adipeux et les organes endocrines .
2053: Hors épisode infectieux , les protéines du système immunitaire ne sont pas décelables dans le plasma sauf certaines protéines de reconnaissance telles que les
2054: De la même manière que pour les hémocytes , nous avons entrepris la mise en évidence et l' identification de quelques protéines plasmatiques .
2055: Avant d' être déposées sur gels d' acrylamide , les protéines plasmatiques ont été traitées à l' HCl ou au TFA pour éliminer le plus possible l' hémocyanine .
2056: La Figure 39 , A p 148 montre les profils obtenues après migration des protéines plasmatiques après précipitation par du TFA ( 0 , 1 % final ) .
2057: La précipitation de l' hémocyanine dans ces échantillons n' est que partielle , ce qui perturbe la migration et ne permet pas une bonne visualisation des protéines faiblement représentées ou de faibles masses moléculaires inférieures à 20 kDa .
2058: I.3 . Autres tissus :
2059: Organes hématopoïétiques et caecums digestifs
2060: Les hémocytes sont produits par les organes hématopoïétiques et il semble , d' après les analyses en microscopie électronique , que la maturation des hémocytes s' opère in situ et non dans la circulation générale après leur libération .
2061: La présence de granules denses aux électrons permet de reconnaître les deux types de cellules granulaires et laisse donc supposer que des protéines du système immunitaire sont déjà stockées et que leur synthèse précoce s' est opérée dans les organes hématopoïétiques .
2062: La synthèse précoce de certaines molécules de l' immunité innée a déjà été mis en évidence à la fois chez les crevettes par la recherche des pénaeidines ( peptides antimicrobiens )
2063: ( Destoumieux et al. , 2000 ) , mais également chez l' écrevisse par l' identification des péroxinectines ( Söderhäll et al. , 2003 ) .
2064: L' analyse électrophorétique comparative des protéines constitutives des organes hématopoïétiques et des hémocytes circulants pouvait nous montrer s' il existait des différences importantes entre ces deux échantillons .
2065: De plus , la présence de Wolbachia dans les organes hématopoïétiques pouvait -elle induire des variations marquées dans l' expression des protéines étudiées ?
2066: Les profils électrophorétiques obtenus à partir des organes hématopoïétiques sont pour le moins aussi complexes que ceux réalisés à partir des hémocytes .
2067: Cependant , dans la zone 14 , 4 - 20 , 1 kDa , un ensemble de deux bandes dont l' une est très intense paraît caractéristique des organes hématopoïétiques
2068: ( Figure 39C , p 148 ) .
2069: Dans le haut du gel ( zone 67 - 94 kDa ) , les protéines semblent moins intensément exprimées que dans les hémocytes circulants , de même pour les protéines de masses apparentes comprises entre 25 et 30 kDa .
2070: Notons aussi , qu' une bande visible au bas du gel pourrait correspondre à un ensemble de peptides mal résolus où pourrait figurer l' armadillidine .
2071: Aucune différence n' est appréciable entre les profils électrophorétiques d' organes hématopoïétiques d' animaux sains et d' animaux infectés .
2072: Chez l' écrevisse P .
2073: leniusculus ( Söderhäll et al. , 2003 ) , il a été montré que les protéines d' adhésion et de prolifération cellulaire s' expriment déjà dans les organes hématopoïétiques ;
2074: la prophénoloxydase ne serait synthétisée que plus tard dans les hémocytes circulants .
2075: Entre les patterns protéiques des organes hématopoïétiques et ceux des hémocytes circulants , il existe une certaine analogie cependant , les différences observées laissent penser que la maturation des hémocytes n' est peut-être pas complète au moment de leur libération dans la circulation générale .
2076: En l' absence d' anticorps , notre étude n' a pu caractériser une ou des protéines spécifiques des hémocytes in situ et circulants .
2077: Le caecums digestifs des crustacés peuvent être comparés , de par leurs fonctions , au foie des vertébrés et ils synthétisent une diversité de molécules dont certaines sont libérées dans l' hémolymphe :
2078: Sur nos gels , nous avons pu identifier deux bandes qui doivent correspondre à des sous- unités de l' hémocyanine présentant des masses apparentes entre 67 à 73 kDa ( Figure
2079: 39 ,
2080: B ) .
2081: La présence ou non de Wolbachia ne semble pas affecter qualitativement les profils électrophorétiques , cependant une bande additionnelle ( 32 kDa ) existe chez les animaux hébergeant Wolbachia .
2082: Nos gels montrent clairement que les sous-unités de l' hémocyanine sont synthétisées dans les caecums digestifs comme chez tous les autres crustacés .
2083: Il semble que la présence de Wolbachia s' accompagne d' une légère diminution de la quantité des sous-unités de l' hémocyanine synthétisées dans les caecums .
2084: Cette donnée devra être validée soit en PCR quantitative soit en slot-blots .
2085: Que ce soit pour les protéines du plasma , des hémocytes , des organes hématopoïétiques et des caecums digestifs , cette approche en électrophorèse 1D , indispensable , d' une part pour tester l' efficacité des techniques d' extraction des protéines qui seront appliquées à l' analyse en 2-D et , d' autre part pour apprécier la complexité des profils obtenus , s' est révélée assez peu résolutive .
2086: L' étude de ces différents extraits protéiques a alors été entreprise par la technique d' électrophorèse bidimensionnelle pour améliorer la séparation des nombreuses protéines mais également pour faciliter l' identification des différentes protéines présentes sur les gels .
2087: II . ÉLECTROPHORÈSE 2-D
2088: Dans le but de comparer les profils protéiques hémocytaires d' Armadillidium vulgareinfectés ou non par Wolbachia , mais aussi d' identifier des protéines du système immunitaire , nous avons choisi la technique d' électrophorèse en 2-D .
2089: Cette technique a été choisie car elle est plus résolutive que celle des gels en 1-D , d' une part ( parce ce que les protéines sont séparées selon leur point isoélectrique et leur masse moléculaire ) et d' autre part parce que les analyses de spots protéiques obtenus à l' issue de ces gels permettent l' identification de protéines par spectrométrie de masse après digestions trypsiques .
2090: Les problèmes de migration des protéines de même masse moléculaire et de contamination des bandes à prélever sont ainsi diminués .
2091: Nous nous sommes intéressés , comme pour les analyses en 1-D , au protéines hémocytaires et plasmatiques .
2092: Les protéines hémocytaires ont été extraites par sonication dans de l' acide acétique 0 , 2 N , puis précipitées à l' acétone et reprises dans le tampon de solubilisation pour être déposées sur les strips .
2093: Cette méthode d' extraction nous permet d' obtenir les protéines cytosoliques et granulaires .
2094: Les protéines plasmatiques , quant à elles , ont subit un traitement HCl 0 , 1 M , afin d' éliminer au maximum l' hémocyanine , puis elles ont été déposées sur cartouche Sep-Pak et éluées par une solution d' ACN à 80 % .
2095: Une fois séchées et reprises dans le tampon de solubilisation , les protéines ont été dosées et les strips ont été chargées en protéines hémocytaires ou plasmatiques à raison de 400 & 206;& 144;g par strip .
2096: Dans un premier temps , l' isofocalisation et l' électrophorèse des protéines ont été réalisées au laboratoire afin de mettre au point les meilleures conditions expérimentales .
2097: En effet , de nombreux paramètres sont très importants et particulièrement l' extraction des protéines ( les échantillons ont été désalés et les lipides de réserve et membranaires ont été éliminés ) .
2098: Ces premiers gels ont été colorés à l' argent ce qui permet une bonne résolution et donc de déterminer les conditions optimales de préparation des échantillons .
2099: Par contre , cette méthode de coloration ne permet pas leur exploitation car la présence d' argent est incompatible avec les analyses en spectrométrie de masse .
2100: Une fois les mises au point réalisées , les gels ont été effectués plusieurs fois et leur reproductibilité nous a autorisé à poursuivre cette étude en utilisant une coloration au bleu colloïdal ( G- 105 ) qui permet une analyse des protéines en spectrométrie de masse de type
2101: Q-TOF , ceci après digestion enzymatique .
2102: Au cours d' un stage de deux semaines dans le
2103: Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio- Organique de Strasbourg ( dirigé par le Dr . A . Van
2104: Dorsselaer ) , les gels d' électophorèse bidimensionnelle , leur analyse et le prélèvement des spots d' intérêt ont été réalisés avec l' aide de Mme Danièle Thiersé .
2105: Les protéines contenues dans ces spots ont été digérées et analysées en spectrométrie de masse de type Q-TOF par le Dr
2106: J.M . Strub .
2107: Toutes les données obtenues ont été traitées avec le logiciel MASCOT et toutes les microséquences ont été comparées dans les banques de données afin d' identifier les protéines dont elles étaient issues .
2108: Quand l' analyse dans MASCOT s' est avérée infructueuse , chaque microséquence a été soumise à un Blast dans l' EBI .
2109: Figure 40 . :
2110: Carte 2-D des protéines hémocytaires de femelles d' Armadillidium vulgare non infectées .
2111: Les protéines entourées d' un rond vert ont été prélevées et analysées en spectrométrie de masse ( Q-TOF ) après coupure trypsique .
2112: Les protéines identifiées sont indiquées en blanc .
2113: Le triangle et les carrés blancs indiquent les protéines identiques .
2114: MM :
2115: Masse Moléculaire .
2116: NL :
2117: strip non linéaire .
2118: II.1 . Hémocytes L' identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare a été réalisée à partir de 8 gels .
2119: Trois cents spots ont ainsi été prélevés et analysés .
2120: Pour les protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia , 59 spots ont été prélevés et analysés à partir de 2 gels .
2121: L' analyse des microséquences obtenues pour ces spots nous a conduit à l' identification de 54 protéines spécifiques d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia et 3 protéines bactériennes dont une spécifique de Wolbachia .
2122: 1.1 . Identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare .
2123: L' ensemble des résultats obtenus pour les gels des protéines hémocytaires est figuré sur une carte bidimensionnelle ( Figure 40 ) .
2124: Les différentes protéines identifiées à partir de cette carte sont regroupées dans le Tableau 10 , p 156 .
2125: Il faut souligner que les comparaisons de microséquences ne peuvent être réalisées qu' à partir d' organismes plus ou moins proches tels que les crustacés décapodes ou les insectes ( drosophile , anophèle ... ) puisque très peu de protéines d' Armadillidium vulgare ont été déposées dans les banques de données .
2126: Il en est de même pour les protéines de Wolbachia qui seront comparées avec l' ensemble des bactéries connues .
2127: Ces protéines ont été regroupées en quatre catégories :
2128: les protéines impliquées dans la réponse au stress , dans la constitution du cytosquelette , dans les réactions enzymatiques et les protéines non classables .
2129: Les protéines enzymatiques :
2130: La majorité des protéines enzymatiques identifiées , par soumission dans les banques de données , des microséquences obtenues en spectrométrie de masse , intervient dans le métabolisme du glucose :
2131: 6 phosphogluconate dehydrogenase , fructose 1 - 6 diphosphate aldolase , glyceraldéhyde 3 phosphate dehydrogénase , énolase , NAD dependant malic enzyme , pyruvate kinase , transketolase .
2132: Ces protéines enzymatiques , présentes en quantité importante ( intensité des spots et répartition ) , fournissent l' énergie nécessaire au fonctionnement des cellules mais également à la synthèse des protéines spécifiques de la réponse immunitaire qui sont stockées dans les granules .
2133: D' autres protéines enzymatiques , telles que des kinases et des protéases , sont trouvées abondamment , preuve d' une activité cellulaire importante .
2134: Parmi les protéases , une a retenu notre attention :
2135: la cathepsine lysosomale .
2136: En effet lors de la caractérisation de l' astacidine ( peptide antibactérien clivé à partir de l' hémocyanine ) , Lee et collaborateurs ( 2003 ) ont montré que le clivage de l' hémocyanine était inhibé par ajout de pepstatine ou de E- 64 .
2137: Ces deux inhibiteurs de protéases agissent respectivement sur des aspartyl protéases et sur des cystéine-protéases .
2138: Pour ces auteurs , ces protéases doivent être lysosomales pour être libérés dans l' hémolymphe , en même temps que les autres effecteurs de l' immunité .
2139: Comme les cathepsines D sont des aspartyl protéases , la cathepsine D « lysosomale » identifiée semble être un bon candidat pour générer des peptides à partir de l' extrémité C-terminale de l' hémocyanine .
2140: L' activité de cette cathepsine D « lysosomale » pourra être testée sur l' hémocyanine d' Armadillidium vulgare afin de voir si elle est capable de la cliver et de générer des peptides antimicrobiens , dont le peptide antifongique que nous avons caractérisé ( Chapitre III . ) .
2141: Figure 41 :
2142: Représentation schématique des caractéristiques structurales de différentes protéines apparentées au cytosquelette
2143: . Parmi ces protéines , la profiline , la vinculine et les différentes formes de l' actine ont été identifiées en électrophorèse bidimensionnelle ( Golstreyn et al. , 2000 ; pour revue ) .
2144: Les protéines du cytosquelette :
2145: De nombreuses protéines constitutives du cytosquelette ont également été identifiées .
2146: Ces protéines constituent une part importante de l' ensemble des protéines hémocytaires .
2147: En effet , de nombreux spots , dont un très dense , ont été identifiés comme différentes formes de l' actine ( & 206;& 133;-actine et & 206;& 134;-actine ) , d' autres correspondent à la & 206;& 134; II tubuline .
2148: L' analyse des microséquences a permis de mettre en évidence cinq protéines associées au cytosquelette :
2149: la vinculine , la profiline , la tropomyosine et deux calponines .
2150: L' implication de ces protéines associées au cytosquelette est schématisée Figure 41 .
2151: La profiline est une protéine de modulation et de contrôle des mouvements de l' actine .
2152: Elle lie les molécules monomériques d' actine pour former des complexes qui vont s' associer avec les extrémités des filaments d' actines permettant ainsi leur croissance .
2153: La vinculine est une protéine des plaques focales d' adhésion qui permet l' ancrage du cytosquelette d' actine à la membrane plasmique .
2154: Cette protéine est la cible de certaines bactéries telles que les Shigella
2155: ( Figure 42 , p 160 ) .
2156: En effet , ces bactéries produisent une protéines appelée IpaA , qui est excrétée dans la cellule hôte par un système de sécrétion de type III .
2157: Figure 42 :
2158: Schéma des différents mécanismes d' entrée des bactéries dans les cellules hôtes
2159: . A . Le mécanisme « Zipper » utilisé par Yersinia et Listeria .
2160: B . Le mécanisme « Trigger » utilisé par Salmonella et Shigella ( d' après Cossart et Sansonetti , 2004 ) .
2161: Cette IpaA se lie spécifiquement à la vinculine dans son domaine N-terminal , ce qui entraîne une modification de la structure de la vinculine qui se déplie et induit l' activation du complexe .
2162: L' activation de la vinculine par IpaA interviendrait dans la formation d' une structure d' adhésion transitoire de la bactérie à la membrane de la cellule ( Cossart et Sansonetti , 2004 ; pour revue ) .
2163: De plus , ce complexe présente une activité de dépolymérisation des filaments d' actine ( Bourdet-Sicard et al. , 1999 ) .
2164: La déstabilisation de cette protéine permet donc l' entrée de bactéries dans les cellules sans que celles -ci ne soient reconnues .
2165: Le mécanisme d' entrée de Wolbachia dans les cellules de son hôte n' est pas connu , cependant au cours de la caractérisation du génome de cette bactérie , un système de secrétions de type
2166: IV a pu être identifié ( Felix et al. , Soumis ) et rapporté à deux opérons distincts .
2167: Ce système de type IV doit permettre le transfert des facteurs de virulence vers le cytoplasme de la cellule hôte au travers de la paroi bactérienne .
2168: Néanmoins , lors de la colonisation de nouvelles cellules saines , cette bactérie peut se retrouver à l' extérieur des cellules , alors elle doit adresser ces facteurs de virulence à la surface externe des cellules hôtes pour se faire phagocyter .
2169: Donc , des interactions avec le cytosquelette sont probables d' autant plus que certaines de nos observations effectuées par ailleurs les suspectent .
2170: A ce titre , la vinculine pourrait être une des protéines cible .
2171: Les calponines constituent une famille de protéines , dépendantes du calcium , qui se lient aussi bien à l' actine monomérique ( actine G ) qu' aux filaments d' actines ( actine F ) mais également à la tropomyosine dans les muscles .
2172: Dans les autres tissus , la calponine est dite acide et n' est pas dépendante du calcium .
2173: Quelque soit sa forme et sa localisation tissulaire , elle intervient dans l' organisation du cytosquelette des cellules .
2174: La tropomyosine est une protéine associée au cytosquelette des cellules musculaires qui permet la liaison entre les fibres d' actines et les fibres de myosines .
2175: Chez les crustacés , la tropomyosine est un allergène qui , jusqu'à présent , a été uniquement trouvé dans les muscles .
2176: Il est alors surprenant d' identifier cette protéine dans les hémocytes d' Armadillidium vulgare puisque ces cellules ne sont pas musculaires et ne sont donc pas constituées de tropomyosine .
2177: Il est peu probable que des cellules musculaires aient été prélevées en même temps que l' hémolymphe et aient contaminé les échantillons .
2178: D' autant plus que cette protéine a été retrouvée systématiquement dans tous les gels qui ont été analysés .
2179: Des analyses plus complètes de cette protéine , notamment au niveau de sa transcription ( par northern blot ) permettrait de confirmer sa présence dans les hémocytes ou de mettre en évidence une contamination insoupçonnée des protéines hémocytaires par des protéines musculaires .
2180: Les cyclophilines sont des peptidyl-prolyl cis / trans isomérases , qui peuvent être ou non cytosoliques .
2181: La cyclophiline A ( cytosolique ) se lie aux cyclosporines A munosuppressives ( Fischer et al. , 1989 ) pour former un complexe qui supprime les réactions immunitaires en inhibant une sérine protéase :
2182: la calcineurine ( Liu et al. , 1991 ) .
2183: La cyclophiline B présente les mêmes propriétés enzymatiques que la précédente .
2184: Elle se trouve principalement dans le réticulum endoplasmique où elle est impliquée dans les processus de sécrétion des protéines ( Galat , 1993 ) .
2185: Une cyclophiline G , isolée chez la limule ( chélicérates ) ( Takaki et al. , 1997 ) , est présente dans les granules L , un des deux types de granules sécrétoires des hémocytes .
2186: Ces granules sont fonctionnellement proches de ceux observés dans les hémocytes granulaires de crustacés .
2187: De la même manière , ils comportent de nombreuses protéines impliquées dans les réactions de défense , telles que les facteurs de coagulation , les lectines et les peptides antibactériens ( Seki et al. , 1994 ; Muta et Iwanaga , 1996 ) .
2188: De part son activité cis / trans isomérase , cette protéine a un rôle dans le maintien de conformation appropriée de certaines protéines telles que les protéines de coagulation .
2189: Les cyclophilines étant aussi généralement des protéines chaperonnes , Takaki et collaborateurs ( 1997 ) proposent que la cyclophiline G agisse également sur le repliement des protéines ;
2190: cette protéine serait donc impliquée dans le contrôle de la qualité du stockage des protéines .
2191: Le mécanisme de stockage des protéines hémocytaires de la limule pourrait être semblable à celui des crustacés et ainsi , la présence d' une cyclophiline
2192: G dans les hémocytes d' Armadillidium vulgare suggère une fonction équivalente :
2193: éviter la dégradation des protéines intragranulaires .
2194: Une immunolocalisation de cette protéine serait alors nécessaire pour lui attribuer cette fonction .
2195: Protéines de réponse au stress :
2196: Les heat shock protéines sont les protéines chaperonnes intracellulaires les plus conservées , au niveau structural et fonctionnel , elles constituent plusieurs superfamilles multigéniques .
2197: Elles sont présentes dans tous les compartiments cellulaires ( noyau , mitochondries , réticulum endoplasmique , cytosol ) de toutes les cellules depuis les procaryotes jusqu'aux eucaryotes .
2198: Les fonctions attribuées à ces heat shock protéines sont :
2199: - Prévenir l' agrégation des protéines lors d' un stress physique .
2200: - Servir de chaperonne lors du transport des protéines entre les différents organites .
2201: - Contribuer au repliement des protéines natives .
2202: - Agir dans les processus immunologiques ( innés et acquise ) ( Robert , 2003 ) .
2203: L' analyse des protéines hémocytaires a permis de mettre en évidence deux types de Heat
2204: Shock protéines , appartenant à deux familles ( la nomenclature de ces protéines est basée sur leur masse moléculaire apparente ) :
2205: la famille des hsp 70 ( cytosolique ) et celle des hsp 90 ( gp 96 , réticulum endoplasmique ) .
2206: Les hsp 70 ne sont pas exprimées dans tous les tissus et sont hautement inductibles lors de stress ( Robert 2003 , pour revue ) .
2207: Dans le réticulum endoplasmique gp 96 est la protéine la plus abondante ( Koch et al. , 1986 ) .
2208: C' est une glycoprotéine dépendante du calcium qui peut former des oligomères pour s' associer à de nombreuses protéines telles que les protéines kinases , la calréticuline ou le grp 78 .
2209: Chez les mammifères , les hsp sont impliquées dans la réponse médiée par les macrophages et les lymphocytes T ( Robert 2003 , pour revue ) .
2210: Réponse immunitaire :
2211: Chez Armadillidium vulgare , avant ce travail , aucune molécule du système immunitaire n' était connue .
2212: La cartographie bidimensionnelle des protéines hémocytaires a permis d' identifier , par homologie de séquence , toutes les sérines protéases impliquées dans la cascade de mélanisation , différentes protéines d' adhésion / communication cellulaire , mais également des molécules de détoxification .
2213: La cascade des sérines protéases de mélanisation est schématisée Figure 43 , p 164 .
2214: Lors d' une infection microbienne , les déterminants antigéniques des pathogènes sont reconnus par des protéines de reconnaissance ( & 206;& 134;GBP ou LGBP ) circulantes qui vont activer la voie des sérine protéases au niveau des hémocytes .
2215: Une première enzyme , la Pro-prophénoloxydase activating activating enzyme ( pro-ppA ) va être activée sous sa forme prophénoloxydase activating activating factor ( ppA ) par clivage grâce à une sérine protéase du type masquerade-like protéine .
2216: Cette ppA alors activée va à son tour cliver la Prophénoloxydase ( ProPO ) pour libérer sa forme active , la phénoloxyase ( PO ) .
2217: Cette dernière enzyme catalyse alors , en présence d' O 2 , la transformation des composés phénoliques en quinones , qui vont , par une réaction non enzymatique s' associer et former la mélanine ( pigments noirs ) .
2218: Toutes les sérines protéases impliquées dans cette cascade ont été identifiées sur les gels d' électrophorèse bidimensionnelle .
2219: Par contre l' analyse des microséquences ne nous a pas permis d' établir la présence de la ProPO .
2220: Cette analyse des spot a uniquement révélé la présence de microséquences ayant des homologies avec les séquences de l' hémocyanine de plusieurs espèces de décapodes .
2221: Comme nous l' avons déjà signalé , l' hémocyanine et la ProPO présentent de nombreuses homologies de séquence ( Annexe
2222: III ) .
2223: Les microséquences obtenues peuvent correspondre à des séquences communes à l' hémocyanine et aux ProPO , nous pouvons donc supposer que les microséquences obtenues correspondent à la ProPO .
2224: Cependant , une contamination des protéines hémocytaires de l' échantillon par l' hémocyanine plasmatique n' est pas possible à exclure malgré le lavage des hémocytes avant l' extraction des protéines .
2225: D' autre part , une protéine inhibitrice des sérines protéases a été identifiée , il s' agit d' une & 206;& 133; 2- macroglobuline .
2226: Cette protéine est membre de la famille des & 206;& 133; 2 - macroglobulines , qui inclut de nombreux inhibiteurs de protéases mais aussi les protéines C3 , C4 et C5 du système du complément ( Armstrong et Quigley , 1999 ) .
2227: Cette protéine , isolée chez toutes les classes de vertébrés et chez de nombreux invertébrés , présente un large spectre de liaison aux protéases , qui permet l' élimination des protéases circulantes dans le plasma ( Melchior et al. , 1995 ) .
2228: Chez les crustacés , différentes & 206;& 133; 2- macroglobulines ont été isolées et caractérisées dans les hémocytes
2229: ( Spycher et al. , 1987 ; Hergennahn et al. , 1988 ; Stöcker et al. , 1991 ; Gollas- Galvanet al. , 2003 ; Rattanachaiet al. , 2004 ) et de plus , il a été montré qu' elles ont d' une part une activité contre les pathogènes ( Dieguez-Uribeondo et Cerenius , 1998 ) et que d' autre part elles sont nécessaires à l' activation du système ProPO ( Aspan et al. , 1990 ; Lee et Söderhäll , 2002 ) .
2230: De plus , son domaine de liaison riche en glycine et localisé dans sa partie C-terminale est capable de se lier à des protéines de surface cellulaire , permettant ainsi les phénomènes d' endocytose médiée par des récepteurs ( Sottrup-Jensen , 1989 ) .
2231: Rattanachai etal . ( 2004 ) ont par ailleurs montré que l' expression de l' & 206;& 133; 2- macroglobuline est augmentée lors de l' induction de la réponse immunitaire par des polyglycanes ou du LPS , confirmant l' importance de cette protéine dans la réponse immunitaire .
2232: Cette protéine présente donc de nombreux intérêts et nécessitera une attention particulière dans la caractérisation du système immunitaire d' Armadillidium vulgare .
2233: Plusieurs péroxinectines ont été identifiés dans les protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare .
2234: Les péroxinectines ont été isolées pour la première fois dans les hémocytes de l' écrevisse Pacifastacus leniusculus ( Johanssonet al. , 1995 ) .
2235: Cette protéine est une molécule d' adhésion cellulaire qui présente un domaine péroxydasique et un motif de liaison aux intégrines .
2236: De nombreux rôles , en plus de son rôle de détoxifiant ( activité péroxydase ) , sont attribués à cette molécule et notamment un rôle d' opsonination
2237: ( Thörnqvistet al. , 1994 ) , d' induction de la dégranulation ( Johansson et Söderhäll , 1989 ) et de la phagocytose ( Kobayashi et al. , 1990 ) .
2238: De plus , les péroxinectines , liées à une superoxyde dismutase extracellulaire ( EC-SOD ) , peuvent produire des acides hypochloreux , à partir du péroxyde d' hydrogène produit par la EC-SOD , qui agiraient comme un système microbicide lors des attaques bactériennes ( Holmblad et Söderhäll , 1997 ) .
2239: Chez les décapodes , deux études ( Johanssonet al. , 1995 ; Sritunyalucksanaet al. , 2001 ) ont montré que l' activité péroxydasique des péroxinectines n' était pas nécessaire à leurs propriétés d' adhésion cellulaire , celles -ci étant démasquées lors de l' activation du système ProPO .
2240: Récemment , plusieurs publications relatives aux péroxinectines ont montré d' une part , que ces protéines d' adhésion cellulaire étaient fortement exprimées dans les organes hématopoïétiques ( Söderhället al. , 2003 ) et , d' autre part , leur surexpression dans les cellules semi-granulaires et granulaires lors d' une infection par certains pathogènes ( Liu et al. , 2005 ) .
2241: De part ces diverses propriétés , la péroxinectine constitue une des molécules clés de la réponse immunitaire et méritera également une attention particulière principalement lors d' études expérimentales de la phagocytose des microorganismes .
2242: La transglutaminase ( TGase ) est une protéine du système de coagulation , qui est localisée dans les hémocytes des crustacés , et plus particulièrement dans les hémocytes hyalins et semi-granulaires ( Aono et Mori , 1996 ) .
2243: Les TGases sont des enzymes dépendantes du Ca 2 + capables de former des liaisons covalentes entre des lysines libres et les résidus glutamines de certaines protéines .
2244: Lors de l' activation de la réponse immunitaire , ces protéines sont libérées dans le plasma ( en même temps que le système ProPO , les peptides antimicrobiens ... ) .
2245: Figure 43 :
2246: Schéma du système prophénoloxydase ( ProPO ) et de sa cascade d' activation chez les crustacés ( d' après Cerenius et Söderhäll , 2004 ) .
2247: Sont encadrées en rouge , les protéines identifiées dans les hémocytes d' Armadillidium vulgare .
2248: Dans le plasma , les TGases sont activées , de manière non enzymatique , par la concentration en Ca 2 + .
2249: Elles vont alors lier entre elles les protéines de coagulation synthétisées dans l' hépatopancréas chez les décapodes pour former un caillot ( Kopacek et al. , 1993a ; Hall et al. , 1995 ; Hall et al. , 1999 ) .
2250: Il a été montré qu' une protéine apparentée à la vitellogénine , présente aussi bien chez les mâles que les femelles joue ce rôle de facteur de coagulation ( Hallet al. , 1999 ) .
2251: Cependant , de par leurs fonctions très différentes et la production constitutive de la protéine de coagulation , cette dernière n' est pas considérée comme une véritable vitellogénine .
2252: Le phénomène de coagulation est très important pour préserver l' homéostasie de l' animal .
2253: En effet , il permet de combler les brèches du tégument limitant ainsi les hémorragies mais aussi , par des réactions extrêmement ciblées , la gélification localisée de l' hémolymphe entraînant l' immobilisation des microorganismes .
2254: La cascade aboutissant à la coagulation ainsi que celle conduisant à la production de mélanine sont des phénomènes coopératifs si l' on considère la guérison des blessures mais également des infections microbiennes .
2255: L' isolement de ces facteurs de coagulation devra donc être entrepris chez Armadillidium vulgare au niveau des caecums digestifs , tissu équivalent de l' hépatopancréas des décapodes .
2256: Une dernière protéine d' intérêt , la calréticuline ( CRT ) est présente dans les hémocytes d' Armadillidium vulgare .
2257: La CRT est une protéine ubiquitaire dépendante du
2258: Ca 2 + , qui possède des propriétés multifonctionnelles .
2259: A l' origine , cette protéine a été identifiée comme une protéine chaperonne associée au réticulum endoplasmique
2260: ( Michalaket al. , 1992 ) .
2261: Depuis , cette protéine a été isolée chez différentes espèces animales et végétales et dans différents tissus .
2262: Il apparaît que les CRT peuvent être subdivisées en trois domaines dont chacun possède une fonction particulière :
2263: la partie N-terminale , la région centrale riche en proline et la partie C-terminale
2264: ( Nakhasiet al. , 1998 , pour revue ) .
2265: La partie N-terminale est impliquée dans les interactions protéines-protéines , la liaison aux métaux et à l' ARN .
2266: Le domaine riche en proline , abritant le site de liaison au Ca 2 + , présente des fonctions de chaperonne et de liaisons aux lectines .
2267: Contrairement au deux première régions identifiées , la partie C-terminale est très peu conservée d' une CRT à l' autre .
2268: La CRT est impliquée dans la régulation de l' adhésion cellulaire ( Malhotra et al. , 1993 ) , l' élimination des cellules apoptotiques ( Ogden et al. , 2001 ) , et il a été montré que les capsules formées par les larves de Galleria mellonella mellonella en sont enrichies ( Choi et al. , 2002 ) .
2269: Récemment , Asgari et collaborateurs ont montré que la CRT est impliquée dans la phagocytose des corps étrangers chez certains insectes ( Asgari et Schmidt , 2003 ) .
2270: La CRT est donc impliquée dans le système immunitaire et plus particulièrement dans la réponse cellulaire .
2271: La caractérisation moléculaire et fonctionnelle de cette protéine pourrait nous permettre de compléter l' étude des modifications probables du cytosquelette lors des infections d' Armadillidium vulgare par Wolbachia .
2272: Des molécules de détoxification ont également été mises en évidence dans les hémocytes de notre modèle d' étude , notamment une catalase , dont le rôle est proche de celui des péroxydases ( également présente ) , une SOD cytosolique dépendante du manganèse et une glutathion S transférase .
2273: Ces enzymes se retrouvent dans toutes le cellules , permettant leur détoxification .
2274: Enfin , deux protéines ont été identifiées comme des protéines d' Armadillidium vulgare déjà connues , il s' agit de deux facteurs d' élongation de type 1 et 2 .
2275: Ces deux facteurs participent à l' élongation de la chaîne protéique chez la majorité des eucaryotes .
2276: 1.2 . Identification des protéines hémocytaires d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia .
2277: Pour cette expérience , les protéines des hémocytes de 50 animaux infectés ou non par Wolbachia ont été extraites et soumises à une isofocalisation puis à une électrophorèse sur gel d' acrylamide ( 12 , 5 % ) .
2278: Les gels obtenus sont présentés Figure 44 , p 170 et 45 , p 171 .
2279: Les spots prélevés correspondent d' une part à des protéines représentées sur les deux gels et , d' autre part , à des protéines n' apparaissant que sur un des deux gels .
2280: En effet , la comparaison des deux cartes bidimensionnelles d' Armadillidium vulgare infectés ou non par Wolbachia montre que certains spots présentent un différentiel d' expression protéique .
2281: Pour plus de facilité , le résultat de cette analyse différentielle est synthétisée sur la Figure 46 , p 172 .
2282: Ainsi , certaines protéines semblent moins exprimées chez les animaux porteurs de la bactérie , le spot correspondant à l' actine en est le meilleur exemple .
2283: Parmi ces protéines sous exprimées ( entourées en bleu , Figure 46 , p 172 ) , différentes protéines du cytosquelette ( actine , tubuline ) ainsi que certaines de leur protéines associées ( profiline , calponine ) sont retrouvées .
2284: D' autres protéines semblent également être moins exprimées , c' est le cas des facteurs d' élongation , des Heat shock protéines , des arginines kinases mais aussi de certaines protéines non identifiées .
2285: Par contre , certaines protéines semblent surexprimées chez les animaux infectés par Wolbachia la NADP pyruvate kinase , l' UDP glycosyl transferase et les cathepsines D lysosomales présentent des spots plus intenses que ceux des animaux non infectés .
2286: Enfin , huit protéines identifiées et trois protéines inconnues semblent être exprimées en quantité équivalente chez les animaux infectés ou non par Wolbachia .
2287: Ces protéines correspondent à la péroxinectine , à une transkétolase , à l' énolase , à la calréticuline , à la vinculine , à la 14 - 3-3 zêta protéine , à la tyrosine 3 monooxygénase et à la tropomyosine .
2288: Ainsi , après comparaison des deux gels , il semble que le cytosquelette des hémocytes d' Armadillidium vulgareporteurs deWolbachia soit déstabilisé par une diminution quantitative de ses protéines spécifiques ( actine , tubuline , profiline , calponine ) .
2289: D' autre part , l' elongation facteur 1 , protéine responsable de l' élongation des protéines lors de leur synthèse apparaît également fortement diminuée .
2290: Par contre , certaines protéines du système immunitaire paraissent affectées de façons diverses au niveau de leur expression .
2291: Ainsi , le taux de ProPO semble augmenter bien que paradoxalement , la quantité de ppA , enzyme qui permet son activation ( par clivage ) , semble diminuer .
2292: Les péroxinectines et les transglutaminases sont présentes en quantité équivalente chez les deux types d' animaux .
2293: Bien évidemment , ces résultats nécessitent d' être confirmés , puisque le gel correspondant aux protéines hémocytaires des animaux infectés par
2294: Wolbachia n' a été réalisé que deux fois .
2295: Quoiqu' il en soit , ces premiers résultats sont en accord avec les observations faites en microscopie électronique , pour lesquelles une déstabilisation du cytosquelette a été soupçonnée .
2296: Pour compléter ces analyses d' expression protéiques , une étude quantitative de l' expression de ces protéines pourra être envisagée .
2297: La comparaison de l' expression des protéines du cytosquelette , entre les animaux infectés ou non par Wolbachia , par PCR quantitative en temps réel nous permettra de savoir si Wolbachia a une influence directe sur la transcription de ces gènes ou bien si son intervention est plus tardive .
2298: Figure 44 :
2299: Analyse par électrophorèse bidimensionnelle des protéines cytosoliques des hémocytes de femelles d' Armadillidium vulgare non infectées .
2300: Les ronds et carrés rouges indiquent des protéines ne présentant pas la même expression chez les animaux infectés par Wolbachia
2301: ( Figure 45 ) .
2302: MM :
2303: masse moléculaire .
2304: NL :
2305: strip non linéaire .
2306: Figure 45 :
2307: Analyse par électrophorèse bidimensionnelle des protéines cytosoliques des hémocytes de femelles d' Armadillidium vulgare infectées par Wolbachia .
2308: Les ronds rouges indiquent des protéines uniquement identifiées chez les animaux infectés par Wolbachia .
2309: MM :
2310: Figure 46 :
2311: Analyse différentielle entre les protéines cytosoliques des hémocytes des femelles d' Armadillidium vulgare non infectées et celles des femelles d' Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia .
2312: Les ronds bleus correspondent aux protéines sous exprimées chez les animaux infectés par Wolbachia .
2313: Le rectangle et les ronds verts indiquent les protéines surexprimées chez les animaux infectés par Wolbachia .
2314: Les carrés et les ronds correspondent aux protéines exprimées en quantité équivalente chez les deux types d' animaux .
2315: Les ronds rouges indiquent les protéines uniquement identifiées chez les animaux infectés par Wolbachia .
2316: MM :
2317: masse moléculaire .
2318: NL :
2319: srip non linéaire .
2320: Enfin , chez les animaux porteurs de Wolbachia , ces bactéries sont présentes dans les hémocytes et bien que leur charge par cellule soit généralement faible , nous devions retrouver des protéines de la bactéries , non présentes chez les animaux sains , sur nos gels d' électrophorèse bidimensionnelle .
2321: L' analyse des spots a montré la présence de trois protéines bactériennes un ABC transporteur ATP-dépendant , une NAD formate déshydrogénase et une protéine Wsp ( pour Wosp : Wolbachia outer surface protein ) .
2322: La comparaison des microséquences obtenue dans les banques de données montre des homologies avec la séquence de la protéine WOSP ( une protéine de surface ) de Wolbachia d' Armadillidium vulgare ( wVul ) .
2323: Nous avons donc pu mettre en évidence une protéine spécifique de la bactérie , confirmant sa présence dans les hémocytes des animaux infectés .
2324: Les deux autres protéines ont été identifiées à partir des séquences de Thermotogamaritima pour l' ABC transporteur ATP-dépendant et à partir de Mycosphaerellagraminicola pour la NADP formate déshydrogénase .
2325: Aucune homologie de séquence n' a été trouvée avec des protéines de Wolbachia .
2326: Toutefois , bien que le génome de Wolbachia ait été séquencé pour la souche issue de Drosophila mélanogaster ( wMel ) , de nombreuses différences existent entre les génomes des Wolbachia suivant les hôtes dont elles proviennent .
2327: Ainsi le génome de wVulprésente une taille estimée à 1 , 76 Mb ( Felix , 2004 ) tandis que celui de wMel est estimé à 1 , 36 Mb ( Sun et al. , 2001 ) .
2328: Le séquençage et l' annotation du génome de wVul ( travaux en cours ) devrait nous permettre d' identifier les protéines spécifiques à Wolbachia dans les profils protéiques des animaux infectés par la bactérie .
2329: Deux protéines supplémentaires semblent être présentes chez les animaux infectés , l' une d' entre elle n' a pas pu être identifiée par contre l' autre a été identifiée comme une protéine liant le sélénium ( Arabidopsis thaliana ) .
2330: De telles protéines ont été caractérisées dans le cerveau de boeuf ( Porat et al. , 2000 ) et dans les hématies des rats- taupes ( Spalax ehrenbergi ) ( Yanget al. , 1998 ) .
2331: Chez les bovins , cette protéine est impliquée dans le transport des protéines dans le golgi , tandis que dans les globules rouges des rats-taupes cette protéine doit jouer un rôle dans le stockage et le transport du sélénium vers d' autres tissus .
2332: Cette protéine n' a jamais été rapportée chez un crustacé , seule sa caractérisation permettra de lui attribuer une fonction .
2333: 1.3 . Identification des protéines plasmatiques d' Armadillidium vulgare
2334: Les cartes bidimensionnelles correspondant aux protéines plasmatiques de femelles d' Armadillidium vulgare infectées ou non par Wolbachia sont présentées sur les Figures 47 , p 175 et 48 , p 176 .
2335: Ces deux profils d' expression protéique sont très semblables et aucune différence majeure n' est évidente .
2336: Une cinquantaine de spots , pour la plupart communs aux deux gels , ont été analysés .
2337: Seulement une dizaine d' entre eux ont pu être identifiés .
2338: Dans les deux cas , l' hémocyanine et la vitellogénine sont retrouvées en grande quantité puisque ces deux protéines sont les principales composantes du plasma des femelles ( Figures 47 et 48 , p 176 - 177 ) .
2339: Ces protéines sont résolues avec des masses moléculaires différentes , nous obtenons ainsi des protéines natives ( hémocyanine 70 kDa environ , vitellogénine 100 kDa ) mais également des produits de dégradation ( protéines dans le bas du gel ) .
2340: Ces dégradations peuvent être en partie attribuées au traitement subit par les protéines plasmatiques lors de leur acidification par
2341: HCl .
2342: La vitellogénine est une protéine synthétisée dans le tissu adipeux ( Picaud et Souty , 1980 ) , elle est présente en plus grande quantité chez les animaux infectés par Wolbachia .
2343: Cette observation est à mettre en relation avec le fait que les ovaires des animaux infectés par Wolbachia sont toujours beaucoup plus gros .
2344: Les microséquences qui correspondent à la vitellogénine ne présentent pas d' homologies avec celle d' Armadillidium vulgare qui a été partiellement caractérisée ( Okuno et al. , 2000 ) .
2345: Comme nous l' avons vu précédemment , chez les crustacés décapodes , les facteurs de coagulation sont proches des vitellogénines ( Hall et al. , 1999 ) .
2346: Leur étude pourrait permettre de mettre en évidence des facteurs de coagulation mais également de vérifier que la vitellogénine en plus grande quantité chez les animaux infectés par Wolbachia correspond bien à la protéine , responsable de la maturation des ovocytes .
2347: Figure 47 :
2348: Analyse par électrophorèse bidimensionnelle des protéines plasmatiques , après traitement àHCl 0 , 1 M , des femelles d' Armadillidium vulgare non infectées .
2349: Les protéines entourées d' un rond vert ont été prélevées et analysées en spectrométrie de masse ( Q-TOF ) après coupure trypsique .
2350: Les protéines identifiées sont indiquées en vert .
2351: Les rectangles verts correspondent aux protéines identiques .
2352: MM :
2353: masse moléculaire .
2354: NL :
2355: strip non linéaire .
2356: Figure 48 :
2357: Analyse par électrophorèse bidimensionnelle des protéines plasmatiques , traitées par HCl 0 , 1 M , de femelles d' Armadillidium vulgare infectées par
2358: Wolbachia .
2359: Les protéines entourées d' un rond vert ont été prélevées et analysées en spectrométrie de masse ( Q-TOF ) après coupure trypsique .
2360: Les protéines identifiées sont indiquées en vert .
2361: Les rectangles verts correspondent aux protéines identiques .
2362: MM :
2363: masse moléculaire .
2364: NL :
2365: strip non linéaire .
2366: Trois enzymes ont été également identifiées :
2367: une aldéhyde déshydrogénase , une phosphogluconate déshydrogénase et une & 206;& 134;-fibrinogénase , qui a retenu notre attention .
2368: La
2369: & 206;& 134;-fibrinogénase est une enzyme isolée dans le venin de serpent ( Zhang et al. , 1995 ; Guo et al. , 2001 ) .
2370: Cette enzyme , apparentée aux thrombines , modifie les processus de coagulation du sang .
2371: La présence d' une telle molécule chez les crustacés n' a jamais été rapportée .
2372: Toutefois , on peut supposer qu' elle agit comme une enzyme de prévention de la coagulation de l' hémolymphe .
2373: D' autres protéines présentant des propriétés anticoagulantes ont été découvertes ces dernières années chez différents invertébrés .
2374: Ainsi , l' étude comparative des génomes de Drosophila melanogaster et d' Anopheles gambiae a montré que ces deux insectes possèdent des facteurs anticoagulants .
2375: Toutefois , ces gènes sont beaucoup plus nombreux chez le moustique que chez la drosophile ( 58 contre 13 ) , cette différence est probablement due au fait que les anti-coagulants de moustiques servent pour limiter la coagulation de leur repas de sang ( Zdobnov et al. , 2002 ) .
2376: Chez la sangsue Theromyson tessulatum , un inhibiteur du facteur Xa de coagulation a été isolé et caractérisé dans les glandes salivaires .
2377: Cette protéine permettrait de limiter la coagulation du sang lors de son aspiration mais également agirait au niveau de son stockage ( Chopin et al. , 2000 ) .
2378: Une étude plus approfondie de cette & 206;& 134;-fibrinogénase mériterait d' être poursuivie quand on connaît les implications cliniques que les thrombines peuvent avoir .
2379: En effet , les enzymes fibrinolytiques pourraient être utilisées en thérapies clinique pour la prévention de la formation des thromboses ( Willies et al. , 1989 ) .
2380: III . CONCLUSION ET PERSPECTIVES
2381: Cette étude d' identification des protéines hémocytaires et plasmatiques par la technique d' electrophorèse bidimensionnelle est la première qui ait été réalisée chez un crustacé .
2382: Elle nous a donc permis de mettre en évidence chez Armadillidiumvulgare de nombreuses protéines impliquées dans le système immunitaire , notamment toutes les enzymes de la cascade de mélanisation , mais également d' autres protéines telles que les transglutaminases , les
2383: & 206;& 133; 2- macroglobulines ou les péroxynectines .
2384: Toutes ces protéines ont été identifiées par homologie de leurs microséquences avec les protéines connues chez d' autres invertébrés , et devront être caractérisées .
2385: Pour ce faire , des amorces seront déterminées à partir de ces microséquences puis utilisées pour amplifier par RT-PCR les ADNc correspondant à ces protéines d' intérêt .
2386: Après vérification des séquences nucléotidiques et des séquences protéiques déduites , les amplifiats obtenus pourront servir de sondes pour cribler la banque d' ADNc d' hémocytes que nous avons construite .
2387: La caractérisation des différentes protéines du système immunitaire mais également du cytosquelette nous permettra d' appréhender par quel mécanismes
2388: Wolbachia parvient à pénétrer dans la cellule hôte tout en échappant au système immunitaire .
2389: Les différences d' expression des protéines hémocytaires et plasmatiques des animaux sains et infectés pourraient être déterminées en PCR quantitative , et donneraient ainsi un aspect tangible à la « course aux armements » entre hôtes et parasites .
2390: A ce titre , le rôle des messagers hormonaux ( opiacés , amines ) , rencontrés dans le système nerveux central , sur la modulation de la réponse immunitaire pourra être envisagé , d' autant que certains parasites ( éloignés de Wolbachia ) utilisent ce type de médiateurs pour détourner le système immunitaire de leurs hôtes ( Capron , 1985 ) .
2391: Par injections de molécules correspondant à des déterminants de bactéries Gram ( - ) ( LPS ) ou de champignons ( Laminarine ) , nous pourrons induire des réponses immunitaires adaptées principalement au niveau humoral .
2392: L' analyse de ces réponses en fonction du temps devrait matérialiser les conséquences ( au niveau protéique ) de la dégranulation hémocytaire provoquée , phénomène illustré par nos observations en microscopie électronique sur la perte de densité de la matrice granulaire .
2393: Conclusion Générale
2394: CONCLUSION GENERALE
2395: Ce travail a donné une trame au champ des effecteurs impliqués dans la réponse immunitaire chez un crustacé isopode terrestre ( Armadillidium vulgare ) qui peut par ailleurs héberger naturellement une bactérie endocellulaire , Wolbachia .
2396: Cette étude apporte d' une part la première caractérisation de plusieurs molécules impliquées dans la réponse immunitaire et d' autre part , elle complète nos connaissances sur l' aspect cellulaire de la réponse innée .
2397: Sur des critères de cytologie ultrastructurale , nous avons confirmé la présence de trois types hémocytaires chez Armadillidium vulgare .
2398: Ces hémocytes se différencient et subissent une maturation dans les organes hématopoïétiques .
2399: Si les différents aspects de la réponse cellulaire peuvent être partagés à des degrés divers par au moins deux types d' hémocytes , notre étude sur la réponse humorale n' apporte pas de données irréfutables quant à la spécialisation fonctionnelle des types hémocytaires ;
2400: en conséquence , une localisation précise des marqueurs potentiels ( déterminés notamment lors de l' étude en électrophorèse 2-D ) devra être entreprise par immunomarquage ou par tri cellulaire .
2401: L' analyse par chromatographie haute performance et par clonage moléculaire des peptides contenus dans les hémocytes a conduit à la caractérisation d' une molécule de 5259
2402: Da , dont la séquence riche en glycines comporte une quintuple répétition d' un motif GGGFH ( R / S ) et dont l' activité est principalement dirigée contre les bactéries Gram ( + ) .
2403: Ce peptide est synthétisé de façon constitutive .
2404: Son lieu de synthèse précis ainsi que son mode de libération ( exocytose ? ) reste à déterminer :
2405: cette libération est -elle systémique et continue ou localisée et induite ?
2406: L' étude structurale de ce peptide propre au genre Armadillidium permettrait de mieux comprendre son mode d' action .
2407: Par un même type d' approche , l' analyse sur les protéines du plasma a démontré le clivage de l' hémocyanine invitro en conditions acides :
2408: suite à l' hydrolyse de la partie C-terminale de cette molécule oxyphorique , nous avons isolé un peptide de 24 acides aminés présentant une activité antifongique principalement dirigée contre une souche de Botrytis cinerea .
2409: Nos résultats en électrophorèse 2-D accréditent l' hypothèse qu' une cathepsine D lysosomale assurerait ce clivage .
2410: Ces résultats ont par ailleurs apporté des données fructueuses qui permettent de comprendre les originalités du modèle au travers un schéma général de l' immunité innée des arthropodes .
2411: Ce travail devra être poursuivi ( 1 ) en exploitant la banque d' ADNc d' hémocytes que nous avons construite ( 2 ) par une étude en électrophorèse 2-D qui s' efforcera de mettre en évidence des protéines « up » ou « down » régulées lors d' une induction .
2412: Le cytosquelette des hémocytes est une nouvelle cible potentielle des facteurs de virulence de Wolbachia dont on peut envisager la caractérisation par des techniques d' interactions protéines-protéines ;
2413: cette bactérie exploite -t-elle une caractéristique particulière du système immunitaire de son hôte ?
2414: ou est -elle parfaitement furtive ?
2415: Références Bibliographiques
2416: REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
2417: A
2418: Abel ,
2419: C. A . ,
2420: P. A . Campbell , J. VanderWall et A. L. Hartman ( 1984 ) .
2421: " Studies on the structure and carbohydrate binding properties of lobster agglutinin 1 ( LAg 1 ) , a sialic acid binding lectin . "
2422: Prog .
2423: Clin .
2424: Biol .
2425: Res .
2426: 157 :
2427: 103 - 114 .
2428: Adachi , K. , T. Hirata , T. Nishioka et M. Sakaguchi ( 2003 ) .
2429: " Hemocyte components in crustaceans convert hemocyanin into a phenoloxidase-like enzyme . "
2430: Comp .
2431: biochem .
2432: Physiol .
2433: [ B ]
2434: 134 :
2435: 135 - 141 .
2436: Ando , K. et S. Natori ( 1988 ) .
2437: " Inhibitory effect of sarcotoxin IIA , an antibacterial protein of Sarcophaga peregrina , on growth of Escherichia coli . "
2438: J. Biochem .
2439: 103 ( 4 ) :
2440: 735 - 739 .
2441: Aono , H. et K. Mori ( 1996 ) .
2442: " Interaction between hemocytes and plasma is necessary for hemolymph coagulation in the spiny lobster , Panulirus japonicus . "
2443: Comp .
2444: Biochem .
2445: Physiol .
2446: [ A ]
2447: 113 :
2448: 301 - 305 .
2449: Armstrong ,
2450: P. B . et J. P. Quigley ( 1999 ) .
2451: " Alpha 2 -macroglobulin : an evolutionarily conserved arm of the innate immune system . "
2452: Dev .
2453: Comp .
2454: Immunol .
2455: 23 :
2456: 375 - 390 .
2457: Asgari , S. et O. Schmidt ( 2002 ) .
2458: " A coiled-coil region of an insect immune suppressor protein is involved in binding and uptake by hemocytes . "
2459: Insect Mol .
2460: Biol .
2461: 32 :
2462: 497 - 504 .
2463: Asgari , S. et O. Schmidt ( 2003 ) .
2464: " Is cell surface calreticulin involved in phagocytosis by insect hemocytes ? "
2465: J. Insect Physiol .
2466: 49 :
2467: 545 - 550 .
2468: Ashida , M. ( 1990 ) .
2469: " The prophenoloxidase cascade in insect immunity . "
2470: Res .
2471: Immunol .
2472: 141 :
2473: 908 - 910 .
2474: Aspan ,
2475: A . , M. Hall et K. Söderhäll ( 1990 ) .
2476: " The effect of endogenous proteinase inhibitors on the prophenoloxidase activating enzyme , a serine proteinase from crayfish haemocytes . "
2477: Insect Biochem .
2478: 20 :
2479: 485 - 492 .
2480: B
2481: Bachère ,
2482: E . , Y. Gueguen , M. Gonzalez ,
2483: J. d . Lorgeril , J. Garnier et B. Romestand
2484: ( 2004 ) .
2485: " Insight into the anti-microbial defense of marine invertebrates : the penaeid shrimps and the oyster Crassostrea gigas . "
2486: Immunol .
2487: Rev .
2488: 198 :
2489: 149 - 168 .
2490: Bachère ,
2491: E . ,
2492: E . Mialhe ,
2493: D . Noel ,
2494: A . Morvan et J. Rodriguez ( 1995 ) .
2495: " Knowledge and research prospect in marine molluscs and crustacean immunity . "
2496: Aquaculture
2497: 132 :
2498: 17 - 32 .
2499: Bandi ,
2500: C . ,
2501: T. J . Anderson ,
2502: C . Genchi et M. L. Blaxter ( 1998 ) .
2503: " Phylogeny of Wolbachia in filarial nematodes . "
2504: Proc .
2505: R. Soc .
2506: Lond .
2507: B . Biol .
2508: Sci .
2509: 265 ( 1413 ) :
2510: 2407 - 2413 .
2511: Bandi ,
2512: C . ,
2513: A. M . Dunn ,
2514: G. D . Hurst et T. Rigaud ( 2001 ) .
2515: " Inherited microorganisms , sexspecific virulence and reproductive parasitism . "
2516: Trends Parasitol .
2517: 17 ( 2 ) :
2518: 88 - 94 .
2519: Bandi ,
2520: C . ,
2521: J. W . McCall ,
2522: C . Genchi , S. Corona , L. Venco et L. Sacchi ( 1999 ) .
2523: " Effects of tetracycline on the filarial worms Brugia pahangi and Dirofilaria immitis and their bacterial endosymbionts Wolbachia . "
2524: Int .
2525: J. Parasitol .
2526: 29 :
2527: 357 - 364 .
2528: Barlett ,
2529: T. C . ,
2530: B. J . Cuthbertson ,
2531: E. F . Shepard ,
2532: R. W . Chapman ,
2533: P. S . Gross et G. W. Warr ( 2002 ) .
2534: " Crustin , homologues of an 11 , 5 kDa antibacterial peptide , from two species of penaeid shrimp , Litopenaeus vannamei and Litopenaeus setifus . "
2535: Mar .
2536: Biotechnol .
2537: 4 :
2538: 278
2539: 293 .
2540: Barracco , L. ,
2541: B . Duvic et K. Söderhäll ( 1991 ) .
2542: " The beta- 1 , 3- glucan-binding protein from the crayfish Pacifastacus leniusculus , when reacted reacted with a beta- 1 , 3- glucan , induces spreading and degranulation of crayfish granular cells . "
2543: Cell .
2544: Tissue Res .
2545: 266 :
2546: 491 - 497 .
2547: Bauchau ,
2548: A. G . ( 1980 ) .
2549: Crustacean .
2550: In Invertebrate Blood Cells .
2551: N. A . Ratcliffe and A .
2552: F . Rowley .
2553: New York , Academic Press :
2554: 385 - 420 .
2555: Bayne ,
2556: C. J . ( 1990 ) .
2557: " Phagocytosis and non-self recognition in invertebrates . Phagocytosis appears to be an ancient line of defense . "
2558: Bioscience
2559: 40 :
2560: 723 - 731 .
2561: Bell ,
2562: K. L . et V. J. Smith ( 1993 ) .
2563: " In vitro superoxide production by hyaline cells of the shore crab Carcinus maenas . "
2564: Dev .
2565: Comp .
2566: Immunol .
2567: 17 ( 3 ) :
2568: 211 - 219 .
2569: Bellamy , W. , M. Takase , K. Yamauchi , H. Wakabayashi , K. Kawase et M. Tomita
2570: ( 1992 ) .
2571: " Identification of the bactericidal domain of lactoferrin . "
2572: Biochim .
2573: Biophys .
2574: Acta .
2575: 1121 ( 1 - 2 ) :
2576: 130 - 136 .
2577: Boman , H. ( 1995 ) .
2578: " Peptide antibiotics and their role in innate immunity . "
2579: Ann .
2580: Rev .
2581: Immunol .
2582: 13 :
2583: 61 - 92 .
2584: Boman ,
2585: H. G . et H. Steiner ( 1981 ) .
2586: " Humorale immunity in Cecropia . "
2587: Curr .
2588: Op .
2589: Microbiol .
2590: Immunol .
2591: 94 - 95 :
2592: 75 - 91
2593: Bothwell ,
2594: A . , G. Yankopoulos et F. Alt ( 1990 ) .
2595: Methods for cloning and analysis of eucaryotic genes .
2596: In Methods for cloning and analysis of eucaryotic genes .
2597: J. A . Barlett .
2598: Boston , Jones and Barlett :
2599: 15 - 17 .
2600: Bouchon ,
2601: D . , T. Rigaud et P. Juchault ( 1998 ) .
2602: " Evidence for widespead Wolbachia infection in isopod crustaceans : molecular identification and host feminization . "
2603: Proc .
2604: R. Soc .
2605: Lond .
2606: B . Biol .
2607: Sci .
2608: 265 ( 1401 ) :
2609: 1081 - 1090 .
2610: Boulanger , N. ,
2611: R. J. L . Munks , J .
2612: V . Hamilton ,
2613: F . Vovelle , R. Brun ,
2614: M. J . Lehane et P. Bulet ( 2002 ) .
2615: " Epithelial Innate Immunity . A novel antimicrobial peptide with antiparasitic activity in the blood-sucking insect Stomoxy calcitrans . "
2616: J. Biol .
2617: Chem .
2618: 277 :
2619: 49921 - 49926 .
2620: Bourdet-Sicard , R. , M. Rudiger ,
2621: B. M . Jockusch , P. Gounon , P. Sansonetti et G. T. Nhieu ( 1999 ) .
2622: " Binding of the Shigella protein IpaA to vinculin induces F-actin depolymerization . "
2623: EMBO J .
2624: 18 ( 21 ) :
2625: 5853 - 5862 .
2626: Bradford ,
2627: M. M . ( 1976 ) .
2628: " A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding . "
2629: Anal .
2630: Biochem .
2631: 72 :
2632: 248
2633: 254 .
2634: Braig ,
2635: H. R . , W. Zhou ,
2636: S. L . Dobson et S. L. O'Neill ( 1998 ) .
2637: " Cloning and characterization of a gene encoding the major surface protein of the bacterial endosymbiont Wolbachia pipientis . "
2638: J. Bacteriol .
2639: 180 ( 9 ) :
2640: 2373 - 2378 .
2641: Breeuwer ,
2642: J. A . et F. Jacobs ( 1996 ) .
2643: " Wolbachia : intracellular manipulators of mite reproduction . "
2644: Exp .
2645: Appl .
2646: Acarol .
2647: 20 :
2648: 421 - 434 .
2649: Broakaert ,
2650: W. F . ,
2651: F. R. G . Terras et B .
2652: P. A . Cammue ( 1995 ) .
2653: " Plant defensins : novel antimicrobial peptides as components of the host defense system . "
2654: Plant .
2655: Physiol .
2656: 108 :
2657: 13531358 .
2658: Brumell ,
2659: J. H . et S. Grinstein ( 2003 ) .
2660: " Role of lipid-mediated signal transduction in bacterial internalization . "
2661: Cell .
2662: Microbiol .
2663: 5 ( 5 ) :
2664: 287 - 297 .
2665: Brumell ,
2666: J. H . et S. Grinstein ( 2004 ) .
2667: " Salmonella redirects phagosomal maturation . "
2668: Curr .
2669: Op .
2670: Microbiol .
2671: 7 :
2672: 78 - 84 .
2673: Bulet , P. , M. Charlet et C. Hetru ( 2002 ) .
2674: Antibacterial Peptides in Insect Immunity .
2675: In Infectious Disease :
2676: Innate Immunity .
2677: R. A. B . Ezekowitz and J .
2678: A . Hoffmann .
2679: Totowa NJ , Humana Press Inc .
2680: Bulet , P. ,
2681: C . Hetru ,
2682: J. L . Dimarcq et D. Hoffmann ( 1999 ) .
2683: " Antimicrobial peptides in insects ; structure and function . "
2684: Dev .
2685: Comp .
2686: Immunol .
2687: 23 :
2688: 329 - 344 .
2689: Bulet , P. , R. Stöcklin et L. Menin ( 2004 ) .
2690: " Anti-microbial peptides : from invertebrates to vertebrates . "
2691: Immunol .
2692: Rev .
2693: 198 :
2694: 169 - 184 .
2695: C
2696: Capron ,
2697: A . ( 1995 ) .
2698: " Le language moléculaire des parasites . "
2699: M / S
2700: 11 :
2701: 431 - 439
2702: Casteels , P. ,
2703: C . Ampe ,
2704: F . Jacobs , M. Vaeck et P. Tempst ( 1989 ) .
2705: " Apidaecins : antibacterial peptides from honeybees . "
2706: EMBO J .
2707: 8 ( 8 ) :
2708: 2387 - 2391 .
2709: Casteels-Josson , K. , T. Capaci , P. Casteels et P. Tempst ( 1993 ) .
2710: " Apidaecin multipeptide precursor structure : a putative mechanism for amplification of the insect antibacterial response . "
2711: EMBO J. 12 ( 4 ) :
2712: 1569 - 1578 .
2713: Cerenius , J. , Z. Liang et B. Duvic ( 1994 ) .
2714: " Structure and biological activity of a beta- 1 , 3 glucan binding protein in crustacean blood . "
2715: J. Biol .
2716: Chem .
2717: 269 :
2718: 29462 - 29467 .
2719: 184
2720: Cerenius , L. et K. Söderhäll ( 2004 ) .
2721: " The prophenoloxidase-activating system in invertebrates . "
2722: Immunol .
2723: Rev .
2724: 2004 198 :
2725: 116 - 126 .
2726: Chanock ,
2727: S. J . , J. el Benna ,
2728: R. M . Smith et B. M. Babior ( 1994 ) .
2729: " The respiratoty burst oxidase . "
2730: J. Biol .
2731: Chem .
2732: 269 ( 40 ) :
2733: 24519 - 24522 .
2734: Charlet , M. ,
2735: C. S . , H. Philippe ,
2736: C . Hétru ,
2737: J. A . Hoffmann et P. Bulet ( 1996 ) .
2738: " Innate immunity : isolation of several cysteine-rich antimicrobial peptides from the blood of a mollusc Mytilus edulis . "
2739: J. Biol .
2740: Chem .
2741: 271 :
2742: 21808 - 21813 .
2743: Chen , H. , J. Brown , J. Morell et C. Huang ( 1988 ) .
2744: " Synthetic magainin analogues with improved antimicrobial activity . "
2745: FEBS Lett .
2746: 236 ( 2 ) :
2747: 462 - 466 .
2748: Cheng , W. ,
2749: C. H . Liu ,
2750: C. H . Tsai et J .
2751: C . Chen ( 2005 ) .
2752: " Molecular cloning and characterization of a pattern recognition molecule , lipopolysaccharide- and beta- 1 , 3- glucan binding protein ( LGBP ) from the white shrimp Litopenaeus vannamei . "
2753: Fish Shellfish Immunol .
2754: 18 :
2755: 297 - 310 .
2756: Chisholm ,
2757: J. R. S . et V. J. Smith ( 1992 ) .
2758: " Antibacterial activity in the haemocytes of the shore crab , Carcinus maenas . "
2759: J. Mar .
2760: Biol .
2761: Assoc .
2762: UK .
2763: 72 :
2764: 529 - 542 .
2765: Choi ,
2766: J. Y . ,
2767: M. M. A . Whitten ,
2768: M. Y . Cho ,
2769: K. Y . Lee ,
2770: M. S . Kim ,
2771: N. A . Ratcliffe et e .
2772: al .
2773: ( 2002 ) .
2774: " Calreticulin enriched as an early-stage encapsulation protein in wax moth Galleria mellonella larvae . "
2775: Dev .
2776: Comp .
2777: Immunol .
2778: 26 :
2779: 335 - 343 .
2780: Chopin , V. , M. Salzet ,
2781: J. L . Baert ,
2782: F . Vandenbulcke ,
2783: P. E . Sautière ,
2784: J. P . Kerckaet et J. Malecha ( 2000 ) .
2785: " Therostatin , a novel clotting factor Xa inhibitor from the Rhynchobdellid leech , Theromyzon tessulatum . "
2786: J. Biol .
2787: Chem .
2788: 275 :
2789: 32701 - 32707 .
2790: Christensen ,
2791: B . , J. Fink ,
2792: R. B . Merrifield et D. Mauzerall ( 1990 ) .
2793: " Antimicrobial defensin peptides form voltage dependent ion-permeable channels in planner lipid bilayer membranes . "
2794: Proc .
2795: Nat .
2796: Acad .
2797: Sci .
2798: USA
2799: 87 :
2800: 210 - 214 .
2801: Cociancich ( 1991 ) .
2802: " DEA Strasbourg . "
2803: Cociancich , S. ,
2804: A . Dupont , G. Hegy , R. Lanot ,
2805: F . Holder ,
2806: C . Hetru ,
2807: J. A . Hoffmann et P. Bulet ( 1994 ) .
2808: " Novel inducible antibacterial peptides from a hemipteran insect , the sapsucking bug Pyrrhocoris apterus . "
2809: Biochem .
2810: J .
2811: 300 :
2812: 567 - 575 .
2813: Combes ,
2814: C . ( 2001 ) .
2815: In Les associés du vivant .
2816: Paris , Ed .
2817: Flammarion .
2818: Corzo , G. ,
2819: E . Villegas ,
2820: F . Gomez-Lagunas ,
2821: L. D . Possani ,
2822: O. S . Belokoneva et T. Nakajima ( 2002 ) .
2823: " Oxyopinins , large amphipathic peptides isolated from the venom of the wolf spider Oxyopes kitabensis with cytolytic properties and positive insecticidal cooperativity with the spider neurotoxins . "
2824: J. Biol .
2825: Chem .
2826: 277 :
2827: 23627 - 23637 .
2828: Cossart , P. et P. Sansonetti ( 2004 ) .
2829: " Bacterial invasion : The paradigms of Enteroinvasive Pathogens . "
2830: Science
2831: 304 :
2832: 242 - 248 .
2833: Coutant ,
2834: M. F . ( 1977 ) .
2835: Contribution a l' étude cytologique et fonctionnelle des hémocytes et des organes hématopoïétiques chez l' oniscoïde Porcellio dilatatus , Brandt .
2836: Thèse , Université de Poitiers .
2837: Cuthbertson ,
2838: B. J . ,
2839: E. E . Büllesbach , J. Fievet ,
2840: E . Bachère et P.S.
2841: Gross ( 2004 ) .
2842: " A new class ( penaeidin class 4 ) of antimicrobial peptides from the Atlantic white schrimp ( Litopenaeus setiferus ) exhibits target specificity and an independent prolin-rich-domain function . "
2843: Biochem .
2844: J. 381 :
2845: 79 - 86 .
2846: Cuthbertson ,
2847: B. J . ,
2848: E. F . Shepard ,
2849: R. W . Chapman et P.S.
2850: Gross ( 2002 ) .
2851: " Diversity of the penaeidin antimicrobial peptide in two shrimp species . "
2852: Immunogenetics
2853: 54 :
2854: 442 - 445 .
2855: D
2856: Decker , H. et E. Jaenicke ( 2004 ) .
2857: " Recent findings on the phenoloxidase activity and antibacterial activity of hemocyanins . "
2858: Dev .
2859: Comp .
2860: Immunol .
2861: 28 :
2862: 673 - 687 .
2863: Decker , H. , M. Ryan ,
2864: E . Jaenicke et N. Terwilliger ( 2001 ) .
2865: " SDS-induced phenoloxidase activity of hemocyanins from Limulus polyphemus , Eurypelma californicum , and Cancer magister . "
2866: J. Biol .
2867: Chem .
2868: 276 :
2869: 17796 - 17799 .
2870: Dedeine ,
2871: F . ,
2872: F . Vavre ,
2873: F . Fleury ,
2874: B . Loppin , M. E. Hochberg et M. Bouletreau ( 2001 ) .
2875: " Removing symbiotic Wolbachia bacteria specifically inhibits oogenesis in a parasitic wasp . "
2876: Proc .
2877: Natl .
2878: Acad .
2879: Sci .
2880: USA
2881: 98 ( 11 ) :
2882: 6247 - 6252 .
2883: Destoumieux ,
2884: D . , P. Bulet ,
2885: D . Loew ,
2886: A . V. Dorsselaer , J. Rodriguez et E. Bachère ( 1997 ) .
2887: " Penaeidins , a new family of antimicrobial peptides isolated from the shrimp Penaeus vannamei ( Decapoda ) . "
2888: J. Biol .
2889: Chem .
2890: 272 ( 45 ) :
2891: 28398 - 28406 .
2892: Destoumieux ,
2893: D . , P. Bulet , J. Strub ,
2894: A . V. Dorsselaer et E. Bachère ( 1999 ) .
2895: " Recombinant expression and range of activity of penaeidins , antimicrobial peptides from penaeid shrimp . "
2896: Eur .
2897: J. Biochem .
2898: 266 :
2899: 335 - 346 .
2900: Destoumieux ,
2901: D . , M. Munoz , P. Bulet et E. Bachère ( 2000 ) .
2902: " Penaedins , a family of antimicrobial peptides from penaeid shrimp ( Crustacea , Decapoda ) . "
2903: Cell .
2904: Mol .
2905: Life Sci .
2906: 57 :
2907: 1260 - 1271 .
2908: Destoumieux ,
2909: D . , M. Munoz ,
2910: C . Cosseau , J. Rodriguez , P. Bulet , M. Comps et E. Bachère ( 2000 ) .
2911: " Penaedins , antimicrobial peptides with chitin-binding activity , are produced and stored in shrimp granulocytes and released after microbial challenge . "
2912: J. Cell Sci .
2913: 113 :
2914: 461 - 469 .
2915: Destoumieux-Garzon ,
2916: D . ,
2917: D . Saulnier , J. Garnier ,
2918: C . Jouffrey , P. Bulet et E. Bachère
2919: ( 2001 ) .
2920: " Antifungal peptides are generated from the C-terminus of shrimp hemocyanin in response to microbial challenge . "
2921: J. Biol .
2922: Chem .
2923: 276 ( 50 ) :
2924: 47070 - 47077 .
2925: Dieguez-Uribeondo , J. et J. Cerenius ( 1998 ) .
2926: " The inhibition of extracellular proteinases from Aphanomyces spp by three different proteinase inhibitors from the crayfish blood . "
2927: Mycol .
2928: Res .
2929: 102 :
2930: 820 - 824 .
2931: Dimarcq , J .
2932: - L . , P. Bulet ,
2933: C . Hetru et J .
2934: A . Hoffmann ( 1998 ) .
2935: " Cystein-rich antimicrobial peptides in invertebrates . "
2936: Biopolymers
2937: 47 :
2938: 465 - 477 .
2939: Doolittle ,
2940: R. F . et M. Riley ( 1990 ) .
2941: " The amino-terminal sequence of lobster fibrinogen reveals common ancestry with vitellogenins . "
2942: Biochem .
2943: Biophys .
2944: Res .
2945: Comm .
2946: 167 :
2947: 16 - 19 .
2948: Duvic ,
2949: B . et K. Söderhäll ( 1990 ) .
2950: " Purification and characterization of a beta- 1 , 3- glucan binding protein from plasma of the crayfish Pacifastacus leniusculus . "
2951: J. Biol .
2952: Chem .
2953: 265 :
2954: 9327 - 9332 .
2955: Duvic ,
2956: B . et K. Söderhäll ( 1992 ) .
2957: " Purification and partial characterization of a beta- 1 - 3 glucan binding protein membrane receptor from blood cells of the crayfish Pacifastacus leniusculus . "
2958: Eur .
2959: J. Biochem .
2960: 207 :
2961: 223 - 228 .
2962: Duvic ,
2963: B . et K. Söderhäll ( 1993 ) .
2964: " Beta- 1 - 3- glucan binding proteins from plasma of the freshwater crayfish Astacus astacus and Procambarus clarkii . "
2965: J. Crust .
2966: Biol .
2967: 13 :
2968: 403 - 408 .
2969: E
2970: Ehret-Sabatier , L. ,
2971: D . Loew , M. Goyffon , P. Fehlbaum ,
2972: J. A . Hoffmann ,
2973: A . Van .
2974: Dorsselaer et P. Bulet ( 1996 ) .
2975: " Characterization of novel cystein-rich antimicrobial peptides from scorpion blood . "
2976: J. Biol .
2977: Chem .
2978: 271 ( 47 ) :
2979: 29537 - 29544 .
2980: Engström , Y. ( 1998 ) .
2981: Insect immune gene regulation .
2982: In Molecular Mecanisms of immune Responses in Insects .
2983: P. T . Brey and D. Hultmark .
2984: London , Chapman Hall :
2985: 211 - 244 .
2986: F
2987: Fehlbaum , P. ( 1996 ) .
2988: " Structure-activity analysis of thanatin , a 21- residue inducible insect defense peptide with sequence homology to frog skin antimicrobial peptides . "
2989: Proc .
2990: Nat .
2991: Acad .
2992: Sci .
2993: USA
2994: 93 :
2995: 1221 - 1225 .
2996: Feinberg ,
2997: A. P . et B. Volgelstein ( 1983 ) .
2998: " A technique for radiolabeling DNA restriction endonuclease fragments to high specific activity . "
2999: Anal .
3000: Biochem .
3001: 132 :
3002: 6 - 13 .
3003: Felix ,
3004: C . ( 2004 ) .
3005: Etude moléculaire de la bactérie intracellulaire féminisante Wolbachia chez Armadillidium vulgare ( crustacé isopode terrestre ) .
3006: Thèse , Université de Poitiers .
3007: Felix ,
3008: C . , P. Grève ,
3009: C . Braquart-Varnier , H. Braig et G. Martin ( Soumis ) .
3010: " Characterization and transcriptional analysis of two gene clusters for a type IV secretion machinery in the feminizing intracellular symbiont Wolbachia . "
3011: J. Bacteriol .
3012: 187
3013: Fischer , G. ,
3014: B . Wittmann-Liebold , K. Lang , T. Kiefhaber et F. X. Schmid ( 1989 ) .
3015: " Cyclophilin and peptidyl-propyl cis / trans isomerase are probably identical proteins . "
3016: Nature
3017: 327 ( 6232 ) :
3018: 351 - 352 .
3019: Fogaça ,
3020: A. C . , P .
3021: I . da Siva ,
3022: M. T. M . Miranda ,
3023: A. G . Bianchi ,
3024: A . Miranda et P .
3025: E. M . Ribolla ( 1999 ) .
3026: " Antimicrobial activity of a bovine hemoglobin fragment in the tick Bophilus microplus . "
3027: J. Biol .
3028: Chem .
3029: 274 ( 36 ) :
3030: 25330 - 25334 .
3031: Fuller ,
3032: G. M . et R .
3033: F . Doolittle ( 1971a ) .
3034: " Studies of invertebrate fibrinogen . II . Transformation of lobster fibrinogen into fibrin . "
3035: Biochem .
3036: 10 :
3037: 1311 - 1315 .
3038: Fuller ,
3039: G. M . et R .
3040: F . Doolittle ( 1971b ) .
3041: " Studies of invertebrate fibrinogen . I. Purification and characterization f fibrinogen from the spiny lobster . "
3042: Biochem .
3043: 10 :
3044: 1305 - 1311 .
3045: G
3046: Galat ,
3047: A . ( 1993 ) .
3048: " Peptidylproline cis / trans isomerases : immunophilins . "
3049: Eur .
3050: J. Biochem .
3051: 216 ( 3 ) :
3052: 689 - 707 .
3053: Ganz , T. ( 2003 ) .
3054: " Defensins : antimicrobial peptides of innate immunity . "
3055: Nature Rev .
3056: Immunol .
3057: 3 :
3058: 710 - 720 .
3059: Ganz , T. et R. I. Lehrer ( 1997 ) .
3060: " Antimicrobial peptides of leukocytes . "
3061: Curr .
3062: op .
3063: hematol .
3064: 4 : 53 - 58 .
3065: Gargioni , R. et M. A. Barracco ( 1998 ) .
3066: " Hemocytes of the Palaemonids Macrobrachium rosenbergii and M. acanthurus and of the Penaeid Penaeus paulensis . "
3067: J. Morphol .
3068: 236 :
3069: 209
3070: 221 .
3071: Ghiretti-Magaldi ,
3072: A . ,
3073: C . Milanese et G. Tognon ( 1977 ) .
3074: " Hematopoïesis in crustacean decapoda : origin and evolution of hemocytes and cyanocytes of Carcinus maenas . "
3075: Cell Differ .
3076: 6 :
3077: 167 - 187 .
3078: Gillespie ,
3079: J. P . ,
3080: M. R . Kanost et T. Trenczek ( 1997 ) .
3081: " Biologic mediators of insect immunity . "
3082: Annu .
3083: Rev .
3084: Entomol .
3085: 42 :
3086: 611 - 643 .
3087: Gollas-Galvan , T. ,
3088: R. R . Sotelo-Mundo , G. Yepiz-Plascencia ,
3089: C . Vargas-Requena et F. Vargas-Albores ( 2003 ) .
3090: " Purification and characterization of alpha 2 -macroglobulin from the white shrimp ( Penaeus vannamei ) . "
3091: Comp .
3092: Biochem .
3093: Physiol .
3094: [ C ]
3095: 134 :
3096: 431 - 438 .
3097: Golsteyn ,
3098: R. M . , M. Arpin ,
3099: E . Friederich et D. Louvard ( 2000 ) .
3100: " Les proteines du cytosquelette d' actine : bien placées pour la motilité . "
3101: M / S
3102: 16 :
3103: 722 - 731 .
3104: Gorvel ,
3105: J. P . et E. Moreno ( 2002 ) .
3106: " Brucella intracellular life : from invasin to intracellular replication . "
3107: Vet .
3108: Microbiol .
3109: 90 :
3110: 281 - 297 .
3111: Gouin ,
3112: E . ,
3113: M. D . Welch et P. Cossart ( 2005 ) .
3114: " Actin-based motility of intracellular pathogens . "
3115: Curr .
3116: Opin .
3117: Microbiol .
3118: 8 : 35 - 45 .
3119: Gross ,
3120: P. S . ,
3121: T. C . Bartlett ,
3122: C. L . Browdy ,
3123: R. W . Chapman et G. W. Warr ( 2001 ) .
3124: " Immune gene discovery discovery by expressed sequence tag analysis of hemocytes and hepatopancreas in the pacific white shrimp , Litopenaeus vannamei , and the atlantic white shrimp , Litopenaeus setiferus . "
3125: Dev .
3126: Comp .
3127: Immunol .
3128: 25 :
3129: 565 - 577 .
3130: Guo ,
3131: Y. W . ,
3132: T. Y . Chang ,
3133: K. T . Lin ,
3134: H. W . Liu ,
3135: K. C . Shih et S. H. Cheng ( 2001 ) .
3136: " Cloning and functional expression of the mucrosobin protein , a beta-fibrinogenase of Trimeresurus mucrosquamatus ( Taiwan Habu ) . "
3137: Prot .
3138: Express Purif .
3139: 23 :
3140: 483 - 490 .
3141: H
3142: Hall , M. ,
3143: M. C . V. Heusden et K. Söderhäll ( 1995 ) .
3144: " Identification of the major lipoproteins in crayfish hemolymph as proteins involved in immune recognition and clotting . "
3145: Biochem .
3146: Biophys .
3147: Res .
3148: Comm .
3149: 216 ( 3 ) :
3150: 939 - 946 .
3151: Hall , M. et K. Söderhäll ( 1994 ) .
3152: " Crayfish alpha- 2- macroglobulin as a substrate for transglutaminases . "
3153: Comp .
3154: Biochem .
3155: Physiol .
3156: [ B ]
3157: 108 :
3158: 65 - 72 .
3159: Hall , M. , R. Wang ,
3160: R. v . Antwerpen , L. Sottrup-Jensen et K. Söderhäll ( 1999 ) .
3161: " The crayfish plasma clotting protein : a vitellogenin-related protein responsible for clot formation in crustacean blood . "
3162: Proc .
3163: Nat .
3164: Acad .
3165: Sci .
3166: USA
3167: 96 :
3168: 1965 - 1970 .
3169: Hara , S. et M. Yamakawa ( 1995 ) .
3170: " A novel antibacterial peptide family isolated from the silkworm , Bombyx mori . "
3171: Biochem .
3172: J .
3173: 310 :
3174: 651 - 656 .
3175: Hergennahn ,
3176: H. G . , M. Hall et K. Söderhäll ( 1988 ) .
3177: " Purification and characterization of an alpha 2 -macroglobulin-like proteinase inhibitor from plasma of the crayfish Pacifastacus leniusculus . "
3178: Biochem .
3179: J. 255 :
3180: 801 - 806 .
3181: Hertig , M. et S .
3182: B . Wolbach ( 1924 ) .
3183: " Studies on Rickettsia-like micro-organisms in insects . "
3184: J. Med .
3185: Res .
3186: 44 :
3187: 329 - 374 .
3188: Hétru ,
3189: C . , P. Bulet , S. Cociancich ,
3190: J. L . Dimarcq ,
3191: D . Hoffmann et J .
3192: A . Hoffmann
3193: ( 1994 ) .
3194: In Phylogenic Perspectives in Immunity :
3195: The insect Host Defense .
3196: J. A . Hoffmann ,
3197: C .
3198: A . Janeway and J. S. Natori , CRC Press , Boca Raton , FL :
3199: 43 - 66 .
3200: Hétru ,
3201: C . ,
3202: D . Hoffmann et P. Bulet ( 1998 ) .
3203: Antimicrobial peptides from insects .
3204: In Molecular mechanisms in immune responses in insects .
3205: P. Brey and D. Hultmark , Chapman Hall .
3206: Hétru ,
3207: C . , L. Troxler et J .
3208: A . Hoffmann ( 2003 ) .
3209: " Drosophila melanogaster antimicrobial defense . "
3210: J. Inf .
3211: Diseases
3212: 187 ( suppl 2 ) :
3213: 327 - 334 .
3214: Hoebe , K. ,
3215: E . Jansen et B. Beutler ( 2004 ) .
3216: " The interface between innate and adaptative immunity . "
3217: Nat .
3218: Immunol .
3219: 5 :
3220: 971 - 974 .
3221: Hoffmann ,
3222: J. A . et C. Hétru ( 1992 ) .
3223: " Insect defensins : inducible antibacterial peptides . "
3224: Immunol .
3225: Today
3226: 13 :
3227: 411 - 415 .
3228: Hoffmann ,
3229: J. A . et J. M. Reichhart ( 1997 ) .
3230: " Drosophila immunity . "
3231: Trends Cell Biol .
3232: 7 :
3233: 309 - 316 .
3234: Holmblad , T. et K. Söderhäll ( 1997 ) .
3235: " Cell adhesion molecules and antioxidative enzymes in a crustacean , possible role in immunity . "
3236: Aquaculture
3237: 172 :
3238: 111 - 123 .
3239: Hong ,
3240: R. W . , M. Shchepetov ,
3241: J. N . Weiser et P. H. Axelsen ( 2003 ) .
3242: " Transcriptional profile of the Escherichia coli response to the antimicrobial insect peptide cecropin A. "
3243: Antimicrob .
3244: Agents .
3245: Chemother .
3246: 47 :
3247: 1 - 6 .
3248: Hose ,
3249: J. E . et G. G. Martin ( 1989 ) .
3250: " Defense functions of granulocytes in the Ridgeback prawn Sicyonia ingentis . "
3251: J. Invert .
3252: Pathol .
3253: 53 :
3254: 335 - 346 .
3255: Hose ,
3256: J. E . ,
3257: G. G . Martin et A. S. Gerard ( 1990 ) .
3258: " A decapod classification scheme integrating morphology , cytochemistry , and function . "
3259: Biol .
3260: Bull .
3261: 178 :
3262: 33 - 45 .
3263: Huang , T .
3264: - S . , H. Wang ,
3265: S. Y . Lee ,
3266: M. W . Johansson , K. Söderhäll et L. Cerenius ( 2000 ) .
3267: " A cell adhesion protein from the crayfish Pacifastacus leniusculus , a serine proteinase homologue similar to Drosophila Masquerade . "
3268: J. Biol .
3269: Chem .
3270: 275 ( 14 ) :
3271: 9996 - 10001 .
3272: Hultmark ,
3273: D . ( 1993 ) .
3274: " Immune reaction in Drosophila and other insects : a model for innate immunity . "
3275: Trends Genet .
3276: 9 :
3277: 178 - 183 .
3278: Hultmark ,
3279: D . ( 1996 ) .
3280: " Insect lysozymes . "
3281: Exp .
3282: Suppl .
3283: 75 :
3284: 87 - 102 .
3285: Hultmark ,
3286: D . ,
3287: A . Engstrom , K. Andersson , H. Steiner , H. Bennich et H. G. Boman
3288: ( 1983 ) .
3289: " Insect immunity . Attacins , a family of antibacterial proteins from Hyalophora cecropia . "
3290: EMBO J .
3291: 2 ( 4 ) :
3292: 571 - 576 .
3293: Hurst ,
3294: G. D . ,
3295: F. M . Jiggins ,
3296: J. H. G . von der Schulenberg ,
3297: D . Bertrand ,
3298: S. A . West ,
3299: I. I. Goriacheva ,
3300: I. A . Zakharov ,
3301: J. H . Werren , R. Stouthamer et M. E. N. Majerus ( 1999 ) .
3302: " Male killing Wolbachia in two species of insect . "
3303: Proc .
3304: R. Soc .
3305: Lond .
3306: B .
3307: 266 :
3308: 735 - 740 .
3309: I
3310: Iijima , R. , S. Kurata et S. Natori ( 1993 ) .
3311: " Purification , characterization , and cDNA cloning of an antifungal protein from the hemolymph of Sarcophaga peregrina ( flesh fly ) larvae . "
3312: J. Biol .
3313: Chem .
3314: 268 :
3315: 12055 - 12061 .
3316: Inamori , K .
3317: I . , S. Ariki et S. I. Kawabata ( 2004 ) .
3318: " A Toll-receptor in horseshoe crab . "
3319: Immunol .
3320: Rev .
3321: 198 :
3322: 106 - 115 .
3323: Ivanov , V. ,
3324: A. A . Karelin ,
3325: M. M . Phippova , I. Nazimov et V. Pletnev ( 1997 ) .
3326: " Hemoglobin as a source of endogenous bioactive peptides : the concept of tissue-specific pepdide pool . "
3327: Biopolymers
3328: 43 ( 2 ) :
3329: 171 - 188 .
3330: Iwanaga , S. ( 2002 ) .
3331: " The molecular basis of innate immunity in the horseshoe crab . "
3332: Curr .
3333: Op .
3334: Immunol .
3335: 14 :
3336: 87 - 95 .
3337: Iwanaga , S. et S. I. Kawabata ( 1998 ) .
3338: " Evolution and phylogeny of defense molecules associated with innate immunity in horseshoe crab . "
3339: Frontiers Bioscience
3340: 3 :
3341: 973 - 984 .
3342: J
3343: Jaenicke ,
3344: E . et H. Decker ( 2003 ) .
3345: " Tyrosinases from crustacean form hexamers . "
3346: Biochem .
3347: J .
3348: 371 :
3349: 515 - 523 .
3350: Jaenicke ,
3351: E . , R. Föll et H. Decker ( 1999 ) .
3352: " Spider hemocyanin binds ecdysone and 20 -OHedysone . "
3353: J. Biol .
3354: Chem .
3355: 274 :
3356: 34267 - 34271 .
3357: Jaquinod , M. , N. Potier , K. Klarskov ,
3358: J. M . Reymann , O. Sorokine , S. Kieffer , P. Barth ,
3359: V. Andriantomanga ,
3360: J. F . Biellmann et A. Van .
3361: Dorsselaer ( 1993 ) .
3362: " Sequence of pig lens aldose reductase and electrospray mass spectrometry of non-covalent and covalent complexes . "
3363: Eur .
3364: J. Biochem .
3365: 218 :
3366: 893 - 903 .
3367: Jeyaprakash ,
3368: A . et M. A. Hoy ( 2000 ) .
3369: " Long PCR improves Wolbachia DNA amplification : wsp sequences found in 76 % of sixty-three arthropod species . "
3370: Insect Mol .
3371: Biol .
3372: 9 ( 4 ) :
3373: 393
3374: 405 .
3375: Jiggins ,
3376: F. M . ,
3377: G. D . Hurst et M. E. N. Majerus ( 2000 ) .
3378: " Sex ratio-distorting Wolbachia causes sex-role reversal in its butterfly host . "
3379: Proc .
3380: R. Soc .
3381: Lond .
3382: B . Biol .
3383: Sci .
3384: 267 :
3385: 69 - 73 .
3386: Johansson ,
3387: M. W . ( 1999 ) .
3388: " Cell adhesion molecules in invertebrate immunity . "
3389: Dev .
3390: Comp .
3391: Immunol .
3392: 23 :
3393: 303 - 315 .
3394: Johansson ,
3395: M. W . , T. Holmblad , P .
3396: - O . Thörnqvist , M. Cammarata , N. Parrinello et K. Söderhäll ( 1999 ) .
3397: " A cell-surface superoxide dimutase is a binding protein for peroxinectin , a cell-adhesive peroxidase in crayfish . "
3398: J. Cell Sci .
3399: 112 :
3400: 917 - 925 .
3401: Johansson ,
3402: M. W . , P. Keyser et K. Söderhäll ( 1994 ) .
3403: " Purification and cDNA cloning of a four-domain Kazal proteinase inhibitor from crayfish blood cells . "
3404: Eur .
3405: J. Biochem .
3406: 233 :
3407: 389
3408: 394 .
3409: Johansson ,
3410: M. W . , P. Keyser , K. Sritunyalucksana et K. Söderhäll ( 2000 ) .
3411: " Crustacean haemocytes and haematopoiesis . "
3412: Aquaculture
3413: 191 :
3414: 45 - 52 .
3415: Johansson ,
3416: M. W . , M. Lind , T. Holmblad ,
3417: P. O . Thörnqvist et K. Söderhäll ( 1995 ) .
3418: " Peroxinectin , a novel cell adhesion protein from crayfish blood . "
3419: Biochem .
3420: Biophys .
3421: Res .
3422: Comm .
3423: 216 :
3424: 1079 - 1087 .
3425: Johansson ,
3426: M. W . et K. Söderhäll ( 1985 ) .
3427: " Exocytosis of the prophenoloxidase activating system from crayfish haemocytes . "
3428: J. Comp .
3429: Physiol .
3430: 156 :
3431: 175 - 181 .
3432: Johansson ,
3433: M. W . et K. Söderhäll ( 1988 ) .
3434: " Isolation and purification of a cell adhesion factor from crayfish blood cells . "
3435: J. Cell Biol .
3436: 106 :
3437: 1795 - 1803 .
3438: Johansson ,
3439: M. W . et K. Söderhäll ( 1989 ) .
3440: " Cellular immunity in crustaceans and the ProPO system . "
3441: Parasitol .
3442: Today
3443: 5 :
3444: 481 - 484 .
3445: Johnson ,
3446: P. T . ( 1980 ) .
3447: In Histology of the blue crab , Callactinectes sapidus :
3448: a model for the Decapoda .
3449: New York , Praeger Scientific .
3450: Juchault , P. ( 1966 ) .
3451: Contribution à l' étude de la différentiation sexuelle mâle chez les crustacés isopodes .
3452: Thèse , Université de Poitiers .
3453: Juchault , P. , M. Frelon ,
3454: D . Bouchon et T. Rigaud ( 1994 ) .
3455: " New evidence for feminizing bacteria in terrestrial isopods : evolutionary implications . "
3456: C.R. Acad .
3457: Sci .
3458: Paris .
3459: 317 :
3460: 225
3461: 230 .
3462: Juchault , P. ,
3463: J. J . Legrand et G. Martin ( 1974 ) .
3464: " Action interspécifique du facteur épigénétique féminisant responsable de la thélygénie et de l' intersexualité du crustacé Armadillidium vulgare ( Isopode oniscoïde ) . "
3465: Ann .
3466: Embryo .
3467: Morpho .
3468: 7 ( 3 ) :
3469: 265 - 276 .
3470: Jung , Y. ,
3471: B . Park ,
3472: D . Lee , Y. Hahn , J. Chung ,
3473: D . Man , H. Moon ,
3474: B . Lee et Y. Lee ( 1996 ) .
3475: " Biochemical and molecular characterization of an antifungal protein from Tenebrio molitor larvae . "
3476: Mol .
3477: Cell .
3478: 5 :
3479: 287 - 292 .
3480: K
3481: Kang ,
3482: C . , J. Wang , X. Zhao , X. Yang , H. Shao et J. Xiang ( 2004 ) .
3483: " Molecular cloning and expression analysis of Ch-penaeidin , an antibacterial peptide from the Chinese shrimp , Fenneropenaeus chinensis . "
3484: Fish Shellfish Immunol .
3485: 16 :
3486: 513 - 525 .
3487: Katsu , T. , S. Nakao et S. Iwanaga ( 1993 ) .
3488: " Mode of action of an antimicrobial peptide , tachyplesin I , on biomembranes . "
3489: Biol .
3490: Pharm .
3491: Bull .
3492: 16 ( 2 ) :
3493: 178 - 181 .
3494: Kawabata , S. , T. Osaki et S. Iwanaga ( 2003 ) .
3495: Innate immunity in horseshoe crabs .
3496: In Infectious disease :
3497: Innate Immunity .
3498: R. A . Ezekowitz and J .
3499: A . Hoffmann .
3500: Totowa , NJ , Humana Press .
3501: Kawabata , S .
3502: I . et R. Tsuda ( 2002 ) .
3503: " Molecular basis of non self recognition by the horseshoe crab tachylectins . "
3504: Biochem .
3505: Biophys .
3506: Acta .
3507: 1572 :
3508: 414 - 421 .
3509: Kellenberger ,
3510: C . ,
3511: C . Bourdier , I. Bermudez , J. Bieth ,
3512: B . Luu et H. Hietter ( 1995 ) .
3513: " Serine protease inhibition by insect peptides containing a cysteine knot and a triple-stranded betasheet . "
3514: J. Biol .
3515: Chem .
3516: 270 :
3517: 25514 - 25519 .
3518: Khoo , L. ,
3519: D. W . Robinette et E. J. Noga ( 1999 ) .
3520: " Callinectin , an antibacterial peptide from blue crab , Callinectes sapidus , hemocytes . "
3521: Mar .
3522: Biotechnol .
3523: 1 : 44 - 51 .
3524: Kobayashi , M. ,
3525: M. W . Johansson et K. Söderhäll ( 1990 ) .
3526: " The 76 kDa cell-adhesion factor from crayfish haemocytes promotes encapsulation in vitro . "
3527: Cell Tissue Res .
3528: 260 :
3529: 13 - 18 .
3530: Koch , G. , M. Smith ,
3531: D . Macer , P. Webster et R. Mortara ( 1986 ) .
3532: " Endoplasmic reticulum contains a common , abundant calcium-binding glycoprotein endoplasmin . "
3533: J. Cell Sci .
3534: 86 :
3535: 217 - 232 .
3536: Komastu , M. et S. Ando ( 1998 ) .
3537: " A very high density lipoprotein with clotting ability from hemolymph of sand crayfish , Ibacus ciliatus . "
3538: Biosci .
3539: Biotechnol .
3540: Biochem .
3541: 62 :
3542: 459 - 463 .
3543: Kopacek , P. , M. Hall et K. Söderhäll ( 1993a ) .
3544: " Characterization of a clotting protein , isolated from plasma of the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus . "
3545: Eur .
3546: J. Biochem
3547: 213 ( 1 ) :
3548: 591 - 597 .
3549: Kopacek , P. , M. Hall et K. Söderhäll ( 1993b ) .
3550: " Isolation and characterization of a hemagglutinin with affinity for lipopolysaccharides from plasma of the crayfish Pacifastacus leniusculus . "
3551: Dev .
3552: Comp .
3553: Immunol .
3554: 17 ( 5 ) :
3555: 407 - 418 .
3556: Kragol , G. , S. Lovas , G. Varadi ,
3557: B. A . Condie , R. Hoffmann et L. Otvos ( 2001 ) .
3558: " The antibacterial peptide pyrrhocoricin inhibits the ATPase actions of DnaK and prevents chaperone-assisted protein folding . "
3559: Biochem .
3560: 40 :
3561: 3016 - 3026 .
3562: Krishnakumari , V .
3563: et R. Nagaraj ( 1997 ) .
3564: " Antimicrobial and hemolytic activities of crabrolin , a 13- residue peptide from the venom of the European hornet , Vespa crabo , and its analogs . "
3565: J. Pept .
3566: Res .
3567: 50 :
3568: 88 - 93 .
3569: Kuhn-Nentwig , L. , J. Muller , J. Schaller ,
3570: A . Walz , M. Dathe et W. Nentwig ( 2002 ) .
3571: " Cupiennin 1 , a new family of highly basic antimicrobial peptides in the venom of the spider Cupiennius salei ( Ctenidae ) . "
3572: J. Biol .
3573: Chem .
3574: 277 :
3575: 11208 - 11216 .
3576: L
3577: Laemmli ,
3578: U. K . ( 1970 ) .
3579: " Cleavage of the structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4 . "
3580: Nature
3581: 227 ( 259 ) :
3582: 680 - 685 .
3583: Lamberty , M. ,
3584: D . Zachary , R. Lanot ,
3585: C . Bordereau ,
3586: A . Robert ,
3587: J. A . Hoffmann et P. Bulet ( 2001 ) .
3588: " Constitutive expression of a cystein-rich antifungal and linear antibacterial peptide in a termite insect . "
3589: J. Biol .
3590: Chem .
3591: 276 :
3592: 4085 - 4092 .
3593: Langworthy ,
3594: N. G . ,
3595: A . Renz , U. Mackenstedt , K. Henkle-Duhrsen ,
3596: M. B . de Bronsvoort ,
3597: V. N . Tanya ,
3598: M. J . Donnelly et A. J. Trees ( 2000 ) .
3599: " Macrofilaricidal activity of tetracycline against the filarial nematode Onchocerca ochengi : elimination of Wolbachia precedes worm death and suggests a dependent relationship . "
3600: Proc .
3601: R. Soc .
3602: Lond .
3603: B . Biol .
3604: Sci .
3605: 267 :
3606: 10631069 .
3607: Lanz , H. , V. Tzutzumi et H. Arechiga ( 1993 ) .
3608: " Morphological and biochemical characterization of Procambarus clarkii blood cells . "
3609: Dev .
3610: Comp .
3611: Immunol .
3612: 17 :
3613: 389 - 397 .
3614: Lavine ,
3615: M. D . et M. R. Strand ( 2002 ) .
3616: " Insect hemocytes and their role in immunity . "
3617: Insect Biochem .
3618: Mol .
3619: Biol .
3620: 32 ( 10 ) :
3621: 1295 - 1309 .
3622: Lee , S. ,
3623: B . Lee et K. Söderhäll ( 2003 ) .
3624: " Processing of an antibacterial peptide from hemocyanin of the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus . "
3625: J. Biol .
3626: Chem .
3627: 278 ( 10 ) :
3628: 7927 - 7933 .
3629: Lee , S. ,
3630: B . Lee et K. Söderhäll ( 2004 ) .
3631: " Processing of crayfish hemocyanin subunits into phenoloxidase . "
3632: Biochem .
3633: Biophys .
3634: Res .
3635: Comm .
3636: 322 :
3637: 490 - 496 .
3638: Lee , S. , H. Moon , S. Kurata , S. Natori et B. Lee ( 1995 ) .
3639: " Purification and cDNA cloning of an antifungal protein from the hemolymph of Holotrichia diomphalia larvae . "
3640: Biol .
3641: Pharm .
3642: Bull .
3643: 18 :
3644: 1049 - 1052 .
3645: Lee ,
3646: S.Y . et D.H. Kim ,
3647: J.Y . Suh ,
3648: J.H . Chung ,
3649: B.L . Lee , Y. Lee et B.S. Choi ( 1999 ) .
3650: " Structural characteristics of tenecin 3 , an insect antifungal protein . "
3651: Biochem .
3652: Mol .
3653: Biol .
3654: Int .
3655: 47 ( 3 ) :
3656: 369 - 376 .
3657: Lee ,
3658: S. Y . et K. Söderhäll ( 2001 ) .
3659: " Characterization of a pattern recognition protein , a masquerade-like protein , in the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus . "
3660: J. Immunol .
3661: 166 ( 12 ) :
3662: 7319 - 7326 .
3663: Lee ,
3664: S. Y . et K. Söderhäll ( 2002 ) .
3665: " Early events in crustacean innate immunity . "
3666: Fish Shellfish Immunol .
3667: 12 :
3668: 421 - 437 .
3669: Lee ,
3670: S. Y . , R. Wang et K. Söderhäll ( 2000 ) .
3671: " A lipopolysaccharide and beta- 1 - 3- glucan binding protein from hemocytes of the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus : purification , caracterization and cDNA cloning . "
3672: J. Biol .
3673: Chem .
3674: 275 :
3675: 1337 - 1343 .
3676: Lefebvre ,
3677: C . ,
3678: A . Tasiemski et M. Salzet ( 2000 ) .
3679: " Peptides opioïdes , substances opiacées et réponse immunitaire . "
3680: M / S
3681: 16 :
3682: 235 - 242 .
3683: Legrand ,
3684: J. J . et P. Juchault ( 1970 ) .
3685: " Experimental modification of sex-ratio in terrestrial crustacea isopoda : induction of thelygeny in Armadillidium vulgare Latr . "
3686: C.R. Acad .
3687: Sci .
3688: Hebd .
3689: Seances Acad .
3690: Sci .
3691: D
3692: 207 :
3693: 706 - 708 .
3694: Legrand ,
3695: J. J . et P. Juchault ( 1986 ) .
3696: " Rôle des bactéries symbiotiques dans l' intersexualité , la monogénie et la spéciation chez les crustacés oniscoïdes . "
3697: Bull .
3698: Zool .
3699: 53 .
3700: Lehrer , R .
3701: I . ( 2004 ) .
3702: " Primate defensins . "
3703: Nature Rev .
3704: Immunol .
3705: 2 :
3706: 727 - 732 .
3707: Levashina ,
3708: E. A . , S. Ohresser , P. Bulet ,
3709: J. M . Reichhart ,
3710: C . Hetru et J .
3711: A . Hoffmann
3712: ( 1995 ) .
3713: " Metchnikowin , a novel immune-inductible proline-rich proline-rich peptide from Drosophila with antibacterial and antifungal properties . "
3714: J. Biochem .
3715: 233 ( 2 ) :
3716: 694 - 700 .
3717: Liang , Z. et K. Söderhäll ( 1995 ) .
3718: " cDNA cloning of a serpin from crayfish blood cells . "
3719: Comp .
3720: Biochem .
3721: Physiol .
3722: [ B ]
3723: 112 :
3724: 385 - 391 .
3725: Liang , Z. , L. Sottrup-Jensen ,
3726: A . Aspan , M. Hall et K. Söderhäll ( 1997 ) .
3727: " Pacifastin , a novel 155 kDa heterodimeric proteinase inhibitor containing a unique transferrin domain . "
3728: Proc .
3729: Nat .
3730: Acad .
3731: Sci .
3732: USA
3733: 94 :
3734: 6682 - 6687 .
3735: Liu ,
3736: C. H . , W. Cheng et J .
3737: C . Chen ( 2005 ) .
3738: " The peroxinectin of white schrimp Litopenaeus vannamei is synthesised in the semi-granular and granular cells , and its transcription is upregulated with Vibrio alginolyticus infection . "
3739: Fish Shellfish Immunol .
3740: 18 :
3741: 431 - 444 .
3742: Liu , J. ,
3743: J. D . Farmer ,
3744: W. S . Lane , J. Friedman , I. Weissman et S. L. Schreiber ( 1991 ) .
3745: " Calcineurin is a common target of cyclophilin-cyclosporin A and FKBP-FK506 complexes . "
3746: Cell
3747: 66 ( 4 ) :
3748: 807 - 815 .
3749: Lodge , R. et A. Descoteaux ( 2005 ) .
3750: " Modulation of phagolysosome biogenesis by the lipophosphoglycan of Leishmania . "
3751: Clinical .
3752: Immunol .
3753: 114 :
3754: 256 - 265 .
3755: Loisel ,
3756: T. P . , R. Boujemaa ,
3757: D . Pantaloni et M. F. Carlier ( 1997 ) .
3758: " Reconstitution of actinbased motility of Listeria and Shigella using pure proteins . "
3759: Nature
3760: 9 :
3761: 244 - 249 .
3762: Lorenzini ,
3763: D. M . , P .
3764: I . DaSilva ,
3765: A. C . Fogaça , P. Bulet et S. Daffre ( 2003 ) .
3766: " Acanthoscurrin : a novel glycine-rich antimicrobial peptide constituvely expressed in the hemocytes of the spider Acanthoscurria gomesiana . "
3767: Dev .
3768: Comp .
3769: Immunol .
3770: 27 ( 9 ) :
3771: 781 - 791 .
3772: Lowenberger ,
3773: C . , M. Charlet , J. Vizioli , S. Kamal ,
3774: A . Richman ,
3775: B . Christensen et P. Bulet ( 1999 ) .
3776: " Antimicrobial activity spectrum , cDNA cloning and mRNA expression of a newly isolated member of the cecropin family from the mosquito vector Aedes aegypti . "
3777: J. Biol .
3778: Chem .
3779: 274 ( 29 ) :
3780: 20092 - 20097 .
3781: Luschen , W. ,
3782: F . Buck ,
3783: A . Willig et P. P. Jaros ( 1991 ) .
3784: " Isolation , sequence analysis , and physiological properties of enkephalins in the nervous tissue of the shore crab Carcinus maenas L. "
3785: Proc .
3786: Nat .
3787: Acad .
3788: Sci .
3789: USA
3790: 88 ( 19 ) :
3791: 8671 - 8675 .
3792: M
3793: Mackintosh ,
3794: J. A . ,
3795: D. A . Veal ,
3796: A. J . Beattie et A .
3797: A . Gooley ( 1998 ) .
3798: " Isolation from an ant Myrmecia gulosa of two inducible o-glycosylated proline rich antibacterial peptides . "
3799: J. Biol .
3800: Chem .
3801: 273 :
3802: 6139 - 6143 .
3803: Malhotra , R. ,
3804: A. C . Willis ,
3805: J. C . Jesenius , J. Jackson et R .
3806: B . Sim ( 1993 ) .
3807: " Structure and homology of the human C 1q receptor . "
3808: Immunol .
3809: 78 :
3810: 341 - 348 .
3811: Marquez ,
3812: M. R. F . et M. A. Barracco ( 2000 ) .
3813: " Lectin , as non-self-recognition fators in crustacean . "
3814: Aquaculture
3815: 191 :
3816: 23 - 44 .
3817: Martin , G. ( 1981 ) .
3818: Contribution à l' étude cytologique et fonctionnelle des systèmes de neurosécrétion des crustacés isopodes .
3819: Thèse , Université de Poitiers .
3820: Martin , G. et M. Dubois ( 1981 ) .
3821: " A somatostatin antigen in the nervous system of an isopod Porcellio dilatatus Brant . "
3822: Gen .
3823: Comp .
3824: Endocrinol .
3825: 45 :
3826: 125 - 130 .
3827: 195
3828: Martin , G. ,
3829: S. G . Gruppe , M. Laulier ,
3830: D . Bouchon , T. Rigaud et P. Juchault ( 1994 ) .
3831: " Evidence for Wolbachia spp. in the estuarine isopod Sphaeroma rugicauda ( crustacea ) : a likely cytoplasmic sex ratio distorter . "
3832: Entocyt .
3833: Cell Res .
3834: 10 :
3835: 115 - 225 .
3836: Martin , G. , P. Juchault et J. J. Legrand ( 1973 ) .
3837: " Mise en évidence d' un micro-organisme intracytoplasmique symbiote de l' oniscoïde Armadillidium vulgare Latr . dont la présence accompagne l' intersexualité ou la féminisation totale des mâles génétiques de la lignée thélygène . "
3838: C. R. Acad .
3839: Sci .
3840: Paris .
3841: 276 :
3842: 2313 - 2316 .
3843: Martin ,
3844: G. G . ,
3845: J. E . Hose , M. Choi , R. Provost , G. Omori , N. McKrell et G. Lam ( 1993 ) .
3846: " Organization of hematopoïetic tissue in the intermolt lobster Homarus americanus . "
3847: J. Morphol .
3848: 216 :
3849: 65 - 78 .
3850: Martin ,
3851: G. G . ,
3852: J. E . Hose et J. J. Kim ( 1987 ) .
3853: " Structure of hematopoïetic nodules in the ridgeback prawn , Sicyonia ingentis : Light and electron microscopic observations . "
3854: J. Morphol .
3855: 192 :
3856: 193 - 204 .
3857: Martin ,
3858: G. G . ,
3859: J. E . Hose , G. Minka et S. Rosenberg ( 1996 ) .
3860: " Clearance of bacteria injected into the hemolymph of the ridgeback prawn , Sicyonia ingentis ( crustacea : decapoda ) : role of hematopoïetic tissue . "
3861: J. Morphol .
3862: 227 :
3863: 227 - 233 .
3864: Martin ,
3865: G. G . , K. Kay ,
3866: D . Poole et C. Poole ( 1998 ) .
3867: " In vitro nodule formation in the Ridgeback prawn Sicyonia ingentis and the american lobster Homarus americanus . "
3868: Invertebr .
3869: Biol .
3870: 117 :
3871: 155 - 168 .
3872: Meister , M. ( 2004 ) .
3873: " Blood cells of Drosophila : cell lineages and role in host defence . "
3874: Curr .
3875: Op .
3876: Immunol .
3877: 16 : 10 - 15 .
3878: Meister , M. ,
3879: B . Lemaître et J .
3880: A . Hoffmann ( 1997 ) .
3881: " Antimicrobial peptide defense in Drosophila . "
3882: Bio .
3883: Essay
3884: 19 ( 11 ) :
3885: 1019 - 1026 .
3886: Melchior , R. ,
3887: J. P . Quigley et P .
3888: B . Armstrong ( 1995 ) .
3889: " Alpha 2 -macroglobulin-mediated clearance of proteases from the plasma of the american horseshoe crab , Limulus polyphemus polyphemus . "
3890: J. Biol .
3891: Chem .
3892: 270 :
3893: 13496 - 13502 .
3894: Michalak , M. ,
3895: R. E . Milner , K. Burns et M. Opas ( 1992 ) .
3896: " Calreticulin . "
3897: Biochem .
3898: J .
3899: 285 :
3900: 681 - 692 .
3901: Mitta , G. ,
3902: F . Vandenbulcke , T. Nöel ,
3903: B . Romestand ,
3904: J. C . Beauvillain , M. Salzet et P. Roch ( 2000a ) .
3905: " Differential distribution and defence involvement of antimicrobial peptides in mussel . "
3906: J. Cell Sci .
3907: 113 :
3908: 2759 - 2769 .
3909: Mitta , G. ,
3910: F . Vandenbulcke et P. Roch ( 2000b ) .
3911: " Original involvement of antimicrobial peptides in mussel innate immunity . "
3912: FEBS Lett .
3913: 486 :
3914: 185 - 190 .
3915: Mitta , G. ,
3916: F . Vanderbulcke ,
3917: F . Hubert et P. Bulet ( 1999 ) .
3918: " Mussel defensins are synthesized and processed in granulocytes then released into the plasma after bacterial challenge . "
3919: J. Cell Sci .
3920: 112 :
3921: 4233 - 4242 .
3922: Miyata , T. ,
3923: F . Tokunaga , T. Yoneya , K. Yoshikawa , S. Iwanaga , M. Niwa , T. Takao et Y. Shimonishi ( 1989 ) .
3924: " Antimicrobial peptides , isolated from horseshoe crab hemocytes , Tachyplesin II , and Polyphemusins I and II : chemical structures and biological activity . "
3925: J. Biochem .
3926: 106 :
3927: 663 - 668 .
3928: Mor ,
3929: A . ,
3930: V. H . Nguyen ,
3931: A . Delfour ,
3932: D . Migliore-Samour et P. Nicolas ( 1991 ) .
3933: " Isolation , amino acid sequence , and synthesis of dermaseptin , a novel antimicrobial peptide of amphibian skin . "
3934: Biochem .
3935: 30 :
3936: 8824 - 8830 .
3937: Moret , Y. , P. Juchault et T. Rigaud ( 2001 ) .
3938: " Wolbachia endosymbiont responsible for cytoplasmic incompatibility in a terrestrial crustacean : effects in natural and foreign hosts . "
3939: Heredity
3940: 86 :
3941: 325 - 332 .
3942: Mori , K. et J .
3943: E . Stewart ( 1978 ) .
3944: " The hemolymph bactericidin of the american lobster ( Homarus americanus ) adsorption and activation . "
3945: J. Fish Res .
3946: Board Canada
3947: 5 :
3948: 1504 - 1507 .
3949: Morisset ,
3950: D . et J. Frère ( 2002 ) .
3951: " Heterologous expression of bacteriocins using the mesentericin Y105 dedicated transport system by Leuconostoc mesenteroides mesenteroides . "
3952: Biochim .
3953: 84 :
3954: 569 - 76 .
3955: Morita , T. , S. Ohtsubo , T. Nakamura , H. Tanaka , S. Iwanaga et K. Ohashi ( 1985 ) .
3956: " Isolation and biological activities of Limulus anticoagulant ( anti-LPS factor ) which interacts with lipopolysaccharides ( LPS ) . "
3957: J. Biochem .
3958: 97 :
3959: 1611 - 1620 .
3960: Munoz , M. ,
3961: F . Vandenbulcke , J. Garnier , Y. Gueguen , P. Bulet ,
3962: D . Saulnier et E. Bachère ( 2004 ) .
3963: " Involvement of penaedins in defense reactions of the shrimp Litopenaeus stylirostris to a pathogenic vibrio . "
3964: Cell .
3965: Mol .
3966: Life Sci .
3967: 61 ( 961 - 972 ) .
3968: Munoz , M. ,
3969: F . Vandenbulke ,
3970: D . Saulnier et E. Bachère ( 2002 ) .
3971: " Expression and distribution of penaeidin antimicrobial peptides are regulated by haemocyte reactions in microbial challenged shrimp . "
3972: Eur .
3973: J. Biochem .
3974: 269 :
3975: 2678 - 2689 .
3976: Muta , T. et S. Iwanaga ( 1996 ) .
3977: " The role of hemolymph coagulation in innate immunity . "
3978: Curr .
3979: Opin .
3980: Immunol .
3981: 8 ( 1 ) :
3982: 41 - 47 .
3983: N
3984: Nagai , T. et S. Kawabata ( 2000 ) .
3985: " A link between blood coagulation and prophenoloxidase activation in arthropod host defense . "
3986: J. Biochem .
3987: Chem .
3988: 275 ( 38 ) :
3989: 29264 - 29267 .
3990: Nagai , T. , T. Osaki et S. Kawabata ( 2001 ) .
3991: " Functional conversion of hemocyanin to phenoloxidase by horseshoe crab antimicrobial peptides . "
3992: J. Biochem .
3993: Chem .
3994: 276 ( 29 ) :
3995: 2716627170 .
3996: Nakhasi ,
3997: H. L . ,
3998: G. P . Pogue ,
3999: R. C . Duncan , M. Joshi ,
4000: C. D . Atreya ,
4001: N.S . Lee et e .
4002: al . ( 1998 ) .
4003: " Implication of calreticulin function in parasite biology . "
4004: Parasitol .
4005: Today
4006: 14 :
4007: 157
4008: 160 .
4009: Nissen-Meyer , J. et I .
4010: F . Nes ( 1997 ) .
4011: " Ribosomally synthesized antimicrobial peptides : their function , structure , biogenesis and mechanism of action . "
4012: Arch .
4013: Microbiol .
4014: 167 :
4015: 67 - 77 .
4016: O
4017: Ogden ,
4018: C. A . ,
4019: A. d . Cathelineau ,
4020: P. R . Hoffmann ,
4021: D . Bratton ,
4022: B . Ghebrehiwet ,
4023: V. A . Fadok et P. M. Henson ( 2001 ) .
4024: " C 1q and mannose binding lectin engagement of cell surface calreticulin and CD91 initiates macropinocytosis and uptake of apoptotic cells . "
4025: J. Exp .
4026: Med .
4027: 194 :
4028: 781 - 795 .
4029: Okuno ,
4030: A . , H. Katayama et H. Nagasawa ( 2000 ) .
4031: " Partial characterization of vitellin and localization of vitellogenin production in the terrestrial isopod , Armadillidium vulgare . "
4032: Comp .
4033: Biochem .
4034: Physiol .
4035: [ B ]
4036: 126 ( 3 ) :
4037: 397 - 407 .
4038: O'Neill ,
4039: S. L . , R. Giordano ,
4040: A. M . Colbert ,
4041: T. L . Karr et H. M. Robertson ( 1992 ) .
4042: " 16S rRNA phylogenetic analysis of the bacterial endosymbionts associated with cytoplasmic incompatibility in insects . "
4043: Proc .
4044: Nat .
4045: Acad .
4046: Sci .
4047: USA
4048: 89 :
4049: 2699 - 2702 .
4050: O'Neill ,
4051: S. L . ,
4052: A. A . Hoffman et J. H. Werren ( 1997 ) .
4053: In Influential passengers :
4054: inherited micro-organisms and arthropod reproduction .
4055: New York , Oxford University Press .
4056: Orivel , J. et A. Dejean ( 2001 ) .
4057: " Comparative effect of the venoms of ants of the genus Pachycondyla ( Hymenoptera Ponerinae ) . "
4058: Toxicon .
4059: 39 ( 2 - 3 ) :
4060: 195 - 201 .
4061: Ouellette ,
4062: A . et E. Selsted ( 1996 ) .
4063: " Paneth cell defensins : endogenous peptide components of intestinal host defense . "
4064: FASEB .
4065: J .
4066: 10 :
4067: 1280 - 1289 .
4068: Oyama , H. ,
4069: A . Tenku , K. Kakita , S. Matzumura , S. Nishida et M. Horino ( 1978 ) .
4070: " Recovery of human C-peptide by acid-ethanol extraction . "
4071: Endocrinol .
4072: Jpn .
4073: 25 ( 5 ) :
4074: 493 - 498 .
4075: P
4076: Park ,
4077: C . ,
4078: C . Park , S. Hong , H. Lee , S. Lee et S. Kim ( 2000 ) .
4079: " Characterization and cDNA cloning of two glycine- and histidine-rich antimicrobial peptides from the roots of shepherd's purse , Capsella bursa-pastoris . "
4080: Plant Mol .
4081: Biol .
4082: 44 :
4083: 187 - 197 .
4084: Paul , R. ,
4085: B . Bergner ,
4086: A . Pfeffer-Seidl , H. Decker , R. Efinger et H. Storz ( 1994 ) .
4087: " Gas transport in the hemolymph of arachnids . Oxygen transport and physiological role of hemocyanin . "
4088: J. Exp .
4089: Biol .
4090: 188 :
4091: 25 - 46 .
4092: Paul , R. et R. Pirow ( 1998 ) .
4093: " The physiological signifiance of respiratory proteins in invertebrates . "
4094: Zool .
4095: 100 :
4096: 319 - 327 .
4097: Persson , M. , L. Cerenius et K. Söderhäll ( 1987 ) .
4098: " The influence of haemocyte number on the resistance of the freshwater crayfish , Pacifastacus leniusculus Dana , to the parasitic fungus Aphanomyces astaci . "
4099: J. Fish Dis .
4100: 10 :
4101: 471 - 477 .
4102: Picaud ,
4103: J. L . et C. Souty ( 1980 ) .
4104: " Démonstration immunohistochimique de la présence la vitellogénine dans le tissu adipeux et l' hépatopancréas du crustacé isopode Oniscoïde Porcellio dilatatus ( Brandt ) . "
4105: C.R. Acad .
4106: Sci .
4107: Paris .
4108: 290 :
4109: 123 - 125 .
4110: Pless ,
4111: D. D . ,
4112: M. B . Aguilar ,
4113: A . Falcon ,
4114: E . Lozano-alvarez et E. P. Heimer de la Cotera
4115: ( 2003 ) .
4116: " Latent phenoloxidase activity and N-terminal amino acid sequence of hemocyanin from Bathynomus giganteus , a primitive crustacean . "
4117: Arch .
4118: Biochem .
4119: Biophys .
4120: 409 ( 402 - 410 ) .
4121: Porat ,
4122: A . , Y. Sagiv et Z. Elazar ( 2000 ) .
4123: " A 56 kDa selenium-binding protein participates in intra-Golgi protein transport . "
4124: J. Biol .
4125: Chem .
4126: 275 ( 19 ) :
4127: 14457 - 14465 .
4128: Powers ,
4129: J. P. S . et R .
4130: E. W . Hancock ( 2003 ) .
4131: " The relationship between peptide structure and antibacterial activity . "
4132: Peptides
4133: 24 :
4134: 1681 - 1691 .
4135: R
4136: Ratanapo , S. et M. Chulavatnatol ( 1990 ) .
4137: " Monodin , a new sialic acid-specific lectin from black tiger prawn ( Penaeus monodon ) . "
4138: Comp .
4139: Biochem .
4140: Physiol .
4141: 97B :
4142: 515 - 520 .
4143: Ratcliffe ,
4144: N. A . ,
4145: A. F . Rowley ,
4146: S. W . Fitzgerald et C. P. Rhodes ( 1985 ) .
4147: " Invertebrate immunity : basis concepts and recent advances . "
4148: Int .
4149: Rev .
4150: Cytol .
4151: 97 :
4152: 183 - 350 .
4153: Rattanachai ,
4154: A . , I. Hirono , T. Ohira , Y. Takahashi et T. Aoki ( 2004 ) .
4155: " Molecular cloning and expression analysis of alpha 2 -macroglobulin in the Kuruma shrimp , Marsupenaeus japonicus . "
4156: Fish Shellfish Immunol .
4157: 16 :
4158: 599 - 611 .
4159: Ravindranath ,
4160: M. H . ,
4161: H. H . Higo ,
4162: E. L . Cooper et J .
4163: C . Paulson ( 1985 ) .
4164: " Purification and characterization of an O-acetylsialic acid specific lectin from a marine crab Cancer antennarius . "
4165: J. Biol .
4166: Chem .
4167: 260 ( 15 ) :
4168: 8850 - 8856 .
4169: Reddy , K .
4170: V. R . ,
4171: R. D . Yedery et C. Aranha ( 2004 ) .
4172: " Antimicrobial peptides : premises and promises . "
4173: Int .
4174: J. Antimicrob .
4175: Agent 24 :
4176: 536 - 547 .
4177: Reynolds ,
4178: E. S . ( 1963 ) .
4179: " The use of lead citrate at high pH as an electron opaque stain in electron microscopy . "
4180: J. Cell .
4181: Biol .
4182: 17 :
4183: 208 - 212 .
4184: Rikihisa , Y. , Y. Zhang et J. Park ( 1994 ) .
4185: " Inhibition of infection of macrophages with Ehrlischia risticii by cytochalasins , monodansylcadaverine , and taxol . "
4186: Inf .
4187: Immun .
4188: 62 ( 11 ) :
4189: 5126 - 5132 .
4190: Robert , J. ( 2003 ) .
4191: " Evolution of heat schock protein and immunity . "
4192: Dev .
4193: Comp .
4194: Immunol .
4195: 27 :
4196: 449 - 464 .
4197: Rodriguez , J. , V. Boulo ,
4198: E . Mialhe et E. Bachère ( 1995 ) .
4199: " Characterization of shrimp haemocytes and plasma components by monoclonal antibodies . "
4200: J. Cell Sci .
4201: 108 :
4202: 1043 - 1050 .
4203: Rojtinnakorn , J. , I. Hirono , T. Itami , Y. Takahashi et T. Aoki ( 2002 ) .
4204: " Gene expression in haemocyte of Kuruma prawn , Penaeus japonicus , in response to infection with WSSV by EST approach . "
4205: Fish Shellfish Immunol .
4206: 13 :
4207: 69 - 83 .
4208: Romo-Figueroa ,
4209: M. G . ,
4210: C . Vargas-Requena ,
4211: R. R . Sotelo-Mundo ,
4212: F . Vargas-Albores , I. Higuera-Ciapara , K. Söderhäll et G. Yepiz-Plascencia ( 2004 ) .
4213: " Molecular cloning of a beta-glucan pattern recognition lipoprotein from the white shrimp Penaeus ( Litopenaeus ) vannamei : correlation between the deduced amino acid sequence and the native protein structure . "
4214: Dev .
4215: Comp .
4216: Immunol .
4217: 28 ( 7 - 8 ) :
4218: 713 - 726 .
4219: Roux ,
4220: M. M . ,
4221: A . Pain ,
4222: K. R . Klimpel et A. K. Dhar ( 2002 ) .
4223: " The lipopolysaccharide and beta- 1 - 3- glucan binding protein gene is up-regulated in white spot virus infected shrimp ( Penaeus stylirostris ) . "
4224: J. Virol .
4225: 76 ( 7140 - 7149 ) .
4226: S
4227: Salzet , M. ( 2001 ) .
4228: " Vertebrate immunity ressembles a mosaic of invertebrate immune responses . "
4229: Trends Immunol .
4230: 22 ( 6 ) :
4231: 285 - 288 .
4232: Salzet , M. , P. Bulet ,
4233: W. M . Weber , W. Clauss , M. Verger-Bocquet et J. Malecha ( 1996 ) .
4234: " Structural characterization of a novel neuropeptide from the central nervous system of the leech Erpobdella octoculata . The leech osmoregulator factor . "
4235: J. Biol .
4236: Chem .
4237: 271 :
4238: 72377243 .
4239: Salzet , M. et A. Tasiemski ( 2001 ) .
4240: " Involvement of pro-enkephalin-derived peptides in immunity . "
4241: Dev .
4242: Comp .
4243: Immunol .
4244: 25 ( 3 ) :
4245: 177 - 185 .
4246: Sambrook , J. ,
4247: E. F . Fritsch et T. Maniatis ( 1989 ) .
4248: In Molecular cloning :
4249: A Laboratory Manual .
4250: C. S . Harbor .
4251: NY , Cold Spring Harbor Laboratory Press .
4252: Sappington ,
4253: T. W . et A .
4254: F . Raikhel ( 1997 ) .
4255: " Molecular characteristics of insect vitellogenins and vitellogenin receptors . "
4256: Insect Biochem .
4257: Mol .
4258: Biol .
4259: 28 ( 5 - 6 ) :
4260: 277 - 300 .
4261: Schnapp ,
4262: D . ,
4263: G. D . Kemp et V. J. Smith ( 1996 ) .
4264: " Purification and characterization of a proline-rich antibacterial peptide , with sequence similarity to bactenecin- 7 , from the haemocytes of the shore crab , Carcinus maenas . "
4265: Eur .
4266: J. Biochem .
4267: 240 :
4268: 532 - 539 .
4269: Seki , N. , T. Muta , T. Oda ,
4270: D . Iwaki , K. Kuma , T. Miyata et S. Iwanaga ( 1994 ) .
4271: " Horseshoe crab
4272: J. Biol .
4273: Chem .
4274: 269 ( 2 ) :
4275: 1370 - 1374 .
4276: Selbach , M. et S. Backert ( 2005 ) .
4277: " Cortactin : an Achilles'heel of the actin cytoskeleton targeted by pathogens . "
4278: Trends Microbiol .
4279: 13 ( 4 ) :
4280: 181 - 189 .
4281: Sellos ,
4282: D . , S. Lemoine et A. V. Wormhoudt ( 1997 ) .
4283: " Molecular cloning of hemocyanin cDNA from Penaeus vannamei ( Crustacea , Decapoda ) : structure , evolution and physiological aspects . "
4284: FEBS Lett .
4285: 407 :
4286: 153 - 158 .
4287: Shai , Y. ( 1999 ) .
4288: " Mechanism of the binding insertion and destabilization of phospholipid bilayer membranes by alpha-helical antimicrobial and cell non-selective membrane-lytic peptides . "
4289: Biochim .
4290: Biophys .
4291: Acta
4292: 1462 ( 1 - 2 ) :
4293: 55 - 70 .
4294: Sierra ,
4295: C . , R. Lascurain ,
4296: A . Pereyra , J. Guevara , G. Martinez ,
4297: C . Agundis ,
4298: E . Zenteno et
4299: L. Vasquez ( 2005 ) .
4300: " Participation of serum and membrane lectins on the oxidative burst regulation in Macrobrachium rosenbergii hemocytes . "
4301: Dev .
4302: Comp .
4303: Immunol .
4304: 29 :
4305: 113 - 121 .
4306: Silva , P .
4307: I . , S. Daffre et P. Bulet ( 2000 ) .
4308: " Isolation and characterization of gomesin , an 18 residue cystein-rich defense peptide from the spider Acanthoscurria gomesiana hemocytes with sequence similarities to horseshoe crab antimicrobial peptides of the tachyplesin family . "
4309: J. Biol .
4310: Chem .
4311: 275 ( 43 ) :
4312: 33464 - 33470 .
4313: Smith ,
4314: V. J . et P .
4315: A . Johnston ( 1992 ) .
4316: " Differential haemotoxic effect of PCB congeners in the common shrimp Crangon crangon . "
4317: Comp .
4318: biochem .
4319: Physiol .
4320: [ C ]
4321: 101 :
4322: 641 - 649 .
4323: Smith ,
4324: V. J . et N .
4325: A . Ratcliffe ( 1980 ) .
4326: " Host defense reactions of the shore crab Carcinus maenas ( L ) ; clearance and distribution of injected particles . "
4327: J. Mar .
4328: Biol .
4329: Assoc .
4330: UK .
4331: 60 :
4332: 89
4333: 102 .
4334: Smith ,
4335: V. J . et K. Söderhäll ( 1983 ) .
4336: " Induction of degranulation and lysis of heamocytes in the freshwater crayfish Astacus astacus , by components of the prophenoloxidase activating system in vitro . "
4337: Cell .
4338: Tissue Res .
4339: 233 :
4340: 295 - 303 .
4341: Söderhäll , I. ,
4342: E . Bangyeekhun , S. Mayo et K. Söderhäll ( 2003 ) .
4343: " Hemocyte production and maturation in an invertebrate animal ; proliferation and gene expression in hematopoïetic stem cell of Pacifastacus leniusculus . "
4344: Dev .
4345: Comp .
4346: Immunol .
4347: 27 :
4348: 661 - 672 .
4349: Söderhäll , I. et K. Söderhäll ( 2001 ) .
4350: Immune reactions .
4351: In Biology of freshwater crayfish .
4352: D .
4353: M. Holdich , Blackwell Science .
4354: 11 :
4355: pp. 439 - 464 .
4356: Söderhäll , K. ( 1982 ) .
4357: " Prophenoloxidase activating system and melanization : a recognition mechanism of arthropods ? A review . "
4358: Dev .
4359: Comp .
4360: Immunol .
4361: 6 :
4362: 601 - 611 .
4363: Söderhäll , K. ( 1999 ) .
4364: " Invertebrate immunity . "
4365: Dev .
4366: Comp .
4367: Immunol .
4368: 23 ( 4 - 5 ) :
4369: 263 - 266 .
4370: Söderhäll , K. , J. Cerenius et M. W. Johansson ( 1996 ) .
4371: The prophenoloxidase activating system in invertebrates .
4372: In New directions in Invertebrate Immunology .
4373: K. Söderhäll , S. Iwanaga and G. R. Vasta .
4374: Fair Haven , SOS Publications :
4375: pp. 229 - 253 .
4376: Söderhäll , K. et L. Häll ( 1984 ) .
4377: " Lipopolysaccharide-induced activation of prophenoloxidase activating system in crayfish haemocyte lysate . "
4378: Biochim .
4379: Biophys .
4380: Acta
4381: 797 :
4382: 99 - 104 .
4383: Söderhäll , K. et V. J. Smith ( 1983 ) .
4384: " Separation of the haemocyte population of Carcinus maenas and other marine decapods and phenoloxidase distribution . "
4385: Dev .
4386: Comp .
4387: Immunol .
4388: 7 :
4389: 229 - 239 .
4390: Söderhäll , K. ,
4391: V. J . Smith et M. W. Johansson ( 1986 ) .
4392: " Exocytosis and uptake of bacteria by isolated hemocyte populations of two crustaceans : evidence for cellular co-operation in the defense reactions of arthropods . "
4393: Cell Tissue Res .
4394: 245 :
4395: 43 - 49 .
4396: Söderhäll , K. ,
4397: A . Wringen ,
4398: M. W . Johansson et K. Bertheussen ( 1985 ) .
4399: " The cytotoxic reaction of hemocytes from the freshwater crayfish , Astacus astacus . "
4400: Cell Immunol .
4401: 94 :
4402: 326
4403: 332 .
4404: Somboonwiwat , K. , M. Marcos ,
4405: A . Tassanakajon , S. Klinbunga ,
4406: A . Aumelas ,
4407: B . Romestand , Y. Gueguen , H. Boze , G. Moulin et E. Bachère ( 2005 ) .
4408: " Recombinant expression and anti-microbial activity of anti-lipolysaccharide factor ( ALF ) from the black tiger shrimp Penaeus monodon . "
4409: Dev .
4410: Comp .
4411: Immunol .
4412: Sous presse .
4413: Song ,
4414: Y. L . et Y. T. Hsieh ( 1994 ) .
4415: " Immunostimulation of tiger shrimp ( Penaeus monodon ) hemocytes for generation of microbicidal substances : analysis of reactive oxygen species . "
4416: Dev .
4417: Comp .
4418: Immunol .
4419: 18 ( 3 ) :
4420: 201 - 209 .
4421: Sonnenberg ,
4422: A . ( 1993 ) .
4423: " Integrins and their ligands . "
4424: Curr .
4425: Op .
4426: Microbiol .
4427: Immunol .
4428: 184 :
4429: 7
4430: 35 .
4431: Sotelo-Mundo ,
4432: R. R . ,
4433: M. A . Islas-Osuna ,
4434: E . de-la-Re-Vega , J. Hernandez-Lopez ,
4435: F . Vargas-Albore et G. Yepiz-Plascencia ( 2003 ) .
4436: " cDNA cloning of the lysozyme of the white shrimp Penaeus vannamei . "
4437: Fish .
4438: Shellfish Immunol .
4439: 15 :
4440: 325 - 331 .
4441: Sottrup-Jensen , L. ( 1989 ) .
4442: " Alpha-macroglobulins : structure , shape and mechanism of proteinase complex formation . "
4443: J. Biol .
4444: Chem .
4445: 264 :
4446: 11539 - 11542 .
4447: Spycher ,
4448: S. E . , S. Arya ,
4449: D. E . Isenman et R. H. Painter ( 1987 ) .
4450: " A functional , thioestercontaining alpha 2 -macroglobulin homologue isolated from the hemolymph of the american lobster ( Homarus americanus ) . "
4451: J. Biol .
4452: Chem .
4453: 262 :
4454: 14606 - 14611 .
4455: Sritunyalucksana , K. , L. Cerenius et K. Söderhäll ( 1999 ) .
4456: " Molecular cloning and characterization of prophenoloxidase in the black tiger shrimp , Penaeus monodon . "
4457: Dev .
4458: Comp .
4459: Immunol .
4460: 23 :
4461: 179 - 186 .
4462: Sritunyalucksana , K. ,
4463: S. Y . Lee et K. Söderhäll ( 2002 ) .
4464: " A Beta- 1 , 3- glucan binding protein from the black tiger shrimp , Penaeus monodon . "
4465: Dev .
4466: Comp .
4467: Immunol .
4468: 26 :
4469: 237 - 245 .
4470: Sritunyalucksana , K. et K. Söderhäll ( 2000 ) .
4471: " The proPO and clotting system in crustaceans . "
4472: Aquaculture
4473: 191 :
4474: 53 - 69 .
4475: Steiner , H. ,
4476: D . Hultmark ,
4477: A . Engstrom , H. Bennich et H. G. Boman ( 1981 ) .
4478: " Sequence and specificity of two antibacterial proteins involved in insect immunity . "
4479: Nature
4480: 292 :
4481: 246
4482: 248 .
4483: Stewart ,
4484: J. E . et B. M. Zwicker ( 1972 ) .
4485: " Natural and induced bactericidal activities in the hemolymph of the lobster , Homarus americanus : products of hemocyte-plasma interaction . "
4486: Can .
4487: J. Microbiol .
4488: 18 :
4489: 1499 - 1509 .
4490: Stöcker , W. , S. Breit , L. Sottrup-Jensen et R. Zwilling ( 1991 ) .
4491: " Alpha 2 -macroglobulin from the haemolymph of the freshwater crayfish Astacus astacus . "
4492: Comp .
4493: biochem .
4494: Physiol .
4495: [ B ]
4496: 98 :
4497: 501 - 509 .
4498: Stouthamer , R. ( 1997 ) .
4499: Wolbachia induced parthenogenesis .
4500: In Influential passengers :
4501: inherited microorganisms and arthropod reproduction .
4502: S. L . O'Neill ,
4503: A. A . Hoffman and J .
4504: H. Werren .
4505: NY , Oxford University Press .
4506: Stouthamer , R. ,
4507: J. A . Breeuwer ,
4508: R. F . Luck et J. H. Werren ( 1993 ) .
4509: " Molecular identification of micro-organisms associated with parthenogenesis . "
4510: Nature
4511: 361 :
4512: 66 - 68 .
4513: Sugumaran , M. ( 1996 ) .
4514: Roles of the insect cuticule in host defense reactions .
4515: In New directions in Invertebrate Immunology .
4516: K. Söderhäll , S. Iwanaga and G.R. Vasta .
4517: Fair Haven , SOS Publications :
4518: 355 - 374 .
4519: Sugumaran , M. et M. R. Kanost ( 1993 ) .
4520: Regulation of insect hemolymph phenoloxidase .
4521: In Parasites and pathogens of insects .
4522: N.E . Beckage ,
4523: S.N . Thompson and B.A. Federici .
4524: San Diego , California , Academic Press Inc .
4525: Sun , L .
4526: V . ,
4527: J. M . Foster , G. Tzertzinis , M. Ono ,
4528: C . Bandi ,
4529: B. E . Slatko et S.
4530: ( 2001 ) .
4531: " Determination of Wolbachia genome size by pulse-field gel electrophoresis . "
4532: J. Bacteriol
4533: . 183 :
4534: 2219 - 2225 .
4535: Supungul , P. , S. Klinbunga , R. Pichyankura , S. Jitrapakdee , I. Hirono , T. Aoki et A. Tassanakajon ( 2002 ) .
4536: " Identification of immune related genes in hemocytes of black tiger shrimp ( Peneaus monodon ) . "
4537: Mar .
4538: Biotechnol .
4539: 4 :
4540: 487 - 494 .
4541: T
4542: Takaki , Y. , T. Muta et S. Iwanaga ( 1997 ) .
4543: " A peptidyl-propyl cis / trans-isomerase ( cyclophilin G ) in regulated secretory granules . "
4544: J. Biol .
4545: Chem .
4546: 272 ( 45 ) :
4547: 28615 - 28621 .
4548: Tasiemski ,
4549: A . , M. Verger-Bocquet , M. Cadet , Y. Goumon ,
4550: M. H . Metz-Boutigue ,
4551: D . Aunis ,
4552: G. B . Stefano et M. Salzet ( 2000 ) .
4553: " Proenkephaline A-derived peptides in invertebrates innate immune processes . "
4554: Brain Res .
4555: Mol .
4556: Brain Res .
4557: 76 ( 2 ) :
4558: 237 - 252 .
4559: Taylor ,
4560: M. J . et A. Hoerauf ( 1999 ) .
4561: " Wolbachia bacteria of filarial nematodes . "
4562: Parasitol .
4563: Today
4564: 15 :
4565: 437 - 442 .
4566: Thörnqvist ,
4567: P. O . ,
4568: M. W . Johansson et K. Söderhäll ( 1994 ) .
4569: " Opsonic activity of cell adhesion proteins and beta- 1 , 3- glucan binding proteins from two crustaceans . "
4570: Dev .
4571: Comp .
4572: Immunol .
4573: 18 :
4574: 3 - 12 .
4575: Thörnqvist ,
4576: P. O . et K. Söderhäll ( 1997 ) .
4577: " Crustacean immune reaction , a short review . "
4578: Dis .
4579: Asian Aquaculture III .
4580: Fish Health Section , Asian Fisheries Society , Manila .
4581: 203 - 218 .
4582: Turnbull ,
4583: M. W . ,
4584: S. B . Martin et B .
4585: A . Webb ( 2004 ) .
4586: " Quantitative analysis of hemocyte morphological abnormalities associated with Campoletis sonorensis parasitation . "
4587: J. Insect Sci .
4588: 11 :
4589: 1 - 15 .
4590: Tytler ,
4591: E. M . ,
4592: G. M . Anantharamaiah ,
4593: D. E . Walker ,
4594: V. K . Mishra ,
4595: M. N . Palgunashari et J. P. Segrest ( 1995 ) .
4596: " Molecular basis for prokaryotic specificity of magainin induced lysis . "
4597: Biochem .
4598: 34 :
4599: 4393 - 4401 .
4600: V
4601: Vargas-Albores ,
4602: F . ,
4603: M. A . Guzman et J. L. Ochoa ( 1993 ) .
4604: " An anticoagulant solution for haemolymph collection and prophenoloxidase studies of the penaeid shrimp ( Penaeus californiensis ) . "
4605: Comp .
4606: Biochem .
4607: Physiol .
4608: 121 ( 2 ) :
4609: 299 - 303 .
4610: Vasta ,
4611: G. R . et J .
4612: D . Lambris ( 2002 ) .
4613: " Innate immunity in the Aegean : ancient pathways for today's survival . "
4614: Dev .
4615: Comp .
4616: Immunol .
4617: 26 :
4618: 217 - 225 .
4619: Vazquez , L. , G. Maldonado ,
4620: C . Agundis ,
4621: A . Perez ,
4622: E. L . Cooper et E. Zenteno ( 1997 ) .
4623: " Participation of a sialic specific lectin from freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii hemocytes in the recognition of non-self cells . "
4624: Exp .
4625: Zool .
4626: 279 ( 265 - 272 ) .
4627: Vazquez , L. ,
4628: A . Perez ,
4629: D . Millan ,
4630: C . Agundis ,
4631: G. G . Martin ,
4632: E. L . Cooper , R. Lascurain et E. Zenteno ( 1997 ) .
4633: " Morphology of hemocytes from the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii . "
4634: J. Morphol .
4635: 234 :
4636: 147 - 153 .
4637: Vergote ,
4638: D . ,
4639: P. E . Sautière ,
4640: F . Vandenbulcke ,
4641: D . Vieau , G. Mitta ,
4642: E. R . Macagno et M. Salzet ( 2004 ) .
4643: " Up-regulation of neurohemerythrin expression in the central nervous system of the medicinal leech , Hirudo medicinalis , following septic injury . "
4644: J. Biol .
4645: Chem .
4646: 279 ( 42 ) :
4647: 43828 - 43837 .
4648: Vodovar , N. ,
4649: C . Acosta ,
4650: B . Lemaitre et F. Boccard ( 2004 ) .
4651: " Drosophila : a polyvalent model to decipher host-pathogen interactions . "
4652: Trends Microbiol .
4653: 12 ( 5 ) :
4654: 235 - 242 .
4655: W
4656: Wang , R. ,
4657: S. Y . Lee , L. Cerenius et K. Söderhäll ( 2001 ) .
4658: " Properties of the prophenoloxidase activating enzyme of the freshwater crayfish , Pacifastacus leniusculus . "
4659: Eur .
4660: J. Biochem .
4661: 268 :
4662: 895 - 902 .
4663: Werren ,
4664: J. H . et S. L. O'Neill ( 1997 ) .
4665: The evolution of heritable symbionts .
4666: In Influential passengers :
4667: inherited microorganisms and arthropod reproduction .
4668: S. L . O'Neill ,
4669: A. A . Hoffmann and J. H. Werren .
4670: Oxford , Oxford Univ .
4671: Press :
4672: 1 - 41 .
4673: Werren ,
4674: J. H . ,
4675: D. M . Windsor et L. R. Guo ( 1995 ) .
4676: " Distribution of Wolbachia among neotropical arthropods . "
4677: Proc .
4678: R. Soc .
4679: Lond .
4680: B .
4681: 262 :
4682: 197 - 204 .
4683: White ,
4684: K. N . et N .
4685: A . Ratcliffe ( 1982 ) .
4686: " The segregation and elimination of radio and fluorescent-labelled marine bacteria from the haemolymph of the shore crab , Carcinus maenas . "
4687: J. Mar .
4688: Biol .
4689: Assoc .
4690: UK. 62 :
4691: 819 - 833 .
4692: White ,
4693: K. N . ,
4694: N. A . Ratcliffe et M. Rossa ( 1985 ) .
4695: " The antibacterial activity of haemocyte clumps in the gills of the shore crab , Carcinus maenas . "
4696: J. Mar .
4697: Biol .
4698: 65 :
4699: 857 - 870 .
4700: Willies ,
4701: T. W . ,
4702: A. T . Tu et C. W. Miller ( 1989 ) .
4703: " Thrombolysis with a snake venom protease in rat model of venous thrombosis . "
4704: Thromb .
4705: Res .
4706: 53 :
4707: 19 - 29 . Winans ,
4708: K. A . ,
4709: D. S . King ,
4710: V. K . Rao et D. Mauzerall ( 1999 ) .
4711: " A chemically synthesized version of the insect antibacterial glycopeptide , diptericin , disrupts bacterial membranes . "
4712: Biochem .
4713: 38 :
4714: 11700 - 11710 .
4715: Wu , M. ,
4716: E . Maier , R. Benz et R .
4717: E. W . Hancock ( 1999 ) .
4718: " Mechanisms of interaction of different classes of cationic antimicrobial peptides with planar bilayers and with the cytoplasmic membrane of Escherichia coli . "
4719: Biochem .
4720: 38 :
4721: 7235 - 7242 .
4722: Wu , M. , L .
4723: V . Sun , J. Vamathevan , M. Riegler , R. Deboy ,
4724: J. C . Brownlie , M. E. A. , W. Martin ,
4725: C . Esser , N. Ahmadinejad ,
4726: C . Wiegand , R. Madupu ,
4727: M. J . Beanan ,
4728: L. M . Brinkac ,
4729: S. C . Daugherty ,
4730: A. S . Durkin ,
4731: J. F . Kolonay ,
4732: W. C . Nelson , Y. Mohamoud , P. Lee , K. Berry ,
4733: M. B . Young , T. Utterback , J. Weidman ,
4734: W. C . Nierman ,
4735: I. T . Paulsen ,
4736: K. E . Nelson , H. Tettelin ,
4737: S. L . O'Neill et J .
4738: A . Eisen ( 2004 ) .
4739: " Phylogenomics of the reproductive parasite Wolbachia pipientis pipientis wMel : a streamlined genome overrun by mobile genetic elements . "
4740: PLoS Biol .
4741: 2 :
4742: 327 - 341 .
4743: Y
4744: Yang , H. ,
4745: E . Nevo et R .
4746: E . Tashian ( 1998 ) .
4747: " Unexpected expression of carbonic anhydrase I and selenium-binding protein as the only major non heme proteins in erythrocytes of the subterranean mole rat ( Spalax ehrenbergi ) . "
4748: FEBS Lett .
4749: 430 :
4750: 343 - 347 .
4751: Yang , J. , M. Yamamoto , J. Ishibashi , K. Taniai et M. Yamakawa ( 1998 ) .
4752: " Isolation , cDNA cloning and gene expression of an antibacterial protein from larvae of the coconut rhinoceros beetle , Oryctes rhinoceros . "
4753: Eur .
4754: J. Biochem .
4755: 255 :
4756: 734 - 738 .
4757: Yeh ,
4758: M. S . ,
4759: Y. L . Chen et I. H. Tsai ( 1998 ) .
4760: " The hemolymphe clottable protein from tiger shrimp , Penaeus monodon , and related species . "
4761: Comp .
4762: Biochem .
4763: Physiol .
4764: [ B ]
4765: 121 ( 169 - 176 ) .
4766: Yeh ,
4767: M. S . , K. Kinoshita et M. Ashida ( 1999 ) .
4768: " Molecular cloning and characterization of a hemolymph clottable protein from tiger shrimp . "
4769: Eur .
4770: J. Biochem .
4771: 266 :
4772: 624 - 633 .
4773: Yount , N. , J. Yuan ,
4774: A . Tarver , T. Castro , G. Diamond , P. Tan , J. Levy ,
4775: C . McCullough ,
4776: J. Cullor ,
4777: C . Bevins et M. Selsted ( 1999 ) .
4778: " Cloning and expression of bovin neutrophil betadefensins . Biosynthetic profile during neutrophilic maturation and localization of mature peptide to novel cytoplasmic dense granules . "
4779: J. Biol .
4780: Chem .
4781: 274 :
4782: 26249 - 26258 .
4783: Yu ,
4784: K. H . ,
4785: K. N . Kim ,
4786: J. H . Lee ,
4787: H. S . Lee ,
4788: S. H . Kim ,
4789: K. Y . Cho ,
4790: M. H . Nam et I. H. Lee
4791: ( 2002 ) .
4792: " Comparative study on characteristics of lysozymes from the hemolymph of three lepidopteran larvea , Galleria mellonella mellonella , Bombyx mori , Agrius convolvuli convolvuli . "
4793: Dev .
4794: Comp .
4795: Immunol .
4796: 26 ( 8 ) :
4797: 707 - 713 .
4798: Z
4799: Zasloff , M. ( 2002 ) .
4800: " Antimicrobial peptides of multicellular organisms . "
4801: Nature
4802: 415 :
4803: 389
4804: 395 .
4805: Zdobnov ,
4806: E. M . ,
4807: C . von Mering , L. Letunic ,
4808: D . Torrents , M. Suyama ,
4809: R. R . Copley , G .
4810: K. Christophides ,
4811: D . Thomasova ,
4812: R. A . Holt ,
4813: G. M . Subramanian ,
4814: H. M . Mueller , G. Dimopoulos ,
4815: J. H . Law ,
4816: M. A . Wells ,
4817: E . Birney , R. Chalab ,
4818: A. L . Halpern ,
4819: E . Kokova ,
4820: C .
4821: L. Kraft , Z. Lai , S. Lewis ,
4822: C . Louis ,
4823: C . Barillas-Mury ,
4824: D . Nusskern ,
4825: G. M . Rubin ,
4826: S. L . Salzberg ,
4827: G. G . Sutton , P. Topalis , R. Wides , P. Wincker , M. Yandell ,
4828: F. H . Collin , J. Riberra ,
4829: W. M . Gelbart ,
4830: F. C . Kafatos et P. Bork ( 2002 ) .
4831: " Comparative genome and proteome analysis of Anopheles gambia and Drosophila melanogaster . "
4832: Science
4833: 298 :
4834: 149
4835: 159 .
4836: Zhang , X. ,
4837: C . Huang et Q. Qin ( 2004 ) .
4838: " Antiviral properties of hemocyanin isolated from the shrimp Penaeus monodon . "
4839: Antiviral Res .
4840: 61 :
4841: 93 - 99 .
4842: Zhang , Y. ,
4843: A . Wisner , Y. Xiong et C. Bon ( 1995 ) .
4844: " A novel plasminogen activator from snake venom . Purification , characterization and molecular cloning . "
4845: J. Biol .
4846: Chem .
4847: 270 :
4848: 10246 - 10255 .
4849: Zlateva , T. ,
4850: P. D . I. Muro ,
4851: B . Salvato et M. Beltramini ( 1996 ) .
4852: " The o-diphenoloxidase activity of arthropod hemocyanin . "
4853: FEBS Lett .
4854: 384 :
4855: 251 - 254 .
4856: Annexes
4857: ANNEXE I
4858: Wolbachia chez les arthropodes et les nématodes
4859: Dans la nature , une grande partie des espèces animales ou végétales sont parasitées ou vivent en symbiose .
4860: Les associations telles que le parasitisme et le mutualisme sont aujourd'hui reconnues comme jouant un rôle clé dans l' écologie et l' évolution des espèces
4861: ( Combes , 2001 ) .
4862: Toutefois , la limite entre parasitisme et mutualisme est parfois difficile à déterminer et on assiste à des relations complexes entre l' hôte et l' organisme hébergé qui suscitent de multiples questions en terme d' immunité , de survie ou de tolérance ( 1 ) Qui bénéficie le plus de la relation ? ( 2 ) Pourquoi le parasite / symbiote n' est -il pas éliminé par l' hôte ( 3 ) Comment le parasite / symbiote évite -t-il le système immunitaire ?
4863: Est -il reconnu par l' hôte ?
4864: Modifie -t-il le fonctionnement cellulaire et/ou physiologique de son hôte ?
4865: Chez les arthropodes , de nombreuses espèces hébergent des microorganismes intracellulaires qui sont transmis verticalement ;
4866: leur survie dépend donc du succès reproducteur de leurs hôtes .
4867: Afin d' augmenter leur propre transmission , certains de ces micro-organismes , dits parasites de la reproduction , manipulent la reproduction de leurs hôtes .
4868: Les bactéries endocellulaires du genre Wolbachia en sont l' exemple typique .
4869: Les Wolbachia sont des bactéries intracytoplasmiques strictes , non cultivables , appartenant à la division des & 206;& 133;-protéobactéries .
4870: Ellespossèdent les caractéristiques générales des rickettsies ( Hertig et Wolbach , 1924 ) puisqu' elles appartiennent au groupe des rickettsia-like qui réunit des bactéries hébergées par des arthropodes vecteurs de maladie humaines , comme par exemple , Cowdria et Anaplasma
4871: ( O'Neill et al. , 1992 ; Stouthamer et al. , 1993 ) .
4872: Le genre Wolbachia a été décrit pour la première fois chez le moustique en 1924 ( Hertig et Wolbach , 1924 ) .
4873: Les effets physiologiques de ces bactéries endocellulaires , parasites du sexe ont été intensivement étudiés dans notre laboratoire chez différents isopodes .
4874: Ces bactéries , alors appelées bactéries F ( féminisantes ) , ont été mises en évidence dès le début des années 1970 ( Juchault , 1966 ; Legrand et Juchault , 1970 ; Martin et al. , 1973 ) .
4875: Avec le développement de la PCR , les Wolbachia ont été identifiées chez de nombreux arthropodes ( insectes , acariens , isopodes ... ) ( Werren et O'Neill , 1997 ; Breeuwer et Jacobs , 1996 ; Martin et al. , 1994 ; Bouchon et al. , 1998 ) mais également chez des nématodes ( Bandi et al. , 1998 ) , ce qui en fait probablement les parasites intracellulaires les plus ubiquistes du règne animal .
4876: Des études suggèrent qu' au moins 16 % des espèces d' insectes peuvent naturellement infectées par cette bactérie ( Werren et al. , 1995 ) .
4877: Chez les isopodes terrestres , 35 % des espèces sont infectées ( Bouchon et al. , 1998 ) et chez les filaires , 9 des 10 espèces répertoriées sont infectées ( Bandi et al. , 1998 ) .
4878: Toutes les études phylogénétiques menées sur le groupe des
4879: Wolbachia s' accordent sur la non-congruence de la phylogénie des bactéries à celles de leurs hôtes .
4880: La distribution actuelle des bactéries serait donc en partie le résultat de transferts horizontaux .
4881: Quel que soit le type de modification induite par Wolbachia sur la reproduction de ses hôtes , la conséquence théorique est toujours l' augmentation de la prévalence de Wolbachia dans les populations hôtes .
4882: Les altérations de la reproduction que Wolbachia entraînent chez les arthropodes sont désormais bien connues et sont les suivantes :
4883: ( a ) L' incompatibilité cytoplasmique ( IC ) :
4884: un croisement entre un mâle infecté et une femelle non infectée ou infectée par une souche différente de Wolbachia résulte en la mort des embryons .
4885: L' IC s' exprime chez deux espèces d' isopodes terrestres ( Legrand et al. , 1986 ; Moret et al. , 2001 ) et chez les insectes , c' est actuellement l' effet le plus répandu ( O'Neill et al. , 1997 ) .
4886: ( b ) La parthénogenèse thélytoque :
4887: les femelles vierges infectées ne produisent que des femelles .
4888: Cet effet se rencontre uniquement chez les hyménoptères haplo-diploïdes ( Stouthamer et al. , 1997 ; pour revue ) .
4889: ( c ) Le & 200;& 136;male killing& 200;& 136; ( Hurst et al. , 1999 ; Jiggins et al. , 2000 ) :
4890: les embryons mâles infectés ne sont pas viables tandis que les embryons femelles infectés se développent normalement .
4891: Cet effet est décrit chez deux espèces de lépidoptères et chez un coléoptère ( Hurst et al. , 1999 ) .
4892: ( d ) La réalisation de l' ovogenèse ( Dedeine et al. , 2001 ) :
4893: les femelles chez lesquelles la souche de Wolbachia a été éliminée par traitement antibiotique n' ont pas d' ovocytes matures dans leurs ovaires et ne peuvent donc pas se reproduire .
4894: ( e ) La féminisation :
4895: cet effet se rencontre principalement chez les crustacés isopodes terrestres et se traduit par la transformation des mâles génétiques en femelles fonctionnelles ( Martin et al. , 1973 ; Juchault et al. , 1994 ) .
4896: Chez les nématodes , Wolbachia est présente chez les filaires Onchocerca volvulus responsables de la cécité des rivières , Wuchereria bancrofti bancrofti et Brugia malayi responsables de l' éléphantiasis chez l' homme ( Taylor et Hoerauf , 1999 ; Bandi et al. , 1999 et 2001 ) .
4897: Chez ces hôtes , Wolbachia n' induit pas d' altération de la reproduction , mais il semble que sa présence soit nécessaire au développement de son hôte .
4898: Des traitements à la tétracycline montrent que la réduction de la charge en Wolbachia chez les nématodes inhibe l' embryogenèse , la production de microfilaires et le développement des larves en adultes , et interfère avec la durée de vie des adultes ( Bandi et al. , 2001 ; Langworthy et al. , 2000 ) .
4899: ANNEXE III
4900: Nombre d' hémocytes circulants par microlitre d' hémolymphe chez Armadillidium vulgare ( A.v. ) et chez Armadillidium vulgare infectés par Wolbachia ( A.v . + W ) .
4901: 20 femelles de chaque type d' animaux ont été prélevées et les cellules ont été dénombrées 3 fois par animal .
4902: La ligne moyenne indique le nombre moyen d' hémocytes circulants par microlitre dans l' hémolymphe .
4903: ANNEXE III
4904: Comparaison des séquences protéiques d' hémocyanines et de prophénoloxidases
4905: chez différents de crustacés , par alignement multiple ( CLUSTAL W ) .
4906: H :
4907: hémocyanine , P :
4908: prophénoloxydase .
4909: Numéros d' accession
4910: :
4911: H Panulirus interruptus :
4912: BHLOA ;
4913: HB Panulirus interruptus :
4914: BHLOB ;
4915: H Pontastacus leptodactylus :
4916: P83180 ;
4917: H Pacifastacus leniusculus :
4918: AA047336 ;
4919: Armadillidium vulgare ;
4920: H Penaeus vannamei :
4921: CAA57880 ;
4922: H2 Pacifastacus leniusculus :
4923: AAM81357 ;
4924: P Pacifastacus leniusculus :
4925: CAA58471 ;
4926: P Homarus americanus :
4927: AAT73697 ;
4928: P Penaeus semisulcatus :
4929: AAM77690 ;
4930: P Penaeus monodon :
4931: AAM77689 ;
4932: P Penaeus japonicus :
4933: BAB83773 .
4934: Résumé
4935: Les cellules sanguines ( hémocytes ) sont le principal siège de l' immunité innée chez les crustacés .
4936: Cette immunité apparue très tôt dans le règne animal , diffère de l' immunité acquise ( vertébrés ) , elle comporte deux aspects ;
4937: l' un cellulaire ( phagocytose , encapsulation ) , l' autre humoral ( coagulation , mélanisation , synthèse et libération de molécules antimicrobiennes ) .
4938: Par un ensemble de techniques complémentaires cytologiques , biochimiques et moléculaires , nous avons appréhendé la réponse immunitaire de l' isopode terrestre Armadillidium vulgare sain et infecté par Wolbachia [ bactéries endocellulaires , Gram
4939: ( - ) ] .
4940: Outre la détermination de la spécificité des fonctions cellulaires des différents types d' hémocytes , notre étude a abouti à la purification et à la caractérisation d' un peptide antibactérien riche en glycines , l' armadillidine ( 5259 Da ) dont l' activité est dirigée contre les Gram ( + ) .
4941: Des isoformes de ce peptide sont retrouvées uniquement dans la famille des
4942: Armadillididae ( crustacés ) .
4943: De plus , nous avons montré que le clivage du C-terminal de l' hémocyanine ( protéine majoritaire du plasma à rôle oxyphorique ) libérait in vitro un peptide
4944: ( 2932 Da ) capable d' inhiber la croissance du champignon pathogène Botrytis cinerea ;
4945: L' approche protéomique a permis d' identifier dans notre modèle un certain nombre de protéines intervenant dans les deux aspects de la réponse immunitaire des arthropodes .
4946: Le rôle de Wolbachia sur le fonctionnement du système immunitaire n' est pas clairement apparu , nous avons toutefois noté son action sur le cytosquelette des hémocytes .
4947: Parmi les molécules ainsi caractérisées , certaines pourraient présenter potentiellement un intérêt économique .
4948: Mots clés :
4949: Armadillidium vulgare - Immunité innée & 226;& 128;& 147; Hémocytes & 226;& 128;& 147; Peptides antimicrobiens & 226;& 128;& 147; Hémocyanine & 226;& 128;& 147; RP-HPLC & 226;& 128;& 147; Electrophorèse bidimensionnelle & 226;& 128;& 147; Microscopie électronique .
Fichiers
| Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
|---|---|---|
| these_272_bio_herbiniere_gaboreau.orfeo | fichier | 3531988 |
| these_272_bio_herbiniere_gaboreau.xml | fichier | 3671 |
| these_272_bio_herbiniere_gaboreau.txt | fichier | 376996 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.
Page générée le 27/03/2019, 12 h 29